D’origine pakistanaise, l’auteur de la communication (ci-après « l’auteur »), né le 31 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 25 août 2019. Le 27 août, il s’est présenté à une association mandatée afin de procéder à l’évaluation de sa minorité et de sa situation administrative. Il soutient n’avoir alors bénéficié d’aucun accueil provisoire d’urgence (§ 2.1). Le 28 août, l’association a procédé à l’évaluation et a conclu dans son rapport d’évaluation qu’» il demeure un doute sur l’état civil » de l’auteur (§ 2.2). Le même jour, sur la base de ce rapport, l’auteur s’est vu notifier une décision de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance (ci-après « ASE ») (§ 2.3).
Le 30 septembre 2019, l’auteur a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire lui demandant la mise en œuvre d’une mesure de protection et être confié dans le cadre d’un placement à l’ASE. À l’appui de sa demande, le requérant soutient avoir présenté lors de l’audience devant le juge des enfants l’original de son acte de naissance et de sa carte d’identité pakistanaise. Le 4 décembre, le tribunal judiciaire a prononcé un non-lieu jugeant que l’auteur ne pouvait être considéré comme mineur et considérant notamment que la carte d’identité présentée ne semblait pas lui correspondre (§ 2.4). Le 20 décembre, l’auteur a interjeté appel du jugement et une audience s’est tenue devant la Cour d’appel le 8 septembre 2020, au cours de laquelle il a présenté plusieurs documents d’identité originaux (acte de naissance légalisé par l’ambassade du Pakistan à Paris, carte nationale d’identité pakistanaise et photocopie de son passeport portant mention de son numéro de citoyen) et pu bénéficier de l’assistance d’un interprète (§ 2.5). La Cour d’appel a alors ordonné une expertise et renvoyé l’audience au 12 janvier 2021, soit postérieurement à sa majorité (§ 2.6). L’auteur indique qu’il ne dispose, depuis le 28 août 2019, d’aucune prise en charge (§ 2.7).
Le 9 décembre 2020, l’auteur a introduit une communication individuelle devant le Comité des droits de l’enfant (ci-après le « Comité ») en invoquant la violation des articles 3 (intérêt supérieur de l’enfant), 8 (protection de l’identité), 12 (prise en considération de l’opinion de l’enfant) et 20 (protection de l’enfant privé de son milieu familial) de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après la « Convention »), en raison de la procédure de détermination de son âge par les autorités internes et de l’absence de protection lui ayant été octroyée (§ 3.1).
Au titre des mesures provisoires, le Groupe de travail des communications a, le 10 décembre 2020, sur le fondement de l’article 6 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention (adopté le 19 décembre 2011, entré en vigueur le 14 avril 2014 et le 7 avril 2016 pour la France, U.N. doc. A/RES/66/138) (ci-après le « Protocole »), demandé à l’État partie de placer l’auteur dans un foyer pour enfants jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il atteindrait 18 ans, et de suspendre son éloignement vers son pays d’origine jusqu’à cette date (§ 1.2). Cependant, le Comité note que l’auteur n’a été mis à l’abri que le 31 décembre 2020, jour de son dix-huitième anniversaire, et que l’État partie ne justifie pas l’inexécution de la mesure provisoire. Le Comité a rappelé l’obligation conventionnelle pesant sur les États ayant ratifié le Protocole, afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé alors que la communication individuelle est en cours d’examen et afin d’assurer l’efficacité de la procédure des communications individuelles. Le Comité conclut donc en la violation de l’article 6 du Protocole (§ 8.12).
S’agissant de la recevabilité de la communication individuelle – L’État partie soutient que la communication de l’auteur est irrecevable sur le fondement de l’article 7 e) du Protocole, dans la mesure où l’auteur n’aurait pas épuisé les voies de recours internes. D’une part, il souligne que le recours devant la Cour d’appel était pendant lors de l’introduction de la communication individuelle et constituait une voie de recours effective à épuiser préalablement à la saisine du Comité, car susceptible de remédier aux violations invoquées par l’auteur. Il fait valoir à ce titre que la Cour d’appel a, par un arrêt du 12 février 2021, infirmé le jugement du tribunal judiciaire en considérant que l’authenticité des documents d’identité de l’auteur était démontrée et que l’auteur aurait dû être prise en charge par l’ASE, et que l’auteur n’a pas sollicité le prononcé de mesures provisoires dans l’attente de la décision à intervenir, notamment son placement provisoire (§§ 4.1 et 4.2). D’autre part, il soutient que le requérant n’aurait pas invoqué de moyens tirés de la violation de la Convention devant les juridictions internes (§ 4.3). En l’espèce, le Comité estime non seulement que la communication est recevable (§ 7.4), mais également que le recours devant la Cour d’appel ne peut être considéré comme utile au sens de l’article 7 e) du Protocole compte tenu des délais déraisonnables pour statuer sur le recours de l’auteur, de l’absence de caractère suspensif du recours et de l’absence d’adoption de mesures provisoire de protection au bénéfice de l’auteur durant l’examen de son recours (§ 7.2). Par ailleurs, le Comité a écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État partie en ce que l’auteur n’aurait pas invoqué ses moyens tirés de la violation de la Convention devant le juge interne (§ 7.3).
Sur le fond, à titre liminaire, le Comité a rappelé que « la détermination de l’âge d’un jeune qui affirme être mineur revête une importance capitale puisque le résultant de cette procédure détermine si l’intéressé peut prétendre à la protection de l’État en sa qualité d’enfant ». À ce titre, la détermination de l’âge doit reposer sur une procédure régulière, au cours de laquelle les décisions doivent être susceptibles de recours et l’intéressé doit conserver la présomption de sa minorité, dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (§ 8.3 ; CRC, N.B.F. c. Espagne, constatations du 27 septembre 2018, communication n° 11/2017, U.N. doc. CRC/C/79/D/11/2017, § 12.3).
S’agissant de la procédure de détermination de l’âge de l’auteur par les autorités internes – Par sa communication individuelle, l’auteur soutient que la procédure de détermination de son âge n’a pas respecté le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3 de la Convention, en méconnaissance du principe de présomption de minorité (§ 3.2). Par ailleurs, il allègue la violation de l’article 3 lu conjointement à l’article 12 § 2 de la Convention, en raison des conditions et de l’absence de garanties encadrant l’entretien sommaire d’évaluation de sa minorité (prise en compte de son apparence et des incohérences de ses déclarations, entretien dans langue non maternelle, absence d’avocat ou de représentant, absence de possibilité de lire ou de modifier ses déclarations) (§ 3.3). Compte tenu de ces éléments, le Comité a estimé que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été une considération primordiale dans la procédure de détermination de l’âge de l’auteur et, partant, que l’État partie a méconnu ses obligations conventionnelles issues des articles 3 et 12 de la Convention (§§ 8.5-8.9).
S’agissant de la non-reconnaissance de son identité, l’auteur soutient que l’État partie a méconnu l’article 8 de la Convention, tel qu’interprété par le Comité, selon lequel l’âge constitue un élément fondamental de l’identité auquel les États parties ne doivent pas porter atteinte (CRC, A.D. c. Espagne, constatations du 10 mars 2020, communication n° 21/2017, U.N. doc. CRC/C/83/D/21/2017, § 10.17). À cet égard, l’auteur souligne que les autorités internes n’ont pas cherché à vérifier l’exactitude des informations figurant sur ses documents d’identité auprès des autorités pakistanaises (§ 3.5). Le Comité, rappelant que la date de naissance d’un enfant fait partie de son identité, que l’État partie doit respecter, a estimé qu’il a méconnu les droits de l’auteur issu de l’article 8 de la Convention, en considérant que les documents d’identité qu’il a présentés n’avait aucune valeur probante, sans qu’ils ne puissent être vérifiés par les autorités de son pays d’origine (§ 8.10).
S’agissant de l’exclusion du système de l’ASE – L’auteur affirme qu’il s’est retrouvé en situation d’abandon et de grande vulnérabilité, notamment durant la pandémie de COVID-19, et n’a pas bénéficié d’un accueil provisoire d’urgence, et ainsi d’un hébergement, en méconnaissance du droit interne et de l’article 3 lu conjointement à l’article 20 de la Convention (§ 3.4). Le Comité a rappelé son interprétation de l’article 20 consacrant à l’égard des États parties une obligation positive d’assurer, d’une part, la protection de tous les enfants migrants privés de leur milieu familial en garantissant, entre autres, l’accès aux services sociaux, à l’éducation et à un logement adéquat et, d’autre part, le bénéfice du doute à tous les jeunes migrants qui affirment être des enfants pendant la procédure de détermination de leur âge, et de les traiter tels (CRC, Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, Observation générale n° 6, 2005, U.N. doc. CRC/GC/2005/6). En l’absence de telles mesures en l’espèce, le Comité a conclu en la violation de l’article 20 § 1 de la Convention. Le Comité a également conclu à la violation de l’article 37 a), de la Convention, relatif à la prohibition de la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, non invoqué par l’auteur (§ 8.12).
Le Comité conclut donc à la violation des articles 3, 8, 12, 20 § 1 et 37 a), de la Convention, ainsi que de l’article 6 du Protocole (§ 9). Conformément aux demandes de réparation de l’auteur, devenu majeur, le Comité affirme que l’État partie est tenu de donner à l’auteur la possibilité de régulariser sa situation administrative et de bénéficier d’une protection prévue par la législation interne (§§ 3.9 et 10). Le Comité affirme également que l’État partie a l’obligation de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas et lui émet à cet égard une série de recommandation (§ 10). Postérieurement, le Comité a réitéré ses recommandations lors de l’examen du rapport périodique de la France (CRC, Observations finales concernant le rapport de la France valant sixième et septième rapport périodique, 4 décembre 2023, U.N. doc. CRC/C/FRA/CO/6-7, § 45 c)).
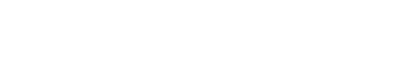

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
