Peu de notions donnent lieu à des débats aussi passionnés devant la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour ») que la notion de « juridiction ». On se souvient notamment des réactions enflammées de la Première ministre britannique et de son ministre de la défense suite à la décision de la Cour de faire bénéficier les Irakiens des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention ») dans le contexte de l’occupation de l’Irak par les États de la coalition, en jugeant que ceux-ci se trouvaient « sous la juridiction » du Royaume-Uni[1]. Dans une décision M.N. c. Belgique[2] rendue par la Grande Chambre le 5 mai 2020, la Cour revient sur la question de l’exercice par l’État contractant de sa « juridiction » à l’égard de personnes se trouvant hors du territoire national, cette fois-ci en lien avec la politique européenne d’asile et d’immigration.
À l’origine de cette affaire se trouve une demande de visa formulée sur le fondement de l’article 25 du code communautaire des visas (qui permet notamment de demander un visa à validité territoriale limitée « pour des raisons humanitaires »[3]) par une famille syrienne aux autorités diplomatiques de l’ambassade de Belgique à Beyrouth. Cette famille, résidant à Alep, avait vu la maison familiale détruite par les bombardements lors de la guerre et vivait dans les conditions sanitaires et sécuritaires précaires qui étaient celles d’Alep en 2016. Elle demandait à entrer sur le territoire belge dans le but explicite de formuler une demande d’asile (qui ne peut être formulée devant les autorités consulaires ou diplomatiques).
Quelques semaines plus tard, l’Office des étrangers belge, basé à Bruxelles, refusa l’octroi de visas aux requérants au motif que les visas sollicités étaient destinés aux personnes souhaitant se rendre sur le territoire d’un État de l’espace Schengen pour un séjour de courte durée, et non pas pour formuler une demande d’asile et s’installer de manière permanente sur le territoire. Les requérants firent appel devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui suspendit la décision de refus d’octroi de visa et ordonna à l’office des étrangers d’adopter de nouvelles décisions prenant en compte la situation « extrêmement dangereuse »[4] prévalant en Syrie à l’époque des faits. L’Office des étrangers maintint sa décision, et indiqua aux avocats des requérants que « l’article 3 de la Convention ne pouvait pas être interprété comme exigeant des États d’admettre sur leur territoire toutes les personne vivant une situation catastrophique, sous peine d’exiger des pays développés d’accepter toutes les populations des pays en voie de développement, en guerre ou ravagés par des catastrophes naturelles »[5]. S’ensuivit une véritable partie de ping-pong entre l’Office des étrangers et le Conseil du contentieux des étrangers (ponctué d’une question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne)[6] au terme de laquelle les requérants finirent par obtenir un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 20 octobre 2016 enjoignant à l’administration de délivrer dans les 48 heures un laissez-passer ou un visa valable trois mois. Cependant, le Secrétaire d’État à l’asile et à la migration Théo Francken, du parti nationaliste flamand N-VA, s’opposa frontalement à l’exécution de la décision. Il déclara dans la presse que les visas dits « humanitaires » ne seraient pas délivrés, au motif que cela créerait un « précédent dangereux » et « mena[çerait] de déclencher un afflux devant nos consulats à Beyrouth et Ankara »[7]. Au terme de multiples procédures devant le juge d’exécution sur lesquelles il n’est pas nécessaire de s’étendre, la justice belge finit par donner raison à l’administration et débouter les requérants de leurs demandes[8].
C’est ainsi que les requérants déposèrent le 10 janvier 2018 une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. Ils allèguent sur le fondement des articles 3 et 13 de la Convention que le refus des autorités belges de délivrer des visas dits « humanitaires » afin de leur permettre d’entrer sur le territoire et d’y déposer une demande d’asile les a exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Syrie (article 3), et qu’ils ne disposaient pas de recours effectif face à cette situation (article 13). Les requérants invoquent également une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention du fait de l’impossibilité de poursuivre l’exécution de l’arrêt enjoignant à l’État belge de leur délivrer les visas humanitaires.
Cependant, les débats ne tournèrent pas tant autour des questions de fond – l’existence de traitements inhumains ou dégradants ou l’existence d’un obstacle à l’exécution des décisions de justice – qu’autour de la question préalable – et fondamentale – de l’applicabilité de la Convention européenne des droits de l’homme à la situation de personnes se trouvant hors du territoire national et cherchant à y entrer. En effet, selon l’article 1er de la Convention (qui régit le champ d’application général du traité), les États parties ne « reconnaissent » les droits et libertés garantis par la Convention qu’aux seules « personne[s] relevant de leur juridiction ». Or, si la jurisprudence de la Cour de Strasbourg est relativement claire sur les conditions dans lesquelles les actes « accomplis en dehors du territoire national » constituent un exercice de « juridiction » au sens de l’article 1er, il n’est pas certain qu’une décision prise sur le territoire de l’État mais « produisant des effets en dehors du territoire national »[9], comme c’est le cas en l’espèce, suffise à faire relever les personnes visées par la décision de la « juridiction » de l’État au sens de l’article 1er de la Convention. La Cour avait bien affirmé dans l’affaire Drozd et Janousek c. France et Espagne de 1992 que la « juridiction » d’un État contractant pouvait « s’étendre aux actes de ses organes qui déploient leurs effets en dehors de son territoire »[10], mais il faut bien dire que depuis, de l’eau a coulé sous les ponts : les affaires relatives à la situation au Nord de Chypre[11], à la Transnistrie[12] au Haut-Karabakh[13] et à l’occupation de l’Irak par les États de la coalition[14] ont révélées la centralité de la notion de « juridiction » dans le système européen de protection des droits de l’homme et mises en lumière les implications majeures qu’une interprétation plus ou moins extensive de cette notion engageait.
Dans l’affaire M.N. c. Belgique, la Cour devait donc trancher la question de savoir si la décision prise par les autorités nationales sur leur propre territoire de ne pas délivrer de visa de séjour à des étrangers se trouvant hors du territoire national faisait relever ces personnes de la « juridiction » de la Belgique, déclenchant ainsi l’obligation énoncée à l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme de « reconnaître » à ces personnes les « droits et libertés » garantis par ladite Convention.
Le fait que onze États contractants décident de se porter tiers-intervenants devant la Cour montre que l’enjeu de cette affaire dépasse – et de loin – le cas particulier des requérants. D’une part, une réponse positive de la Cour à cette question constituerait un pas important vers la remise en cause du système actuel de protection des demandeurs d’asile. Jusqu’à présent, les États n’ont d’obligations vis-à-vis des demandeurs d’asile qu’une fois que ceux-ci se trouvent sur leur territoire ou se présentent à la frontière[15]. Mais sur fond de noyades à répétition en Méditerranée et de révélations d’actes qui frôlent l’indicible au Sinaï, de plus en plus de voix s’élèvent pour que les États garantissent aux demandeurs d’asile des « voies d’accès légales et sûres » pour rejoindre le pays d’accueil[16]. Si la Cour européenne affirmait que la décision des autorités nationales de ne pas délivrer de visa à des demandeurs d’asile situés en dehors du territoire faisait passer ceux-ci sous la « juridiction » de l’État, une bonne partie du chemin vers l’octroi de voies d’accès légales et sûres pour rejoindre le pays d’accueil serait franchi : il ne resterait plus qu’à reconnaître à l’État l’obligation positive de délivrer des visas dits « humanitaires » aux personnes alléguant se trouver dans une situation contraire à l’article 3. Mais au-delà du système international et européen d’asile, c’est tout le rapport des États membres du Conseil de l’Europe au reste du monde qui pourrait être bouleversé. En effet, si un État contractant exerce sa « juridiction » chaque fois qu’une décision nationale affecte la situation d’une personne située en dehors du territoire national, alors le prétoire de la Cour européenne des droits de l’homme, déjà bien encombré, pourrait s’ouvrir à un nombre extraordinaire de nouvelles requêtes – que l’on pense simplement aux décisions prises sur le territoire national des États membres du Conseil de l’Europe qui contribuent à la crise écologique actuelle et qui affectent potentiellement… n’importe qui sur terre. En dernière instance, la Cour doit ainsi répondre à cette question que tout le monde se pose vis-à-vis de la « juridiction », parfaitement formulée par le juge Pavli lors de l’audience du 24 avril 2019 : « is it bottomless, or does it have a bottom ? »[17].
Dans sa décision du 5 mai 2020, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme refuse de considérer que toute décision nationale affectant des personnes situées en dehors du territoire constitue ipso facto un « exercice de juridiction » au sens de l’article 1er et maintient un seuil d’applicabilité de la Convention relativement élevé (I). Cependant, cette solution révèle une confusion entre l’applicabilité de la Convention et l’existence d’obligations internationales à la charge de l’État qui indique la voie d’une solution alternative (II).
I. Le refus de considérer que toute décision étatique affectant des personnes se trouvant hors du territoire national constitue un exercice de « juridiction »
Au lieu de faire droit à l’argumentation des requérants qui soutenaient qu’en refusant de délivrer des visas, les autorités belges avaient exercé leur compétence en matière d’immigration et donc leur « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention (A), la Cour a préféré restreindre l’accès à son prétoire en maintenant un seuil élevé d’application de la Convention aux actes nationaux déployant leurs effets en dehors du territoire de l’État (B).
A. L’établissement par les requérants d’un lien entre exercice de la « juridiction » et exercice de la compétence étatique en matière d’immigration
Comme nous l’avons dit dans l’introduction, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’application extraterritoriale de la Convention est bien établie dès lors que des agents de l’État, qu’il s’agisse des autorités diplomatiques ou consulaires ou des forces armées, se trouvent en dehors du territoire. La Cour estime en effet qu’à partir du moment où des agents de l’État exercent un « contrôle effectif » sur un territoire étranger (comme dans le cas d’une occupation militaire[18]) ou exercent leur « autorité » ou leur « contrôle » sur des personnes (comme dans le cas d’une opération de sécurité ou d’une détention[19]), alors l’État exerce sa « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention et doit donc reconnaître aux personnes affectées par ses actions les droits et libertés garantis par la Convention et ses protocoles additionnels. Si ce type d’affaires laisse encore de nombreuses questions en suspens, la jurisprudence de la Cour est relativement stable depuis la mise au point opérée par l’arrêt Al-Skeini[20].
Ce qui distingue ces situations de la présente affaire, c’est qu’ici les agents de l’État ayant pris la décision litigieuse – le refus de délivrer des visas « humanitaires » pour permettre aux requérants d’entrer sur le territoire national et d’y déposer une demande d’asile – se trouvaient sur le territoire national – très précisément à Bruxelles – et non pas au Liban ou en Syrie. Les requérants ont certes eu un contact avec le corps diplomatique et consulaire belge de l’ambassade de Beyrouth, mais comme le relève la Cour, « les décisions litigieuses ont été prises par l’administration belge en Belgique »[21] ; ces décisions n’ont fait que « transit[er] par les services consulaires de l’ambassade qui en ont informé les requérants »[22]. Impossible donc pour les requérants de fonder leur argumentation sur les hypothèses de l’arrêt Al-Skeini, puisque les actes litigieux ne sont pas le fruit d’agents de l’État situés en dehors du territoire national, en contact direct avec les requérants.
Ces situations sont en vérité si différentes qu’il est trompeur de les rassembler sous l’expression « application extraterritoriale de la Convention »[23], dans la mesure où tout dépend de ce qu’on nomme l’« extraterritorialité » : est-ce le simple fait que les victimes se trouvent en dehors du territoire, auquel cas les situations visées par Al-Skeini et celle de la présente affaire posent toutes deux la question de l’« extraterritorialité » de la Convention, ou est-ce le fait que le fait générateur de la violation ait eu lieu en dehors du territoire national, auquel cas seules les situations visées par Al-Skeini posent le problème de l’« extraterritorialité »[24] ? En d’autres termes – et pour reprendre une distinction faite par la Cour dans l’affaire Ilascu – l’ « extraterritorialité » ne vise-t-elle que les cas où des actes de l’État sont « accomplis en dehors du territoire national », ou inclut-elle également les actes de l’État « produisant des effets en dehors du territoire national »[25] ?
En tout état de cause, les requérants délaissent avec raison la lignée jurisprudentielle d’Al-Skeini pour fonder leur argumentation sur l’exercice, par les agents de l’État, de la compétence que leur reconnaît le droit international en matière d’immigration[26]. En refusant de délivrer des visas aux requérants, les autorités nationales auraient « exercé une fonction étatique de contrôle des frontières »[27]. En effet, le droit international reconnaît selon les requérants la compétence de l’État de « fixe[r] les conditions d’accès à son territoire, les conditions de séjour et d’établissement » et de « statue[r] sur des demandes de visas »[28] formulées par des étrangers souhaitant entrer sur le territoire national. Ce point ne pose pas de problème, la Cour reconnaissant elle-même « le principe bien établi en droit international (…) selon lequel les États parties ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux »[29]. À partir de là, les requérants soutiennent que le refus de délivrance des visas opposé par les autorités nationales s’analyse en un exercice de la compétence de l’État en matière d’immigration, et donc en un exercice de « juridiction » au sens de l’article 1er. Il s’agit de lier l’exercice de la « compétence » que le droit international public reconnaît à l’État et l’exercice de la « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention – lien que la Cour avait commencé à faire, avec beaucoup de maladresse, dans la décision Bankovic[30]. Et l’argument fonctionne : on voit mal comment un État pourrait à la fois exercer légalement une compétence que le droit international lui reconnaît et se soustraire à ses obligations internationales en matière de droits de l’homme au motif qu’il n’exerce pas sa « juridiction » sur les requérants – à l’égard desquels il exerce pourtant sa « compétence »…
Cet argument permet de passer outre la question – vaine tant que l’on n’en précise pas les termes – de la « territorialité » ou de l’« extraterritorialité » : un État exerce sa « juridiction » au sens de l’article 1er chaque fois qu’il exerce une « compétence » (normative, exécutive ou juridictionnelle)[31] que lui reconnaît le droit international public, « quel que soit le lieu où elle est exercée et les autorités (…) qui [la] mettent en œuvre »[32], comme le disent les avocats des requérants. Cela ne signifie bien évidemment pas qu’un État exerce sa « juridiction » uniquement lorsqu’il exerce une « compétence » que lui reconnaît le droit international public – ce qui constituerait un effet pervers de l’argument, car il oblitérerait les cas où un État exerce sa « juridiction » à l’égard de personnes en dehors de la compétence que lui reconnaît le droit international public, c’est-à-dire illégalement[33] –, mais qu’un État exerce sa « juridiction » au moins dans ces cas-ci.
Au soutien de leur argumentation, les requérants peuvent se tourner vers une jurisprudence éparpillée mais foisonnante, n’ayant jamais (à notre connaissance) fait l’objet de systématisation, dans laquelle la Cour reconnaît, explicitement ou non, que des décisions prises exclusivement sur le territoire national puissent affecter la situation de personnes situées en dehors du territoire de l’État et faire relever celles-ci de sa « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention. L’affaire qui vient immédiatement à l’esprit, c’est l’affaire Nada c. Suisse, que les requérants ont cité à l’audience mais qui n’apparaît pas dans le résumé de leurs arguments dans la décision. Cette affaire concernait le rejet par les autorités administratives suisses des demandes formulées par un ressortissant italo-égyptien d’entrer sur le territoire suisse pour recevoir des soins. La Cour de Strasbourg s’est appuyée sur le fait que « les demandes formées par le requérant aux fins de bénéficier d’une dérogation à l’interdiction d’entrer sur le territoire suisse ont été rejetées par des autorités suisses »[34] pour conclure que « les mesures litigieuses ont été prises par l’Etat suisse dans l’exercice de sa « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention »[35]. La Cour conclut que « [l]es actes ou omissions litigieuses sont donc susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat défendeur en vertu de la Convention »[36]. Les faits sont parfaitement analogues au cas d’espèce, et la solution pourrait être reproduite mutatis mutandis.
Il existe en réalité un nombre très important d’affaires qui vont dans le sens des requérants. Que l’on pense aux affaires dans lesquelles un État exerce sa « compétence pénale » vis-à-vis de personnes situées en dehors de son territoire[37] ; aux affaires dans lesquelles un État condamne par contumace une personne résidant à l’étranger[38] ; aux affaires dans lesquelles des personnes introduisent une instance devant les juridictions d’un État dans lequel ils ne résident pas[39] ; aux affaires dans lesquelles un État requiert l’extradition d’une personne située – par définition – hors du territoire de l’État requérant[40] ; ou encore aux affaires relatives au droit des nationaux d’entrer sur le territoire de l’État dont ils ont la nationalité[41] : dans toutes ces affaires, la Cour reconnaît au moins implicitement qu’un État exerçant sa compétence normative, exécutive ou juridictionnelle puisse affecter la situation de personnes situées en dehors de son territoire et donc faire relever celles-ci de sa « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention. Peut-être est-ce la première fois que l’argument présenté par les requérants l’est de manière aussi directe, mais en tout cas, il s’ancre parfaitement dans la jurisprudence de la Cour. Cela n’empêchera pas celle-ci de le rejeter.
B. Le maintien d’un seuil d’applicabilité élevé de la Convention aux actes nationaux déployant leurs effets en dehors du territoire de l’État
L’argumentation des requérants ne convaincra pas les juges de Strasbourg. Le paragraphe décisif de la décision commençait pourtant bien, avec la reconnaissance par la Cour du fait que, en prenant « des décisions portant sur les conditions d’entrée sur le territoire belge », les autorités nationales « ont, de ce fait, exercé une prérogative de puissance publique »[42]. On voit mal comment la Cour pourrait refuser que les requérants relèvent de la « juridiction » de la Belgique après un tel constat ; cela signifierait que certaines prérogatives de puissance publique échappent aux obligations internationales de l’État en matière de droits de l’homme.
Et pourtant, la Cour estime que « à lui seul, ce constat [de l’exercice par les autorités belges de prérogatives de puissance publique] ne suffit pas à attirer les requérants sous la juridiction « territoriale » de la Belgique au sens de l’article 1er de la Convention »[43]. Passons pour le moment sur l’insertion du mot « territoriale », qui ne fait que rendre les choses confuses, pour voir que la Cour adopte une position de principe, dont la portée s’étend bien au-delà de la présente affaire : « La seule circonstance que des décisions prises au niveau national ont eu un impact sur la situation de personnes résidant à l’étranger n’est pas davantage de nature à établir la juridiction de l’État concerné à leur égard en dehors de son territoire »[44]. La Cour refuse ainsi de considérer qu’un acte de l’État reflétant l’exercice d’une prérogative de puissance publique – ici, le contrôle de l’entrée des étrangers sur le territoire national –, dont il est avéré qu’il affecte la situation de personnes situées en dehors du territoire, constitue un exercice de « juridiction » au sens de l’article 1er. À ce titre, il faut noter la faiblesse de l’argumentation de l’État défendeur. Celui-ci arguait que la décision de refus de délivrance des visas « humanitaires » n’avait « pas (…) produit des effets en dehors du territoire », ces décisions « ayant eu pour seul effet de ne pas permettre aux requérants d’entrer sur le territoire belge pour un court séjour, sans aucune incidence sur leur situation au Liban ou en Syrie »[45]. La contradiction est consommée : tout en affirmant que la décision des autorités belges n’a pas produit d’effet en dehors du territoire, l’État défendeur reconnaît pourtant que les actes litigieux ont bel et bien affecté la situation des requérants et a donc produit des effets sur ceux-ci et sur leur situation au Liban et en Syrie, du simple fait… qu’ils y soient toujours, et dans des conditions peu enviables, si l’on en croit leurs avocats.
La Cour pose donc pour principe que la décision de l’État de refuser l’entrée sur le territoire à des étrangers situés en dehors de celui-ci n’entraîne pas d’exercice de la « juridiction » au sens de l’article 1er. La Cour adopte ainsi une solution rigoureusement opposée à celle de l’affaire Nada c. Suisse, à laquelle la Cour ne fait étrangement pas référence dans le corps du texte, malgré son invocation par les requérants.
La Cour va néanmoins prévoir deux exceptions au principe selon lequel les décisions de l’État de refuser l’entrée sur le territoire à des étrangers situés en dehors de celui-ci n’entraînent pas d’exercice de la « juridiction » de l’État. D’une part, un État peut exercer sa « juridiction » au sens de l’article 1er dans une telle situation lorsqu’il « a effectivement exercé son autorité ou son contrôle »[46] sur les requérants. La Cour revient donc, dans une situation qui a peu à voir avec l’arrêt Al-Skeini, à l’un des fondements de l’exercice de la « juridiction » dégagé dans cet arrêt : un État exerce sa juridiction sur des personnes situées en dehors du territoire national chaque fois qu’il exerce son « autorité » ou son « contrôle » sur des personnes[47]. Pour rappel, les cas classiques visés par cette catégorie sont ceux relatifs à l’usage de la force militaire en dehors du territoire[48] ou à l’arrestation[49] et à la détention[50] en dehors du territoire national.
Cette première exception n’est pas sans aucun lien avec la présente affaire puisque, comme nous l’avons vu, des agents de l’État – les services diplomatiques et consulaires de l’ambassade de Belgique au Liban – sont bien présents en dehors du territoire national et en contact direct avec les requérants, qui se sont rendus à l’ambassade pour y déposer leur demande de visa. Cependant, les services diplomatiques et consulaires belges n’ont en réalité tenu « qu’un rôle de « boite aux lettres » »[51], comme le dit elle-même la Cour : ils n’ont à aucun moment pris des décisions affectant la situation des requérants. Ces derniers peuvent bien prétendre que « les fonctions consulaires de réception et de délivrance des visas » s’analyse en « une forme de contrôle ou d’autorité exercé (…) à leur égard »[52], mais on voit bien que l’analogie avec les affaires visées par l’arrêt Al-Skeini est impossible : il était question, dans ces affaires, de contrainte physique, de contrôle sur les corps. La Cour conclut logiquement que les agents diplomatiques « n’ont à aucun moment exercé un contrôle de fait sur la personne des requérants », ceux-ci ayant « librement choisi » de se présenter à l’ambassade de Belgique à Beyrouth pour y présenter leur demande et ayant « pu librement quitter les locaux de l’ambassade belge sans rencontrer aucune entrave »[53].
La Cour pose ensuite une seconde exception, bien plus pertinente pour la présente affaire, au principe selon lequel la délivrance de visa d’entrée sur le territoire à des personnes situées en dehors du territoire national ne fait pas passer celles-ci sous la « juridiction » de l’État. Il faut « s’interroger, dit la Cour, sur la nature du lien entre les requérants et l’État défendeur »[54]. La Cour ne précise pas a priori quels types de « liens » pourraient entraîner un exercice de juridiction, mais nous allons le découvrir assez vite. La Cour relève en effet que « les requérants ne se sont jamais trouvés sur le territoire national de la Belgique et qu’ils ne revendiquent aucune vie familiale ou privée préexistante avec ce pays »[55]. Ainsi, la solution d’espèce de la Cour aurait été toute autre si les requérants s’étaient déjà rendus en Belgique et/ou disposaient de liens familiaux avec des personnes résidant en Belgique. Il faut noter à ce stade que la solution eut également été bien différente si les requérants étaient des ressortissants de l’État cherchant à entrer sur le territoire du pays dont ils ont la nationalité. En effet, l’article 3§2 du Protocole n°4 énonce que « [n]ul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant » : les ressortissants d’un État ont le droit – absolu, révèlent les travaux préparatoires[56] – d’entrer sur le territoire de leur État de nationalité. Si la Cour ne traite pas explicitement du lien de nationalité qui pourrait exister entre les requérants et l’État – elle relève à un endroit que « les requérants n’étaient pas des ressortissants belges demandant à bénéficier de la protection de leur ambassade »[57], mais dans un tout autre but – c’est, semble-t-il, uniquement parce que cela n’a pas de rapport avec le cas d’espèce, qui portait sur une demande de visa, ce qui est sans pertinence pour des ressortissants d’un État qui disposent normalement de leur passeport. En tout état de cause, les ressortissants d’un État pourraient entrer sans problème dans cette exception posée par la Cour, puisque l’écrasante majorité des ressortissants d’un État s’y sont déjà rendus et y ont une vie familiale.
La Cour rejette également les arguments secondaires formulés par les requérants. Ceux-ci estimaient, en s’appuyant sur la jurisprudence Soering, qu’un État partie pouvait « être tenu responsable des conséquences extraterritoriales de décisions qu’il prend en cas de risque de torture ou de mauvais traitement ou d’omissions à lui attribuables de prendre des mesures en vue de prévenir ou d’empêcher l’exposition à de tels risques »[58]. La Cour se contente de distinguer l’affaire Soering de la présente affaire (qui serait « fondamentalement différente »[59]), la différence tenant en ce que dans l’affaire Soering, la requérant se trouvait sur le territoire de l’État prêt à être expulsé vers un autre État où il pourrait subir des traitements contraires à l’article 3 – soit l’exact inverse de la présente affaire, où des personnes subissant des traitements contraires à l’article 3 dans un État cherchent à le fuir pour trouver refuge dans un autre État. De plus, la Cour rejette l’argument, fondé sur la jurisprudence Markovic et autres c. Italie, selon lequel les requérants relevaient de la « juridiction » de la Belgique puisqu’ils y ont saisi des tribunaux qui se sont déclarés compétents et ont acceptés de connaître de l’affaire. La Cour rejette cet argument sous l’angle de l’article 3 – nous reviendrons par la suite sur son (non) traitement de cet argument sous l’angle de l’article 6 –, au motif que dans l’affaire Markovic, la Cour avait accepté qu’un État exerce sa « juridiction » lorsque ses tribunaux connaissent d’une affaire dont le demandeur est situé hors du territoire national uniquement sous l’angle du droit à un procès équitable (article 6). La Cour rejette enfin le parallèle avec l’affaire Güzelyurtlu, dans lequel la Cour avait accepté de reconnaître qu’un État dont les autorités d’enquête connaissaient d’une infraction commise en dehors du territoire national exerçait sa « juridiction » sur les personnes concernées par cette enquête, au motif que dans cette affaire, la procédure « était une procédure pénale ouverte à l’initiative des autorités turques »[60], et non à l’initiative des requérants.
Cet exercice d’équilibriste consistant à distinguer la présente affaire de toutes les affaires ayant un lien potentiel avec les faits de l’espèce – et elles ne manquent pas, comme nous l’avons vu plus haut – ne vaut cependant que pour les analogies formulées par les requérants. En effet, la Cour va fonder sa décision sur la seule affaire qu’invoque l’État défendeur, la décision Abdul Wahab Khan c. Royaume-Uni[61]. Dans cette affaire, la Cour avait jugé qu’un ressortissant pakistanais situé au Pakistan au moment de l’affaire s’étant vu retirer son autorisation de séjour au Royaume-Uni sur le fondement de suspicion d’appartenance à une organisation terroriste ne relevait pas de la « juridiction » du Royaume-Uni. Cette décision montrait, dit la Cour dans une lecture rétrospective, que « le simple fait pour un requérant d’initier une procédure dans un État partie avec lequel il n’a aucun lien de rattachement ne pouvait suffire à établir la juridiction de cet État à son égard »[62]. Fort de ce précédent, la Cour déclarera donc la requête irrecevable au motif que les requérants ne relevaient pas de la juridiction de la Belgique au sens de l’article 1er de la Convention.
La décision de la Cour dans le cas d’espèce semble reposer sur deux arguments conséquentialistes puissants, habilement maniés par l’État défendeur et les États tiers-intervenants. Le premier consiste à dire que toute décision de la Cour en faveur des requérants aurait des conséquences désastreuses pour le système européen de l’asile et de l’immigration – sur ce point, le gouvernement de Théo Francken et les gouvernements représentés par leurs agents devant la Cour – Allemagne, Croatie, Danemark, France, Hongrie, Lettonie, Pays-Bas, Norvège, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie – sont en parfait accord. Tout en reconnaissant, dans une formule emphatique à ranger au rayon de l’humanitarisme creux, que « la situation en Syrie suscite une profonde compassion » – comme si nous étions égaux devant notre capacité à agir face à cette « tragédie » –, les États tiers-intervenants insistent sur le fait que le système international d’asile et d’immigration exige « une coopération et un contrôle internationaux » afin de « fonctionner efficacement dans l’intérêt de ceux qui ont besoin d’une protection internationale », et que toute décision en faveur des requérants « perturber[ait] le système [d’asile et d’immigration] en introduisant [d]es éléments de désordre et d’instabilité »[63]. Pour le dire plus clairement, les États s’inquiètent de ce que leurs ambassades et consulats puissent être pris d’assaut par des ressortissants étrangers qui formuleraient des demandes de visa court séjour sur la base de l’article 25 du code communautaire des visas afin de demander l’asile une fois arrivés sur le territoire national[64].
Mais au-delà du système d’asile, les États s’inquiètent de la portée « universelle » que pourrait revêtir la Convention si la Cour faisait droit aux arguments des requérants. L’agent du gouvernement britannique défend ainsi adroitement lors de l’audience l’idée que la thèse des requérants revient à admettre que le lien de juridiction puisse être « auto-créé par l’individu » introduisant une demande auprès de l’administration d’un État (en matière d’immigration ou autre), « où qu’il se trouve dans le monde, sans qu’aucun acte d’autorité ou exercice de juridiction de la part de l’État ne soit intervenu pour créer ce lien »[65]. Dans sa décision, la Cour amplifie cet argument en lui donnant un accent dramatique : accepter l’argumentation des requérants reviendrait à « consacrer une application quasi-universelle de la Convention sur la base du choix unilatéral de tout individu, où qu’il se trouve dans le monde (…) »[66]. Qui pourrait bien vouloir d’une conséquence aussi radicale ?
II. Une décision affaiblie par la confusion entre l’applicabilité de la Convention et l’existence d’obligations internationales à la charge de l’État
Si elle rassure les États défendeurs et tiers-intervenants, la décision de la Cour européenne des droits de l’homme opère néanmoins une confusion fâcheuse entre deux étapes du raisonnement judiciaire, puisque la Cour lie l’applicabilité de la Convention à l’existence d’une obligation positive de délivrer des visas « humanitaires » (A). Il était en réalité possible pour la Cour d’emprunter une voie alternative, respectueuse de la séparation entre l’applicabilité de la Convention et l’existence d’obligations à la charge de l’État tout en parvenant à la même solution (B).
A. L’affirmation par la Cour d’un lien entre exercice de « juridiction » et existence d’une obligation positive de délivrer des visas « humanitaires »
Nous concluions la première partie en citant les juges de Strasbourg, qui motivaient leur rejet de la thèse des requérants par l’argument conséquentialiste suivant : la thèse des requérants reviendrait à « consacrer une application quasi-universelle de la Convention sur la base du choix unilatéral de tout individu, où qu’il se trouve dans le monde »[67]. Cependant, nous n’avons pas cité la décision de la Cour jusqu’au bout. En effet, celle-ci poursuit : « … où qu’il se trouve dans le monde, et donc à créer une obligation illimitée pour les États parties d’autoriser l’entrée sur leur territoire de toute personne qui risquerait de subir un traitement contraire à la Convention en dehors de leur juridiction »[68]. La Cour estime donc que la reconnaissance de l’exercice par la Belgique de sa « juridiction » sur les requérants du fait de la décision de refus de délivrance des visas « humanitaires » aurait nécessairement pour conséquence (« et donc ») la reconnaissance d’une nouvelle obligation (la Cour parle de « créer une obligation ») à la charge des États parties « d’autoriser l’entrée sur leur territoire » de toute personne alléguant subir des traitements contraires à l’article 3 dans son pays d’origine – c’est-à-dire hors du territoire national belge.
La Cour cite à l’appui de cet argument le paragraphe 27 de la décision Abdul Wahab Khan c. Royaume-Uni. Cependant, dans le passage pertinent de ce paragraphe, ce n’était pas la reconnaissance de l’exercice par l’État de sa « juridiction » qui entrainait la reconnaissance d’une obligation ; c’était la « transposition » de l’« obligation limitée de l’article 8 » de procéder à la réunification familiale[69] sur le plan de l’article 3 dont il était dit qu’elle (la transposition) « créerait une obligation illimitée pour les États contractants d’autoriser l’entrée sur leur territoire de tout individu qui risquerait de subir un traitement contraire à l’article 3, indépendamment de la question de savoir où l’individu se trouve dans le monde »[70]. Autrement dit, cette décision n’opérait pas la confusion entre la question de l’exercice par l’État de sa juridiction et l’existence d’obligations internationales à la charge de l’État, entre l’applicabilité de la Convention européenne des droits de l’homme et les obligations internationales qui découlent pour l’État de son applicabilité ; elle se contentait de projeter sur l’article 3 une obligation existant dans le cadre de l’article 8. En faisant le lien entre exercice de « juridiction » et existence d’une obligation internationale, l’affaire M.N. c. Belgique constitue clairement une innovation.
La Cour insiste largement sur ce lien dans la décision commentée. En effet, elle affirme que « [s]i la circonstance qu’un État partie se prononce sur une demande en matière d’immigration suffisait à faire relever le demandeur de sa juridiction, il pourrait en résulter une telle obligation [l’obligation d’autoriser l’entrée sur le territoire des personnes alléguant subir des traitements contraire à l’article 3 dans leur pays d’origine] »[71]. Elle continue son scénario fictif en disant que « [l]e demandeur pourrait créer un lien juridictionnel en déposant une demande où qu’il se trouve et donner ainsi naissance, le cas échéant, à une obligation au titre de l’article 3 qui n’existerait pas autrement »[72]. Le lien que fait la Cour entre la reconnaissance de l’exercice de « juridiction » par la Belgique et la reconnaissance d’une obligation positive de délivrer des visas « humanitaires » sur le fondement de l’article 3 trouve son paroxysme dans le paragraphe 124, qu’il convient de citer in extenso :
« Une telle extension du champ d’application de la Convention aurait en outre pour effet de réduire à néant le principe bien établi en droit international et reconnu par la Cour selon lequel les États parties ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux, sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, y compris la Convention (…) »[73].
Si l’on suit la Cour, la reconnaissance de l’exercice par la Belgique de sa « juridiction » dans le cas d’espèce étendrait le champ d’application de la Convention et conduirait donc à la reconnaissance d’une obligation positive pour l’État belge d’autoriser l’entrée des requérants sur son territoire, ce qui mettrait à mal le « droit » des États « de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement » des étrangers. En réalité, ce raisonnement ne tient pas debout et la Cour le sait fragile, pour ne pas dire incohérent ; il suffit de voir comment sa certitude s’étiole au fil de son argumentation. Alors qu’elle laisse à croire dans un premier temps que ce lien est nécessaire, presque inévitable (c’est ce que laisse croire le connecteur « et donc » utilisé au paragraphe 123), elle se ravise rapidement pour tempérer ses propos. Reconnaître l’exercice par la Belgique de sa juridiction à l’égard des requérants « pourrait » donner naissance à une telle obligation, dit la Cour ; puis, elle reconnaît à demi-mot que ce lien n’a rien de nécessaire en disant que, finalement, une telle obligation n’existerait que « le cas échéant ».
Mais suivons la Cour un instant. Si l’on se penche sur la jurisprudence relative aux obligations positives de l’État de prévenir ou d’empêcher la commission de traitements contraires à l’article 3, il pourrait en effet sembler qu’il existe un lien nécessaire entre « exercice de juridiction » et « obligation positive de prévenir et d’empêcher les actes de torture se déroulant sous la juridiction de l’État ». Citons par exemple la jurisprudence Opuz c. Turquie :
« Quant à la question de savoir si l’Etat peut être tenu pour responsable, au regard de l’article 3, de mauvais traitements infligés par des acteurs non étatiques, la Cour rappelle que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures, à des traitements ou à des châtiments inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (…) »[74].
Au regard de ce paragraphe, il semble en effet que les obligations de l’État au titre de l’article 3 (ou en réalité, de n’importe quel autre article) soient coextensives du champ d’application de la Convention : puisque les États ont des obligations, y compris positives, vis-à-vis de toute personne « relevant de leur juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention, alors chaque fois que l’on étend le champ d’application de la Convention, on étend le champ des obligations de l’État. Les avocats des requérants n’auraient qu’à tenir l’argumentation suivante : les requérants « relèvent de la juridiction » de la Belgique au sens de l’article 1er de la Convention du fait de la décision de refus de délivrance des visas court séjour ; l’État a par conséquent l’obligation, résultant de la combinaison des articles 1 et 3 de la Convention, de « prendre des mesures propres à empêcher que les personnes relevant de leur juridiction ne soient soumises à des tortures, à des traitements ou à des châtiments inhumains ou dégradants », ce qui consiste, en l’espèce, en l’octroi de visas permettant aux requérants d’entrer sur le territoire national et d’y déposer une demande d’asile.
Cependant, ce lien n’est en rien nécessaire. Ce n’est pas parce que l’on étend le champ d’application de la Convention que l’on étend le champ des obligations de l’État. En effet, même si la Convention est applicable à une situation spécifique, encore faut-il que l’État ait une obligation d’agir (ou de ne pas agir) dans un sens déterminé ; et cela ne peut se faire que si la Cour reconnaît l’existence d’une telle obligation. Ces deux étapes sont logiquement séparées. Or, comme le disent avec raison les États défendeurs et tiers-intervenants lors l’audience, la Cour n’a jamais reconnu l’existence d’une obligation positive sous l’angle de l’article 3 d’empêcher, de prévenir ou de mettre fin à des traitements contraires à l’article 3 se déroulant en dehors du territoire national. Plus encore, la Cour n’a jamais reconnu l’existence d’une obligation positive de délivrer des visas (« humanitaires » ou non) afin d’autoriser l’entrée sur le territoire national[75]. Bien au contraire, la Cour affirme avec force dans sa jurisprudence que « la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit pour un individu d’entrer sur un territoire dont il n’est pas ressortissant »[76] et reconnaît même le « droit » des États « de contrôler l’entrée des étrangers sur leur sol »[77]. Et de manière générale, la Cour européenne des droits de l’homme n’a jamais reconnu l’existence d’une obligation positive d’agir en dehors du territoire national, pour des raisons diplomatiques évidentes[78].
La Cour, qui s’adonne volontiers à la technique du distinguo dès lors qu’il s’agit des affaires présentées par les requérants au soutien de leurs arguments, aurait tout à fait pu distinguer les jurisprudences telles que Opuz c. Turquie, où les actes contraires à l’article 3 ont eu lieu sur le territoire de l’État contractant, et la présente affaire, où les actes contraires à l’article 3 ont eu lieu en dehors du territoire national, dans une zone de guerre où aucun agent de l’État belge (par exemple, ses forces armées) n’est présent. Il faut reconnaître que les deux situations n’imposent pas la même « charge » ni le même « fardeau » à l’État – quand bien même ce « fardeau » (la délivrance de visas et l’accueil des étrangers sur le territoire) pourrait bien n’être pas si « excessif » que cela…
En tout état de cause, nous voyons que la reconnaissance de l’exercice par la Belgique de sa « juridiction » n’entraîne pas ispo facto l’existence d’une obligation à la charge de l’État de délivrer des visas « humanitaires » afin d’empêcher, de prévenir ou de mettre fin à des traitements contraires à l’article 3 se déroulant en dehors du territoire national. Ce sont deux étapes distinctes du raisonnement judiciaire. L’exercice par l’État défendeur de sa « juridiction » est, comme le dit la Cour, une « condition sine qua non »[79], une condition préalable à l’examen de la conformité des actes et des omissions de l’État avec ses obligations internationales. Ce constat ouvre la voie d’une solution alternative, respectueuse de la séparation entre l’applicabilité de la Convention et l’existence d’obligations à la charge de l’État, qui parviendrait au même résultat.
B. L’existence d’une voie alternative maintenant la séparation entre l’applicabilité de la Convention et l’application des obligations de l’État tout en parvenant au même résultat
Dans cette dernière partie, nous allons suggérer une voie alternative que la Cour aurait pu emprunter et qui aurait été bien plus respectueuse de la séparation entre le plan de l’applicabilité de la Convention et le plan des obligations internationales de l’État, tout en parvenant au résultat que la Cour cherchait manifestement à atteindre, à savoir rejeter la requête des requérants et rassurer les États inquiets face à l’épouvantail – si souvent agité mais si peu observé – de l’« appel d’air ».
Cette voie alternative nous est suggérée par le traitement que la Cour fait des demandes des requérants relatives à la violation des articles 6 et 13, causée par l’impossibilité d’exécuter la décision du Conseil du contentieux des étrangers du 20 octobre 2016 enjoignant l’État belge à délivrer des visas ou un laissez-passer aux requérants. Si l’on suit le raisonnement classique de la Cour, elle doit, préalablement à tout examen de la violation par l’État de ses obligations, vérifier si celui-ci exerce sa « juridiction » vis-à-vis des requérants – c’est une « condition sine qua non »[80], dit-elle quelques paragraphes plus haut. Et pourtant, les juges de Strasbourg vont se dispenser de cette étape eu égard aux demandes formulées sur le fondement des articles 6 et 13. Selon la Cour, « il n’y a pas lieu à statuer » sur la question de savoir « si la Belgique au sens de l’article 1er de la Convention à l’égard des requérants s’agissant des procédures intentées sur son territoire national » étant donnée « la conclusion à laquelle [la Cour] parvient quant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 » [81]. Cette conclusion, c’est évidemment que l’article 6 § 1 n’est pas applicable au cas d’espèce. Une fois n’est pas coutume, la Cour suit l’argumentation de l’État défendeur : le droit en cause – le droit d’entrer sur le territoire national – n’est pas un droit « civil » comme l’exige l’article 6 § 1, mais un « droit de nature politique »[82], qui échappe en tant que tel au droit à un procès équitable[83]. La Cour fait sien cet argument en affirmant que le droit faisant l’objet du litige, à savoir le droit d’« entre[r] sur le territoire belge », ne met pas « en jeu un droit de caractère « civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention »[84].
Les juges de Strasbourg déclarent donc les demandes relatives aux articles 6 § 1 et 13 irrecevables sans même avoir examiné la « condition sine qua non » de l’exercice par l’État de sa « juridiction ». La Cour esquive tout simplement cette question. Pourquoi donc ? La réponse semble évidente : si elle avait dû affronter cette question, la Cour n’aurait pas pu ne pas reconnaître l’exercice par la Belgique de sa juridiction dans le cas d’espèce. En effet, la Cour avait affirmé sans ambages dans l’arrêt Markovic et autres c. Italie que « à partir du moment où une personne introduit une action civile devant les juridictions d’un Etat, il existe indiscutablement un « lien juridictionnel » au sens de l’article 1 de la Convention »[85]. Or, il était précisément question en l’espèce de l’action en exécution de la décision rendue par le Conseil du contentieux le 20 octobre 2016 (et de l’arrêt de la Cour d’appel le confirmant) enjoignant l’État belge à délivrer des visas ou un laissez-passer aux requérants, soit un exemple typique d’« action civile » au sens de la jurisprudence Markovic. Contrairement aux demandes formulées sur le fondement des articles 3 et 13, il était ici incontestable que la Belgique exerçait sa juridiction sur les requérants. Le simple fait que les requérants soient situés à l’étranger n’est pas une raison pour exempter l’État de ses obligations de respecter le droit à un procès équitable, comme le dit la Cour dans l’arrêt Markovic. Seulement, voilà : la Cour fait fi de cette étape et se contente de déclarer que l’article 6 § 1 n’est pas applicable, et donc que les requérants n’ont aucun droit à un procès équitable et l’État aucune obligation correspondante.
Ce faisant, elle montre que la question de l’exercice ou du non-exercice par l’État de sa « juridiction » n’est pas si déterminant qu’elle le disait lors de l’étude des allégations relatives aux articles 3 et 13 : il est tout à fait possible qu’un État exerce sa juridiction vis-à-vis de personnes et qu’il n’ait pas d’obligations à leur égard. Ici, si l’on suit la jurisprudence de la Cour, la Belgique exerce bel et bien sa « juridiction » à l’égard des requérants pourtant situés en dehors du territoire national car les tribunaux belges ont accepté de connaître d’une action civile qu’ils ont introduite, et pourtant la Belgique n’a pas d’obligation spécifique à leur égard et ceux-ci n’ont aucun droit vis-à-vis de la Belgique. Cette solution est transposable mutatis mutandis à la demande des requérants fondée sur les articles 3 et 13 : la Cour aurait parfaitement pu, d’une part, reconnaître qu’en refusant de délivrer des visas d’entrée sur le territoire national, la Belgique a exercé sa « juridiction » vis-à-vis des requérants, mais d’autre part, qu’il n’existait sous l’angle de l’article 3 aucune obligation positive imposant à l’État de délivrer des visas « humanitaires » afin d’empêcher, de prévenir ou de mettre fin à des traitements contraires à l’article 3 se déroulant hors de son territoire.
Cette voie alternative présente l’avantage majeur de ne pas créer de « matières d’exception » auxquelles la Convention européenne des droits de l’homme ne serait pas applicable. Car c’est en réalité ce que la Cour fait dans sa décision relative aux articles 3 et 13. En effet, celle-ci aménage une sorte d’espace réservé à la libre expression de la raison d’État : les États n’exercent pas leur « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention lorsqu’ils refusent de délivrer des visas d’entrée sur le territoire national à des personnes situées en dehors de celui-ci ; l’obligation générale de l’article 1er de « reconnaître » à ces personnes les « droits et libertés » garantis par la Convention et ses protocoles ne s’impose donc pas aux autorités de l’État, qui peuvent agir l’esprit libre, alors même que leurs décisions ont des conséquences concrètes sur la situation de personnes : elles ne sont pas susceptibles de voir leur responsabilité engagée au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, puisque celle-ci ne leur est tout simplement pas opposable. La Cour crée donc un espace où les conditions de possibilité de l’existence d’obligations pour les autorités étatiques et de droits pour les personnes privées ne sont pas réunies.
Pourtant, cette solution se heurte à deux arguments que nous avons déjà esquissés dans les lignes qui précèdent : est-il acceptable que la Convention ne soit pas applicable à des situations où il est reconnu sans problème que l’État exerce une « prérogative de puissance publique » que le droit international lui reconnaît ? Et est-il acceptable que la Convention ne soit pas applicable à des situations dans lesquelles il est avéré que l’État exerce son pouvoir sur la situation de personnes privées et affecte effectivement leurs conditions d’existence ? De notre point de vue, il est nécessaire que la Convention européenne des droits de l’homme s’applique à toutes les actions des agents de l’État, dès lors que ces actions sont des expressions des prérogatives dévolues à l’État et qu’elles affectent la situation de personnes privées.
Cela ne signifie bien évidemment pas un droit des personnes à ce que l’État satisfasse le moindre de leur désir, ni une obligation de l’État de ne jamais rien faire qui aille à l’encontre des souhaits de ces personnes : les obligations que le droit international des droits de l’homme impose à l’État sont limitées en nombre et dans leur portée, et la Cour recherche constamment un équilibre entre les droits subjectifs des personnes privées et les droits subjectifs de l’État ou de la « société démocratique » – ici, la Cour protège les droits de l’État face aux prétentions des requérants, qui auraient pour effet de « réduire à néant (…) le droit [de l’État] de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux »[86]. Cela signifie simplement qu’il n’est pas acceptable que la Cour nie la possibilité même qu’un État ait des obligations et que des personnes aient des droits au motif – parfaitement arbitraire par ailleurs, et sans précédent notable dans la jurisprudence de la Cour – que ceux-ci ne se sont jamais rendus sur le territoire belge et « qu’ils ne revendiquent aucune vie familiale ou privée préexistante avec ce pays »[87]. Qu’ils n’aient pas de droit acquis à obtenir un visa et à entrer sur le territoire national est une chose, qu’on leur nie la possibilité même d’avoir des droits du simple fait qu’ils soient étrangers et situés en dehors du territoire national, et alors même que l’administration belge prend des décisions en application de son pouvoir légal de contrôle de l’immigration qui leurs sont expressément adressées et qui affectent leur situation est tout à fait inacceptable. Pourquoi une personne visée par une décision individuelle de l’administration serait-elle plus susceptible de « relever de la juridiction » de l’État au sens de l’article 1er de la Convention si elle se trouve dans ou hors du territoire ? Et pourquoi, entre deux personnes se trouvant hors du territoire visées par une même décision, une personne s’étant déjà rendue territoire national et/ou ayant une vie familiale ou privée sur le territoire de l’État relèverait-elle de la « juridiction » de l’État et pas l’autre ? Tout cela semble parfaitement arbitraire, et semble avoir pour seul objet de répondre à l’inquiétude selon nous infondée des États : ce n’est pas parce que la Cour reconnaît qu’ils exercent leur juridiction qu’ils ont nécessairement des droits correspondants à la situation et aux demandes de la personne affectées par leurs décisions.
Si la notion de « juridiction » se réduit à l’exercice d’un pouvoir de fait par les autorités de l’État sur des personnes[88], que ce pouvoir soit exercé dans le cadre des compétences que le droit international reconnaît à l’État ou en dehors de celui-ci, alors il faut bien reconnaître que l’État exerce sa « juridiction » chaque fois qu’il adopte des décisions affectant la situation de personnes se trouvant sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, comme c’est le cas des requérants dans le cas d’espèce. Si l’on tient vraiment à formuler des critères précis, on peut par exemple ajouter que l’État exerce sa juridiction chaque fois que l’« impact potentiel » de l’acte ou de l’omission litigieux est « direct, important et prévisible »[89]. De notre point de vue, la question de la localisation territoriale des agents de l’État ou de la victime n’est pas déterminante : ce qui l’est, c’est l’exercice par l’État de son pouvoir d’affecter des vies. Toute décision contraire reviendrait à créer des espaces d’exception, où les agents de l’État, libérés de leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme, peuvent agir de manière entièrement discrétionnaire. La notion de « juridiction » doit suivre le pouvoir d’État partout où il se trouve – ce qui ne réduit pas le pouvoir d’État à néant, puisque les personnes ne jouissent pas de droits absolus et illimités à tout.
[1] « Plan for UK military to opt out of European Convention on human rights », The Guardian, 4 octobre 2016, disponible en ligne à l’adresse suivante: https://www.theguardian.com/uk-news/2016/oct/03/plan-uk-military-opt-out-european-convention-human-rights (dernière visite le 18 mai 2020)
[2] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, décision du 5 mai 2020, req. n°3599/18
[3] Union européenne, Règlement (CE) N°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, J.O.U.E., 15 juillet 2009, L 243/1, article 25, § 1 : « Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants: a) lorsqu’un État membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales ».
[4] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 15
[5] Ibid., § 19
[6] CJUE, X et Y c. État belge, arrêt du 7 mars 2017, affaire C-638/16 PPU
[7] « Visa à une famille d’Alep : Theo Francken refuse toujours d’appliquer la loi », RTBF, 8 décembre 2016, disponible à l’adresse suivante : https://www.rtbf.be/info/belgique/dossier/gouvernement-michel/detail_francken-persiste-et-signe-dans-son-refus-de-visas-a-la-famille-syrienne?id=9475871 (dernière visite le 18 mai 2020)
[8] Lors de l’audience du 24 avril 2019, les requérants dénoncèrent les manœuvres dilatoires et les procédures opaques utilisées par l’administration belge.
[9] La distinction entre les actes « accomplis en dehors du territoire national » et les actes « produisant des effets en dehors du territoire national » provient de l’arrêt Ilascu. Voir Cour EDH, affaire Ilascu et autres c. Moldova et Russie, arrêt du 8 juillet 2004, req. n°48787/99, §314.
[10] Cour EDH [GC], affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 2011, req. n°55721/07, §133 ; Cour EDH, affaire Drozd et Janousek c. France et Espagne, arrêt du 26 juin 1992, req. n°12747/87, § 91
[11] Voir notamment l’arrêt fondateur : Cour EDH, affaire Loizidou c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, req. n°15318/89. Pour les suites, voir notamment Cour EDH, affaire Salomou et autres c. Turquie, arrêt du 24 juin 2008, req. n°36832/97
[12] L’arrêt fondateur est l’arrêt Ilascu, op. cit. note 9. Pour les suites, voir notamment Cour EDH, affaire Pisari c. République de Moldova et Russie, arrêt du 21 avril 2015, req. n°42139/12 ; Cour EDH [GC], affaire Mozer c. République de Moldova et Russie, arrêt du 23 février 2016, req. n°11138/10
[13] Voir Cour EDH [GC], affaire Chiragov et autres c. Arménie, arrêt du 16 juin 2015, req. n°13216/05
[14] Voir Cour EDH , affaire Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 2010, req. n°61498/08 ; Cour EDH [GC], affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, op. cit. note 10 ; Cour EDH [GC], affaire Hassan c. Royaume-Uni, arrêt du 16 septembre 2014, req. n°29750/09 ; Cour EDH [GC], affaire Jaloud c. Pays-Bas, arrêt du 20 novembre 2014, req. n°47708/08
[15] E. Delval, « La CEDH appelée à trancher la question des « visas d’asile » laissée en suspens par la CJUE : lueur d’espoir ou nouvelle déception ? », EU Migration Law Blog, 12 février 2019, article disponible à l’adresse suivante : https://eumigrationlawblog.eu/la-cedh-appelee-a-trancher-la-question-des-visas-asile-laissee-en-suspens-par-la-cjue-lueur-despoir-ou-nouvelle-deception/ (dernière visite le 18 mai 2020)
[16] Voir par exemple le Parlement européen, qui a demandé en décembre 2018 à la Commission européenne de présenter avant le 31 mars 2019 une proposition législative mettant en place un visa humanitaire européen donnant accès au territoire de l’UE. Cette demande n’a, à notre connaissance, pas abouti. Voir Parlement européen, Résolution contenant des recommandations à la Commission sur les visas humanitaire, 11 décembre 2018, doc. n°2018/2271(INL)
[17] Voir l’audience du 24 avril 2019, disponible sur le site internet de la Cour : https://www.echr.coe.int/
[18] Voir notamment Cour EDH, affaire Loizidou c. Turquie, op. cit. note 11
[19] Sur les opérations de sécurité hors du territoire national, voir notamment Cour EDH [GC], affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, op. cit. note 10 ; sur les détentions, voir par exemple Cour EDH, affaire Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, op. cit. note 14, mais également Cour EDH [GC], affaire Medvedyev et autre c. France, arrêt du 29 mars 2010, req. n°3394/03
[20] Cela dit, il est clair que la Cour a construit sa jurisprudence « au fil de l’eau » ce qui peut donner l’impression d’une « jurisprudence patchwork », pour reprendre l’expression du juge Bonello dans sa (fameuse) opinion dissidente sous l’arrêt Al-Skeini. Pendant au moins dix ans (de la décision Bankovic à l’arrêt Al-Skeini), la jurisprudence fut dangereusement flottante. Et jusqu’à aujourd’hui, la Cour n’a pas développé de modèle englobant de la notion de juridiction – la présente affaire constitue justement l’occasion de le faire, comme nous le verrons dans la seconde partie.
[21] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 110
[22] Id.
[23] Ce que fait malheureusement le greffe de la Cour dans sa « fiche thématique » intitulée « Juridiction extraterritoriale des États parties », disponible à l’adresse suivante : https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Extra-territorial_jurisdiction_FRA.pdf (dernière visite le 18 mai 2020)
[24] Voir en ce sens la thèse de M. Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties. Law, Principles, and Policy, OUP, 2013, pp. 7-9 (où l’auteur définit l’extraterritorialité par rapport à la localisation de la victime : « Extraterritorial application simply means that at the moment of the alleged violation of his or her human rights the individual concerned is not physically located in the territory of the state party in question, a geographical area over which the state has sovereignty or title ») et la critique qu’en dresse Y. Shany, dans « Taking Universality Seriously: A Functional Approach to Extraterritoriality in International Human Rights Law », Law & Ethics of Human Rights, vol. 7, no. 1, 2013, pp. 47-71. Pour ce dernier, Milanovic insiste trop sur la “localization of victims” et non sur la “localization of the harmful activity and the functional capability of states to prevent it” (ibid., p. 63).
[25] L’arrêt fondateur est l’arrêt Ilascu, op. cit. note 9, §314.
[26] La définition du concept de « compétence de l’État » en droit international public fait l’objet d’un large consensus. La « compétence est « l’autorité de l’État, fondée et limitée par le droit international, de réglementer la conduite des personnes, physiques et morales, au travers de son propre droit national » (M. Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, op. cit. note 24, p. 23). On décline généralement la « compétence » en « compétence normative » (c’est le pouvoir de prescrire des règles), « compétence exécutive » (le pouvoir d’exécuter ces règles, par la force s’il le faut) et la « compétence juridictionnelle » (le pouvoir de juger les litiges relatifs aux règles édictées).
[27] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 83
[28] Id.
[29] Ibid., § 124
[30] Dans la décision Bankovic et autres c. Belgique et 16 autres, la Cour européenne des droits de l’homme assimile totalement la notion de « juridiction » présente à l’article 1er de la Convention avec la notion de « compétence » en droit international public, et laisse sous-entendre qu’il s’agit d’une seule et même chose – il faut dire que les deux termes étant synonymes en anglais (« jurisdiction »), la confusion était tentante (Cour EDH, affaire Bankovic et autres c. Belgique et 16 autres, décision du 12 décembre 2001, req. n°52207/99, §§ 59 ss.). Cependant, comme l’a très bien montré Marko Milanovic, non seulement la notion de « juridiction » de l’article 1er de la Convention trouve ses origines ailleurs que dans la notion de « compétence » du droit international public, mais en plus l’identification stricte de la « juridiction » de l’article 1er de la Convention et de la « compétence » que le droit international public reconnaît aux États mène à des résultats absurdes. Voir M. Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, op. cit. note 24, pp. 34-39
[31] Voir la note 26.
[32] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 83
[33] Sur ce point, l’affaire Loizidou était exemplaire. La Cour y précisait qu’un État exerçait sa « juridiction » au sens de l’article 1er « lorsque, par suite d’une action militaire – légale ou non – [il] exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national ». Voir Cour EDH, affaire Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, req. n°15318/89, § 62. Voir en ce sens M. Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, op. cit. note 24, pp. 26 ss.
[34] Cour EDH, affaire Nada c. Suisse, arrêt du 12 septembre 2012, req. n°10593/08, § 121
[35] Ibid., § 122
[36] Id.
[37] Voir Cour EDH, affaire Gray c. Allemagne, arrêt du 22 mai 2014, req. n°49278/09 ; Cour EDH [GC], affaire Güzelyurtlu et autre c. Chypre et Turquie, arrêt du 29 janvier 2019, req. n°36925/07. Dans cette dernier affaire affaire, la Cour a considéré que l’ouverture d’une enquête par les autorités turques à propos d’une infraction commise à Chypre « suffi[sai]t à établir un lien juridictionnel aux fins de l’article 1 entre l’État en question et les proches de la victime qui saisissent ultérieurement la Cour » (§ 188). Le terme « compétence pénale » est utilisé à plusieurs reprises dans l’arrêt, notamment au paragraphe 191.
[38] Cour EDH [GC], affaire Sejdovic c. Italie, arrêt du 1er mars 2006, req. n°56581/00
[39] Cour EDH [GC], affaire Markovic et autres c. Italie, arrêt du 14 décembre 2006, req. n°1398/03. Dans cette affaire, la Cour avait affirmé sans détour qu’une décision d’incompétence des autorités judiciaires d’un Etat vis-à-vis d’événements s’étant déroulés hors du territoire national et vis-à-vis de requérants situés hors du territoire national faisait naître « indiscutablement un « lien juridictionnel » au sens de l’article 1 de la Convention » (§ 54) entre l’État et les requérants.
[40] Cour EDH, affaire Stephens c. Malte (no. 1), arrêt du 21 avril 2009, req. n°11956/07 ; Cour EDH, affaire Romeo Castaño c. Belgique, arrêt du 9 juillet 2019, req. n°8351/17. Le terme « requérant » est utilisé ici par opposition à l’État « requis » (celui qui formule la demande d’extradition).
[41] Voir notamment Cour EDH, Affaire de Savoie c. Italie, décision du 13 septembre 2001, req. n°53360/99
[42] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 112
[43] Id.
[44] Id.
[45] Ibid., § 80
[46] Ibid., § 113
[47] Cour EDH [GC], affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, op. cit. note 10, §§ 133-137
[48] Cour EDH [GC], affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, op. cit. note 10 ; Cour EDH [GC], affaire Jaloud c. Pays-Bas, op. cit. note 14
[49] Cour EDH [GC], affaire Öcalan c. Turquie, arrêt du 12 mai 2005, req. n°46221/99
[50] Cour EDH, affaire Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, op. cit. note 14 ; Cour EDH [GC], affaire Hassan c. Royaume-Uni, op. cit. note 14.
[51] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 114
[52] Ibid., § 117
[53] Ibid., § 118
[54] Ibid., § 113
[55] Ibid., § 115
[56] Conseil de l’Europe, Recueil des travaux préparatoires du Protocole N°4, Strasbourg, 1976, p. 129 : « la commission a pensé que, dans le cercle homogène du Conseil de l’Europe, la prohibition de l’exil devait revêtir un caractère absolu, ce qui s’avère malaisé dans le cadre plus vaste de l’ONU. En conséquence, elle a supprimé l’adverbe « arbitrairement » que l’on trouve à l’article 12, paragraphe 2(a) du projet de pacte [soit l’actuel article 12§4] ». L’article en question formule, selon les travaux préparatoires, « une condamnation radicale et inconditionnelle de l’exil » (ibid., p. 125).
[57] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 118. La Cour cherchait, au travers de la nationalité, de faire l’analogie avec des cas dans lesquels les agents diplomatiques et consulaires ont délivré des documents d’identité à des nationaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[58] Ibid., § 84
[59] Ibid., § 120
[60] Ibid., § 122
[61] Cour EDH, affaire Abdul Wahab Khan c. Royaume-Uni, décision du 28 janvier 2014, req. n°11987/11
[62] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 123
[63] Ibid., § 90
[64] Ibid., § 81 : « Considérer le contraire impliquerait une application quasi-universelle de la Convention, les États parties disposant d’ambassades à travers le monde et tout ressortissant étranger pouvant leur adresser une demande de visa. »
[65] Ibid., § 88
[66] Ibid., § 123
[67] Ibid., § 123
[68] Id.
[69] La Cour cite Cour EDH, affaire Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, req. n°9214/80 ; 9473/81 ; 9474/81
[70] La version originale de l’extrait se lit comme suit : « The transposition of that limited Article 8 obligation to Article 3 would, in effect, create an unlimited obligation on Contracting States to allow entry to an individual who might be at real risk of ill-treatment contrary to Article 3, regardless of where in the world that individual might find himself ». Cour EDH, affaire Abdul Wahab Khan c. Royaume-Uni, op. cit. note 64, § 27
[71] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 123
[72] Id.
[73] Id. Citations omises.
[74] Cour EDH, affaire Opuz c. Turquie, arrêt du 9 juin 2009, req. n°33401/02, § 159. Nous soulignons.
[75] Même si certains juges appellent de leurs vœux la reconnaissance d’une telle obligation. Voir l’opinion dissidente du juge Pinto de Albuquerque sous l’arrêt Cour EDH, affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie, arrêt du 23 février 2012, req. n°27765/09, p. 73 de l’arrêt : « Les Etats ne peuvent feindre d’ignorer les besoins évidents de protection. Si par exemple une personne qui risque d’être torturée dans son pays demande l’asile auprès d’une ambassade d’un Etat lié par la Convention européenne des droits de l’homme, un visa d’entrée sur le territoire de cet Etat doit lui être accordé, de manière à permettre le lancement d’une véritable procédure d’asile dans l’Etat d’accueil. Il ne s’agira pas là d’une réponse purement humanitaire découlant de la bonne volonté et du pouvoir discrétionnaire de l’Etat. Une obligation positive de protection naîtra alors de l’article 3. En d’autres termes, la politique d’un pays en matière de visas est subordonnée aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international des droits de l’homme »
[76] Cour EDH, affaire Nada c. Suisse, op. cit. note 34, § 164
[77] Ibid., § 164
[78] À ce titre, l’affaire Güzelyurtlu et autre c. Chypre et Turquie, op. cit. note 37 ne nous semble pas constituer un précédent. En effet, si la Cour reconnaît l’existence d’une obligation positive à la charge des autorités turques d’enquêter sur des infractions commises en « République turque de Chypre du Nord », il faut souligner d’une part que la Cour ne demande pas à la Turquie d’agir en dehors du territoire et d’autre part que la Cour reconnaît l’existence de liens très intimes entre la Turquie et la République turque de Chypre du Nord, au point qu’elle attribue parfois les actes de la seconde à la première.
[79] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 97
[80] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 97
[81] Ibid., § 131
[82] Ibid., § 132
[83] L’article 6 § 1 énonce que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
[84] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 97
[85] Cour EDH [GC], affaire Markovic et autres c. Italie, op. cit. note 39, § 54
[86] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 124. La « société démocratique » se voit elle-même parfois conférer des droits par la Cour. Voir par exemple Cour EDH, affaire Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, req. n°69/1996/688/880, § 55 : A cet égard, elle doit, en tenant compte des circonstances de chaque affaire et de la marge d’appréciation dont dispose l’Etat, rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental d’un individu à la liberté d’expression et le droit légitime d’une société démocratique de se protéger contre les agissements d’organisations terroristes.
[87] Cour EDH [GC], affaire M.N. et autres c. Belgique, op. cit. note 2, § 115
[88] C’est la thèse défendue par Marko Milanovic. M. Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, op. cit. note 24, pp. 39-41
[89] Les expressions sont de Y. Shany, « Taking Universality Seriously », op. cit. note 24, p. 69. Voir également O. Ben-Naftali, Y. Shany, « Living in Denial : The Application of Human Rights in the Occupied Territories », Israel Law Review, vol. 37, 2003-2004, p. 64
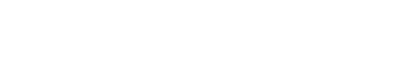

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
