Le Comité des droits de l’homme (ci-après, le « Comité ») a été amené à connaître de très nombreuses communications appelant l’État algérien à faire la lumière sur les cas de disparitions forcées et involontaires ayant marqué la période de la guerre civile des années 1990. La communication qui fait l’objet des présentes constatations s’inscrit dans cette lignée.
Les faits sont relatifs à la disparition d’un ressortissant algérien, arbitrairement arrêté par les forces de sécurité militaire le 22 juin 1995, du fait de ses activités politiques. Après plusieurs refus des autorités algériennes de lui délivrer des renseignements quant au lieu de détention et à l’état de santé de son époux, l’auteure décide de soumettre le cas au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires en 2005 lequel tente d’établir un contact avec l’État, sans résultat (§ 2.10)
La même année, la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est signée en Algérie. Une mesure nationale d’application est adoptée le 27 février 2006 (ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale). Par son article 45, celle-ci rend irrecevable tout recours relatif aux personnes disparues durant la période de la tragédie nationale, raison pour laquelle l’auteure s’est tournée vers le Comité des droits de l’homme en dernier ressort.
L’auteure s’est alors tournée vers le Comité des droits de l’homme auquel elle demande de constater la violation de plusieurs droits garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après, le « Pacte ») à l’égard de la victime. Plus précisément, l’auteure soutient que l’État a manqué à ses obligations en vertu du Pacte et doit ainsi être reconnu responsable pour ne pas avoir su prévenir l’atteinte arbitraire à la liberté, à la sécurité et éventuellement à la vie de la victime en contravention avec les articles 6 § 1 et 9 §§ 1 à 4 du Pacte (§ 3.2 et § 3.5). Elle affirme que les autorités algériennes n’ont pas garanti à la victime l’accès à des conditions de détention dignes selon les articles 7 et 10 § 1 du Pace, notamment en lui évitant une détention au secret sans contact aucun avec l’extérieur (§ 3.3 et § 3.6) ce qui a par ailleurs constitué un déni du droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique contraire à l’article 16 du Pacte (§ 3.7). Enfin, la requérante allègue que la mise en application des dispositions de la Charte pour la réconciliation nationale constitue un obstacle législatif à l’accès à un quelconque recours pour les victimes et leurs proches (§ 3.9 et § 3.10). Par conséquent, le manque de diligence voire le silence des autorités dans le cadre des procédures qu’elle a entamées doivent doit être imputés à l’État qui aurait ainsi manqué à son obligation d’assurer à ses ressortissants un recours effectif, utile et disponible garanti par l’article 2 §§ 2 à 3 (§ 3.8).
Sur la recevabilité, le Comité considère que le fait d’avoir signalé la disparition de l’époux de l’auteure au Groupe de travail sur les disparitions forcées ne constitue pas une situation de litispendance faisant obstacle à l’examen de la question par lui (§ 7.2 ; voir en ce sens, CDH, constatations du 27 mars 2020, Ahmed Souaiene et Aïcha Souaiene c. Algérie, U.N. doc. CCPR/C/128/D/3082/2017, § 7.2), étant admis qu’il s’agit d’un mécanisme extraconventionnel du Conseil des droits de l’homme.
Il poursuit l’examen en vérifiant la condition de l’épuisement des voies de recours internes et observe que l’État algérien a contesté la recevabilité de la communication au motif que la question avait déjà fait l’objet d’un mécanisme interne de règlement pourtant caractérisé par un traitement global et non individualisé du « dossier des disparus » (voir le « Mémorandum de référence du gouvernement algérien sur le traitement de la question des disparitions à la lumière de la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale », juillet 2009, spéc. §§ 51 et 52 et §§ 15 et 16). Toutefois, le Comité constate qu’étant données les mesures législatives faisant obstacle à l’ouverture d’enquêtes et à la poursuite des responsables, rien « ne pourrait permettre de conclure qu’un recours efficace et disponible serait ouvert » (§ 7.4). Par ailleurs, sans même que l’État algérien ne l’ait lui-même soulevé, le Comité s’est tout de même attaché à démontrer en quoi la communication ne pouvait être constitutive d’un abus de droit selon l’article 99 de son règlement intérieur, qui stipule qu’« il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes […] ». Il considère que les disparitions forcées sont par nature des faits continus (§ 7.5), ce qui suppose qu’au moment du dépôt de la requête, la violation était toujours en cours et qu’aucun moyen interne d’établissement de la vérité et de mise en œuvre de la justice n’étaient possibles. Il a jugé nécessaire que la communication soit recevable sur ce point par crainte, pour le Comité, d’encourager l’Algérie à entraver le droit à un recours effectif si l’abus de droit était admis pour ce type de violations qui, par nature, s’étale sur un temps plus ou moins long (Comité des droits de l’homme, constatations du 19 octobre 2020, Fatima Rsiwi c. Algérie, U.N. doc. CCPR/C/130/D/2843/2016, § 7.6). La requête est alors recevable, exception faite de l’invocation par l’auteure de l’article 2 conjointement avec l’article 19 du Pacte, dès lors que le manquement de l’État algérien comme étant la cause immédiate d’une violation distincte de ladite disposition affectant directement l’auteure n’a pas suffisamment été étayée (§ 7.6 ; voir en ce sens, Comité des droits de l’homme, constatations du 8 juillet 2022, Salah Drif et Khoukha Rafraf c. Algérie, U.N. doc. CCPR/C/135/D/3321/2019, § 7.6 ; constatations du 17 juillet 2014, Vasily Poliakov c. Bélarus, communication n° 2030/2011, U.N. doc. CCPR/C/111/D/2030/2011, § 7.4).
Un des éléments notables de cette affaire repose sur l’absence de coopération de l’État algérien dans la procédure : la mobilisation systématique du « Mémorandum » en guise de réponses aux communications est présentée par le Comité comme un manquement à l’obligation de bonne foi (§ 6 et § 8.3). Le Comité a pourtant rappelé cette exigence à de nombreuses reprises vis-à-vis de l’Algérie (voir notamment, Comité des droits de l’homme, « Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Algérie », 3517ème séance, 2018, U.N. doc. CCPR/C/DZA/CO/4, § 8.a ; CDH, constatations du 14 juillet 2016, Ali Medjnoune c. Algérie, U.N. doc. CCPR/C/87/D/1297/2004, § 8.3 ; constatations du 25 octobre 2012, Aïssa Mézine c. Algérie, U.N. doc. CCPR/C/106/D/1779/2008, § 8.3). Une telle obligation est essentielle au bon fonctionnement du système de traitement des communications, puisque la charge de la preuve est partagée entre ses auteurs et les États, compte tenu des moyens plus conséquents de ces derniers et de l’accès privilégié à certaines sources d’information.
Aussi, en s’abstenant de participer à la procédure, l’État algérien a créé un déséquilibre de droit, au détriment de l’auteure, faisant peser l’essentiel de cette charge sur elle. Ce constat justifie alors la conclusion du Comité selon laquelle il convient, à juste titre, « d’accorder tout le crédit voulu aux allégations de l’auteure, dès lors que ces dernières sont suffisamment étayées » (§ 8.3). En l’espèce, force est ainsi de constater que l’auteure a vu l’essentiel des allégations de violation du Pacte être déclaré recevable.
Sur le fond, il est intéressant de noter la pédagogie du Comité qui s’attache à rappeler que si les disparitions forcées ne font l’objet d’aucune disposition spécifique du Pacte, elles sont couvertes par lui en ce qu’elles renvoient en réalité à tout un ensemble d’actes expressément visés par plusieurs de ses dispositions (§ 8.4). Autrement dit, sous l’angle du droit de la responsabilité internationale de l’État, les disparitions forcées doivent être appréhendées comme étant des actes illicites composites, susceptibles de renvoyer aux droits garantis par le Pacte. En l’espèce, la violation continue et conjointe du droit à la vie de la victime (§ 8.5), de son droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (§ 8.6), de son droit à la liberté et à la sécurité de la personne (§ 8.8) et enfin de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique (§ 8.9) constitue effectivement une disparition forcée (voir également, Comité des droits de l’homme, « Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Algérie », précitées, § 10 ; « Article 6 : droit à la vie », Observation générale n° 36, 124ème session, 2018, U.N. doc. CCPR/C/GC/36 § 58 ; Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la CDI, vol II, 2001, spécifiquement article 15 § 1, § 2).
Dans son Observation générale n° 20 relative à l’article 7 du Pacte, le Comité vise spécialement la détention au secret et considère que la protection des détenus ne peut être garantie qu’à condition que, notamment, les membres de la famille et les amis du prisonnier puissent avoir accès au nom et au lieu de détention et au nom des personnes responsables (Comité des droits de l’homme, « Article 7 », Observation générale n°20, 44ème session, 1992, § 11 ; constatations du 8 juillet 2022, Salah Drif et Khoukha Rafraf c. Algérie, précitées § 8.6) ce qui n’a jamais été le cas de la conjointe de la victime (§ 8.6). Il convient de préciser que, quand bien même l’État alléguerait qu’aucun acte de ce type n’a été effectué, le simple fait de détenir une personne au secret suffirait à caractériser une violation de l’article 10 § 1. C’est d’ailleurs cette corrélation évidente qui permet au Comité d’éviter de se prononcer directement sur une violation de ladite disposition, celle de l’article 7 ayant été constatée (§ 8.7).
Sur le fondement de ses constatations antérieures (par exemple, CDH, constatations du 22 mars 2013, Hafsa Boudjemai c. Algérie, U.N. doc. CCPR/C/107/D/1791/2008, § 8.11, constatations du 21 mars 2014, Zineb Terafi c. Algérie, U.N. doc. CCPR/C/110/D/1899/2009, § 7.8), le Comité met en évidence l’incompatibilité du mécanisme interne de règlement du dossier des disparus (ordonnance n° 06-01, précitée, articles 45 et 46) avec l’article 2 (sur l’incompatibilité plus générale entre les régimes d’impunité et certaines conventions de droits de l’homme, voir notamment Comité des droits de l’homme, « Observations finales sur le second rapport présenté par le Liban de 1997 », 1585ème séance, 1997, U.N. doc. CCPR/C/79/Add.78, § 12 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt du 14 mars 2001, Barrios Altos c. Pérou, Série C, n° 75, § 41), et affirme qu’il contribue à instaurer et à maintenir un système d’impunité empêchant que des recours accessibles, utiles et exécutoires soient placés à la disposition des ressortissants algériens (§ 8.12 et § 10). Un recours est notamment considéré comme utile dans la mesure où une réparation est accordée « aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés » (Comité des droits de l’homme, « La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties du Pacte », Observation générale n° 31, 80ème session, 2004, U.N. doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, § 16). Il ne suffit pas pour autant de réparer les préjudices subis pour que ladite obligation soit effectivement respectée. Il faut avant tout que la violation dont il est question ait cessé et cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’une violation dite continue. C’est précisément le cas en l’espèce (§ 8.4). Le Comité met donc en avant une exigence consubstantielle au respect de l’article 2 et qui est l’obligation de cessation et de non-répétition du comportement illicite (Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31, précitée, § 15 et § 18 et article 30, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, précité). Or, cette double obligation ne peut ni raisonnablement ni vraisemblablement être respectée tant que sera maintenu un système d’impunité tel que celui établi par la Charte pour la réconciliation nationale. À juste titre donc, le Comité enjoint aux autorités algériennes de modifier la législation interne constitutive d’un obstacle à la protection des droits garantis par le Pacte (§ 10).
In fine, la problématique sous-jacente est celle de l’invocation par l’État algérien de son droit interne comme justification de la méconnaissance des obligations auxquelles il a souscrit en vertu du Pacte. Il est pourtant clair qu’un État ne peut se prévaloir de son droit interne dans ces circonstances, tel que cela est explicitement stipulé par l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (voir en ce sens, Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31, précitée, U.N. doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, § 4), mais aussi par une lecture combinée des articles 3 et 32 du Projet d’articles sur la responsabilité internationale des États. La Charte pour la réconciliation nationale est alors manifestement inopposable en ce sens que le droit interne algérien ne constitue pas une circonstance susceptible d’exclure l’illicéité du comportement de ses agents. À cet effet, même si les actes d’omission volontaire de mener une enquête effective sur la disparition de la victime et d’ouvrir des recours afin d’identifier les responsables sont justifiés, selon le Gouvernement algérien, par la politique de réconciliation nationale, le Comité se refuse fermement à admettre ce régime d’impunité et constate que l’État algérien a manqué au respect de l’article 2 § 3 lu conjointement avec les autres dispositions précitées du Pacte (§ 10) ; (voir aussi Comité des droits de l’homme, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de l’Algérie », 94ème session, 2007, U.N. doc. CCPR/C/DZA/CO/3, §§ 7 et 8).
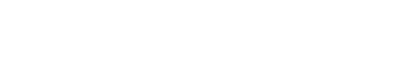

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
