Les auteurs de la communication sont les parents de H., ressortissant français au nom duquel ils agissent, qui aurait, dès son entrée en zone iraqo-syrienne en 2016, été arrêté par les forces kurdes, entretenant des rapports avec l’État français, puis détenu par elles dans le nord-est de la République arabe syrienne. Dès 2018, il aurait été transféré par ces mêmes forces vers des prisons de Damas, contrôlées par le gouvernement syrien. Il y serait depuis exposé à un « risque de mort et d’atteintes irréversibles à son intégrité physique et psychique résultant des actes de torture et des traitements pratiqués dans les prisons du régime syrien » (§§ 2.1 et 2.2).
Dans leur communication introduite auprès du Comité contre la torture (ci-après, le « Comité ») en 2019, les auteurs allèguent que l’autorisation que les autorités françaises auraient accordé aux forces kurdes de transférer leur fils aux autorités syriennes, et leur refus de le rapatrier violent l’article 2 lu conjointement avec l’article 16 de la Convention contre la torture (ci-après, la « Convention »), l’État français n’ayant pas pris de mesures efficaces pour empêcher qu’il ne soit exposé à des actes de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants (§§ 3.1 à 3.3). En dépit de la gravité et de l’urgence des allégations, le Comité a refusé d’ordonner des mesures provisoires. Il s’est contenté de « pri[er] l’État partie de prendre toutes les mesures à sa disposition afin de s’assurer que la vie et l’intégrité de H. soient préservées », sans préciser le contenu concret que devraient revêtir de telles mesures dans la situation de l’espèce (§ 1.2).
La détermination de la recevabilité de la requête se décline ensuite en quatre branches. Après avoir écarté la question classique de l’examen par une autre instance internationale (§ 7.1), le Comité confirme la qualité à agir des auteurs de la communication, sur le seul fondement de la preuve du lien de parenté et de l’accord verbal de la victime présumée, puisque les circonstances rendaient irréaliste l’exigence d’une autorisation écrite (§ 7.2).
En revanche, l’État ne l’ayant pas soulevé, le Comité ne se prononce pas sur l’épuisement des voies de recours internes, à l’égard duquel les auteurs de la communication faisaient valoir que, du fait de l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes de retour, entrant dans le champ des actes de gouvernement, et de l’absence de moyens d’exécution d’éventuelles décisions juridictionnelles ordonnant des mesures de protection, il n’existait « aucun recours interne disponible et efficace » (§ 2.3 ; voir à cet égard la procéduralisation des obligations dans CEDH, GC, arrêt du 14 septembre 2022, H.F. et autres c. France, req. n° 24384/19 et 44234/20, §§ 272 à 283).
Enfin, le Comité se penche sur l’exception principale d’irrecevabilité, tirée du défaut de juridiction de l’État défendeur, sur laquelle les observations des parties sont particulièrement confuses.
En effet, pour démontrer que l’État exerce sa juridiction sur H., les auteurs de la communication opèrent une lecture sélective et obscure des travaux des organes de protection. Ils soutiennent notamment une conception extensive de la juridiction, selon laquelle « les États parties [devraient] prévenir les violations des droits des personnes sur lesquelles ils exercent leurs compétences, notamment personnelles » (§ 3.1). Mais les auteurs ne peuvent pas en déduire que l’État doit « mettre fin à des traitements prohibés par la Convention en la personne de [ses] ressortissants », sans analyser s’il a effectivement exercé ses compétences. Par ailleurs, ils déduisent d’arrêts isolés de la Cour européenne des droits de l’homme que la juridiction extraterritoriale est admise dès lors que l’État exerce une « influence décisive » (§ 5.3). Ils vont jusqu’à alléguer, de façon décousue, que, compte tenu de l’étendue de cette influence, des rapatriements déjà opérés, « l’État partie est à “l’origine unique” [de son] transfert […] aux autorités syriennes », ce qui aurait fait naitre le lien juridictionnel (§§ 5.4 et 7.4).
Pour établir son absence de juridiction à l’égard de H., l’État français rappelle quant à lui le caractère « exceptionnel » de la juridiction extraterritoriale et « les liens consubstantiels entre les notions de juridiction et de contrôle effectif » (§§ 4.4 et 4.5). Il rejette toute confusion entre juridiction et nationalité, et toute juridiction qui serait déclenchée par une simple demande d’intervention quant à des violations commises dans ou par d’autres États (§ 6.3). Il affirme toutefois, de manière imprécise, en confondant certaines notions comme celles de juridiction et d’irrecevabilité ratione personae (§ 4.4 et § 6.1) et sans clarifier le lien entre compétence et juridiction, que les États souverains ne se sont engagés à respecter la Convention « que pour les situations qui relèvent de leur souveraineté, de leur compétence et sur lesquelles ils sont susceptibles d’avoir un contrôle effectif » (§ 4.3). Or, en l’espèce, la victime présumée « ne se trouve[rait] ni sous le contrôle et l’autorité de fonctionnaires et d’agents français, ni sur un territoire sous le contrôle effectif de l’État partie », mais bien sous le contrôle des autorités syriennes (§ 4.7 et § 7.3). Il conteste également « exerce[r] sa compétence à l’égard de H. sur la base de toute décision prise sur son territoire national » (§ 6.1), en s’appuyant, entre autres, sur l’absence de démonstration de son autorisation du transfert de H. (§ 6.4).
Ainsi, alors que le Comité était invité à clarifier sa position quant à la juridiction extraterritoriale, cette affaire particulièrement sensible semble constituer un acte manqué. Le Comité distingue toutefois deux étapes : la question préalable de savoir si la victime présumée relevait de la juridiction de l’État partie au sens de l’article 22 (1) de la Convention, et l’établissement subséquent « [des] obligations découlant de l’article 2 de la Convention à son égard », applicable à « tout territoire sous [la] juridiction [de l’État partie] » (§ 7.5). Le terme « juridiction » ne semble alors pas revêtir le même sens (voir a contrario, Comité contre la torture, constatations du 10 novembre 2008, P.K. et consorts c. Espagne, communication n° 323/2007, U.N. doc. CAT/C/41/D/323/2007, § 8.2) : dans le premier cas, il renverrait à l’exercice, par l’État partie, d’« une autorité ou un contrôle légal sur [l’individu] » (§ 7.5), tandis que, dans le second, il désignerait « toutes les régions sur lesquelles l’État partie exerce de fait ou de droit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif », ou « un contrôle sur des détenus » (Comité contre la torture, « Application de l’article 2 par les États parties », Observation générale n° 2, 2007, U.N. doc. CAT/C/GC/2, § 16).
En l’espèce, seule la première question est traitée, sans définir la notion floue et novatrice d’« autorité ou [de] contrôle légal » (nous soulignons). Le Comité ne se place pas sur le terrain de la légalité, mais observe factuellement « l’absence d’éléments concrets indiquant le contrôle de l’État partie sur la situation de H. », en soulignant le caractère insuffisant des preuves présentées (§ 7.6), que l’État partie avait déjà relevé pour arguer que la requête était manifestement infondée (§ 4.1). Plus précisément, il estime, d’une part, que « les activités de l’État partie dans le nord de la République arabe syrienne » n’emportent pas juridiction sur la victime présumée, détenue sous le contrôle des autorités syriennes, et d’autre part, qu’il n’est pas suffisamment démontré que « l’État partie aurait autorisé le transfert présumé de H. aux autorités syriennes », ni qu’un lien juridictionnel serait né de son non-rapatriement à la suite de la lettre adressée au président de la République le 1er février 2019, demandant le rapatriement de femmes et d’enfants français détenus par les forces kurdes, et mentionnant simplement « la présence de plusieurs autres ressortissants français dans la zone irako-syrienne [dont H.], dont la localisation précise n’[était] pas permise » (§ 2.3 et § 7.6).
Partant, le Comité conclut à l’irrecevabilité de la communication en l’absence d’exercice, par l’État partie, de sa juridiction à l’égard de la victime présumée. Il a néanmoins pu parvenir peu après à une conclusion contraire à l’égard des mères et des enfants français détenus par les forces kurdes, dans un contexte différent, où le lien juridictionnel reposait sur la nationalité des victimes et « la capacité et le pouvoir [de l’État partie] de protéger leurs droits », compte tenu des relations que l’État français entretenait avec ces forces souhaitant coopérer et des rapatriements déjà opérés (Comité contre la torture, constatations du 16 novembre 2022, L. V. et consorts c. France, communication n° 922/2019, U.N. doc. CAT/C/75/D/922/2019, § 6.7-6.8 ; voir également, Comité des droits de l’enfant, constatations du 30 septembre 2020, S.H et autres c. France, communications n° 79/2019 et 109/2019, U.N. docs. CRC/C/85/D/79/2019 et 109/2019, §§ 9.7 à 10).
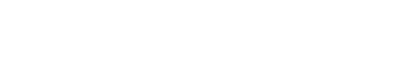

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
