L’auteur de la communication, B.T.M., est un avocat zimbabwéen et défenseur des droits de l’homme. Il exerce au sein d’un cabinet d’avocats qui a représenté et défendu des militants alléguant avoir subi des violences de la part du gouvernement du Zimbabwe en raison de leur affiliation au parti politique d’opposition, le Mouvement pour le changement démocratique (§§ 2.1-2.3). Dans le cadre de son travail, B.T.M. a eu personnellement la charge de la défense de trente de ces militants, ainsi que d’autres membres du même parti poursuivis pénalement pour des considérations politiques (§ 2.4). En raison de son engagement dans ces affaires, B.T.M. est devenu une cible pour les partisans du pouvoir en place. Il signale avoir été menacé par écrit à partir de janvier 2019, avoir été agressé physiquement par trois individus le 29 mars 2019, et avoir fait l’objet d’une tentative d’enlèvement en juin 2019 (§§ 2.5-2.7). Craignant pour sa vie, l’auteur ne sollicite pas les autorités zimbabwéennes : celles-ci refusent d’enquêter sur son agression (§ 2.6) et le convoque sans lui donner d’explication légitime (§ 2.7). Dans ce contexte, l’auteur prend la décision de quitter le Zimbabwe en juillet 2019 (§ 2.8). Afin de ne pas être repéré par les autorités zimbabwéennes, il traverse d’abord la frontière pour se rendre en Afrique du Sud, où il prend ensuite un vol pour la Suisse (§ 2.8).
Le lendemain de son arrivée, le 22 juillet 2019, il sollicite l’octroi de l’asile auprès du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après, le « SEM »). Le 30 août 2019, sa demande est rejetée et son expulsion vers le Zimbabwe ordonnée. Le SEM met en question la crédibilité de sa persécution au Zimbabwe, eu égard à son faible engagement au sein du Mouvement pour le changement climatique et des preuves documentaires qu’il a présentées (§ 2.8). Il s’agit notamment du mandat d’arrêt émis à son encontre par les autorités zimbabwéennes, que les autorités suisses considèrent comme « aisément falsifiable » (§ 2.9). L’auteur interjette un recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 9 septembre 2019, alléguant des griefs de violations d’obligations procédurales en raison de l’absence de prise de mesures nécessaires et raisonnables aux fins de vérification de l’authenticité des preuves documentaires par le SEM (§§ 2.10-2.11). Par ailleurs, le requérant ajoute que le SEM ne peut pas se fonder essentiellement sur son niveau d’implication personnelle au sein du Mouvement pour le changement climatique pour prendre sa décision, puisque que la persécution qu’il subit découle de son activité professionnelle consistant à défendre des victimes de violences de l’État (§ 2.11). Son recours est rejeté comme manifestement non-fondé le 27 septembre 2019 par une décision à juge unique et sommairement motivée (§ 2.12). Confronté aux pressions simultanées du SEM pour qu’il consente à son plan de retour volontaire assisté, l’auteur accepte finalement son rapatriement au Zimbabwe (§ 2.13). En novembre 2019, il dépose une demande de réexamen auprès du SEM en raison d’éléments de preuves supplémentaires – des lettres de soutien à son témoignage –, avec une demande d’effet suspensif du plan de retour volontaire assisté (§ 2.15). Ce recours se révèle infructueux, le SEM estimant que de telles lettres n’ont aucune valeur probante (§ 2.16). Considérant qu’il est peu probable qu’un recours en appel aboutisse à un effet suspensif de son rapatriement, d’autant qu’un tel recours est au-delà de ses moyens financiers, l’auteur décide de saisir le Comité contre la torture le 22 novembre 2019 en invoquant une violation des articles 3, (droit à un recours effectif) dans son volet procédural et 16 (obligation de prendre des mesures efficaces pour prévenir la commission d’actes constitutifs de torture) de la Convention (§ 3.2).
Le Comité examine les conditions de recevabilité de la communication, en particulier l’épuisement des voies de recours internes disponibles disputé par l’État (§§ 4.7-4.12). Le Comité se contente de relever que le recours introduit par l’auteur le 9 septembre 2019 devant le Tribunal administratif fédéral n’a fait l’objet que d’un examen sommaire et anticipé, et qu’aucun nouveau recours n’était possible par la suite pour l’auteur (§ 8.7). Faisant référence à de précédentes décisions concernant l’État partie (CAT, constatations du 7 décembre 2018, M. G. c. Suisse, communication n° 811/2017, U.N. doc. CAT/C/65/D/811/2017, § 6.4 ; constatations du 14 mai 2010, C.M. c. Suisse, communication n° 355/2008, U.N. doc. CAT/C/44/D/355/2008, § 9.2), le Comité retient que le coût de 1500 francs suisses imposé à l’auteur pour introduire à nouveau un recours est inéquitable au regard de sa situation d’indigent (§ 7.4). Le Comité ne se prononce pas sur les arguments de l’État selon lesquels il existe une voie de recours extraordinaire ou encore sur l’hypothèse que le Tribunal fédéral administratif aurait pu octroyer un effet suspensif à une éventuelle demande de réexamen (§ 4.10). Il n’en est nul besoin puisque les recours extraordinaires ne remplacent pas les recours judiciaires disponibles (voir CAT, constatations du 15 novembre 2005, M. A. H. c. Suède, communication n° 250/2004 (n° 126), U.N. doc. CAT/C/35/D/250/2004, § 7.2), et que l’État n’a pas saisi l’opportunité, à deux reprises, de suspendre le rapatriement de l’auteur.
La requête déclarée recevable (§ 7.5), le Comité entreprend d’analyser les griefs tirés d’une violation de « l’obligation de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture » (§ 8.2). Le Comité commence par rappeler qu’il existe des motifs sérieux dès lors qu’il y a un risque « prévisible, personnel, actuel et réel » (CAT, « Observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 », U.N. doc. CAT/C/GC.4, § 11). Si l’adage latin ei incumbit probatio qui dicit (la charge de la preuve incombe à celui qui affirme) s’applique, le Comité souligne que l’État ne doit pas être passif. Il lui revient d’« enquêter sur les allégations et […] vérifier les informations sur lesquelles est fondée la communication » (§ 8.4 ; voir CAT, Observation générale n° 4, précitée, § 38). Ainsi, l’État doit s’efforcer d’être proactif au regard, non seulement de la formulation de l’article 3 de la Convention, mais aussi de l’objet et du but de la Convention qui met en évidence le caractère préventif de l’interdiction du refoulement (M. Ammer et A. Schuechner, « Article 3. Principle of Non-Refoulement », in M. Nowak, M.Birk et G.Monina [dir.], The United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol: A Commentary, Oxford, OUP, 2019, pp. 98-175, spec. p. 170). En imposant aux États parties de rechercher s’il existe des motifs sérieux de croire qu’un individu serait exposé à la torture en cas d’expulsion vers son pays d’origine, la Convention a mis à la charge des États une obligation d’examiner tant la forme de la preuve que son contenu. Ainsi, dans la présente espèce, le Comité note que l’État n’a pris aucune mesure pour déterminer si les pièces documentaires apportées par l’auteur étaient authentiques, manquant à son obligation procédurale d’assurer un examen effectif, indépendant et impartial requis par l’article 3 de la Convention. Le Comité aurait pu aller plus loin et rappeler à l’État que tout type de preuve peut être apporté (CAT, Observation générale n° 4, précitée, § 49), y compris celles aisément falsifiables, telles qu’un mandat d’arrêt envers le requérant indiquant qu’il est recherché et risque d’être arrêté (CAT, constatations du 24 mai 2013, R. S. M. c. Canada, communication n° 392/2009 U.N. doc. CAT/C/50/D/392/2009, § 7.4) et des lettres de soutien (CAT, constatations du 8 mai 2002, Chedli Ben Ahmed Karoui c. Suède, communication n° 185/2001, U.N. doc. CAT/C/28/D/185/2001, § 10).
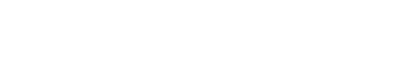

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
