SOMMAIRE
COMITE DES DROITS DE L’HOMME (CCPR)
Comité des droits de l’Homme, Fulmati Nyaya c. Népal, 18 mars 2019, communication n° 2556/2015, CCPR/C/125/D/2556/2015.
Comité des droits de l’Homme, Ekaterina Abdoellaevna contre Pays-Bas, 26 mars 2019, communication n° 2498/2014, CCPR/C/125/D/2498/2014.
Comité des droits de l’Homme, Mario Staderini et Michele De Lucia contre Italie, 6 novembre 2019, communication n° 2656/2015, CCPR/C/127/D/2656/
2015.
COMITE CONTRE LA TORTURE (CAT)
Comité contre la torture, M. Z. c. Belgique, 2 août 2019, communication n° 813/2017, CAT/C/67/D/813/2017.
Comité contre la torture, A. c. Bosnie-Herzégovine, 2 août 2019, communication n° 854/2017, CAT/C/67/D/854/2017.
Comité contre la torture, Cevdet Ayaz c. Serbie, 2 août 2019, communication n° 857/2017, CAT/C/67/D/857/2017.
Comité contre la torture, ELG c. Espagne, 26 novembre 2019, communication n° 818/2017, CAT/C/68/D/818/2017.
COMITE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES (CRPD)
Comité des droits des personnes handicapées, Z. c. République Unie de Tanzanie, 19 septembre 2019, communication n° 24/2014, CRPD/C/22/D/24/2014.
COMITE DES DROITS DE L’ENFANT (CRC)
Comité des droits de l’enfant, D.D. c. Espagne, 1er février 2019, communication n°4/2016, CRC/C/80/D/4/2016.
Comité des droits de l’enfant, A.L. c. Espagne et J.A.B c. Espagne, 31 mai 2019, communications n°16/2017 et 22/2017, CRC/C/81/D/22/2017 ; M.T. c. Espagne et R.K. c. Espagne, 18 septembre 2019, communications n°17/2017 et 27/2017, CRC/C/82/D/27/2017.
COMITE POUR L’ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION A L’EGARD DES FEMMES (CEDAW)
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, O.M c. Ukraine, 19 juillet 2019, communication n° 87/2015, CEDAW/C/73/D/87/2015.
Comité des droits de l’Homme
Comité des droits de l’Homme, Fulmati Nyaya c. Népal, 18 mars 2019, communication n° 2556/2015, CCPR/C/125/D/2556/2015.
Les constatations rendues par le Comité des droits de l’Homme dans l’affaire Fulmati Nyaya c. Népal le 18 mars 2019 s’inscrivent dans le contexte de la guerre civile ayant frappé le pays de 1996 à 2006. Elles constatent à ce titre la violation par l’État partie d’une multitude des droits de l’auteure de la communication, victime de violences sexuelles et soumise au travail forcé dans le cadre dudit conflit.
Mots-clés : prohibition de la torture et des traitements inhumains et dégradants ; prohibition du travail forcé ; droit à la liberté et la sécurité ; arrestation et détention arbitraire ; discrimination fondée sur le sexe ; droit au respect de la vie familiale.
Le 17 février 2014, une plainte fut émise au nom de l’auteure de la communication. Cependant, les autorités refusèrent de l’enregistrer en ce qu’elle ne respectait pas le délai maximum de 35 jours prévu par le Code pénal népalais pour rapporter tout crime de viol. Elle fit une autre tentative de déposition le 29 mars 2014 auprès du Chief District Officer de Dhangadhi, laquelle connut le même sort. Une autre demande formulée auprès de la Kailali District Court sur la base d’une loi de 1996 prévoyant l’indemnisation des victimes d’actes de torture fut également rejetée pour le même motif.lors qu’elle n’avait que 14 ans, et qu’une guerre civile sévissait dans son pays, l’auteure de la communication de nationalité népalaise fut arrêtée et détenue incommunicado en raison de ses liens présumés avec le mouvement Maoïste. Pendant sa détention, elle fut victime de viols et autres formes de violences sexuelles, physiques et verbales. Elle fut également forcée par les autorités à travailler dans des baraquements. En juin 2002 son père obtint sa libération et elle put retourner à son village. Cependant, le sort réservé aux prisonnières dans ce conflit étant connu, elle fit l’objet d’une marginalisation autant par les membres de sa communauté que par sa famille et ses proches. A cette époque, étant donné son jeune âge, sa méconnaissance des voies de recours exploitables et sa crainte des réactions de sa famille, elle n’initia aucune poursuite ni procédure judiciaire.
Le 11 avril 2014, l’auteure de la communication produit un writ of mandamus destiné à la Cour suprême du Népal sollicitant la non-application de la règle des 35 jours par les instances inférieures à son cas. Au moment de la saisine du Comité des droits de l’Homme, à savoir, le 20 juin 2014, la requête était toujours pendante devant la Cour Suprême.
L’auteure allègue dans sa communication la méconnaissance d’une multitude de ses droits parmi lesquels, son droit à ne pas être soumise à la torture et des traitements inhumains et dégradants (art. 7 du Pacte), à ne pas être astreinte à accomplir un travail forcé ou obligatoire (article 8 du Pacte), à ne pas être détenue arbitrairement (article 9 du Pacte) et à avoir accès à la justice (article 14 du Pacte). Elle soutient également avoir été victime de discriminations fondée sur le sexe et sur son ethnie (article 27 du Pacte).
L’État Partie conteste d’abord la recevabilité de la requête en ce que l’auteure de la communication n’aurait pas épuisé toutes les voies de recours internes. A cet égard, le Comité, résumant toutes les procédures judiciaires et parajudiciaires empruntées par l’auteure, note qu’elle ne pouvait pas en pratique respecter la règle des 35 jours puisqu’elle était détenue jusqu’à la fin de ce délai. Quant à la procédure initiée devant la Cour Suprême, il considère qu’elle fut indûment prolongée, d’autant plus au regard de la gravité des allégations de l’auteure. Aussi, il apparaissait improbable que les procédures initiées par elle donnent lieu à un résultat positif. Les recours doivent alors être considérés comme ayant été ineffectifs et indisponibles et la communication ne peut être déclarée irrecevable sur la base de ce motif.
Le Comité ajoute également que les procédures non-judiciaires liées au processus de justice transitionnelle ne doivent pas être épuisées au sens de l’article 5 (2) (b) du Pacte et qu’elles ne doivent donc pas dispenser l’État partie de poursuivre pénalement les violations graves des droits de l’Homme1.
Sur le fond, le Comité rappelle que les femmes sont particulièrement vulnérables dans les contextes de conflit armés internes ou internationaux et que les États doivent donc prendre toutes les mesures pour les protéger de viols, d’enlèvements ou de toute forme de violence liées au sexe. Dans ce sens, étant donné les violences sexuelles subies par l’auteure et les manquements de l’État Partie pour enquêter et établir la responsabilité des auteurs de ces crimes, son droit à ne pas être sujet à des discriminations fondées sur le sexe prévu par les articles 2 (1) et 3 du Pacte, lus seuls ou en conjonction avec les articles 7, 24 (1) et 26 du Pacte, a bien été méconnu.
Ensuite, vis-à-vis de la violation de l’article 8(3) du Pacte, c’est-à-dire du droit de l’auteure à ne pas être soumise au travail forcé, le Comité note que son récit est corroboré par des informations objectives en ce sens et doit donc être considéré comme convaincant2. Il rappelle ensuite classiquement que pour qu’un travail ou service ne soit pas considéré comme « forcé ou obligatoire », il doit faire partie des obligations civiles normales d’un individu, c’est-à-dire que la mesure ne doit pas avoir un caractère exceptionnel, un but ou un effet punitif, qu’elle doit être prévue par la loi et être légitime3. Les experts du Comité vont alors souligner qu’en l’espèce l’auteure était obligée de travailler alors qu’elle était une enfant au moment de sa détention. La mesure revêtait donc un caractère dégradant et discriminatoire. Dès lors, le Comité observe la violation de l’article 8 (3) du Pacte lu seul et en conjonction avec les articles 7 et 24 (1) du Pacte.
Quant au droit de ne pas être soumis à des détentions arbitraires, il est noté que l’auteure n’a reçu aucune réparation. Si, comme l’État le soutient, la détention de l’auteure ne fait l’objet d’aucun document fourni par elle, le Comité note qu’elle a toutefois présenté une version crédible des faits et que lui demander de prouver son arrestation illégale équivaudrait à une probatio diabolica4. La charge de la preuve pesait donc sur l’État, lequel, n’a pas justifié ladite détention. Il a dès lors méconnu l’article 9 du Pacte.
Ensuite, le Comité observe que le viol que l’auteure a subi constitue une interférence avec son droit à la vie privée et son autonomie sexuelle, ce à quoi s’ajoute la stigmatisation, la marginalisation et la honte qu’elle a eu à endurer de la part de sa communauté, de sa famille et de son mari. L’État partie n’ayant pas adopté les mesures pour la protéger à cet égard, le Comité constate la violation des articles 17 et 23 (1) du Pacte. Dans son opinion partiellement concordante, José Manuel Santos Pais différencie son interprétation en l’espèce de l’article 23 (1) du Pacte, considérant que le lien entre le viol subi par l’auteure et les conséquences sur sa vie familiale et conjugale serait insuffisamment étayé autant sur un plan substantiel que temporel en l’espèce, craignant dès lors un glissement vers une responsabilité trop facilement engageable sur ce terrain.
Enfin, le Comité relève que le motif invoqué par les autorités népalaises pour refuser d’enregistrer la plainte de l’auteure était fondé sur le délai de prescription de 35 jours prévu par la législation nationale. Or, il note sur la base d’une jurisprudence constante qu’un tel délai pour enregistrer le dépôt d’une plainte pour viol, et ce même s’il a été étendu à un an en 2018, est sans commune mesure avec la nature de l’infraction et a des conséquences excessivement lourdes pour les enfants et les femmes qui en sont pourtant les plus victimes. Partant, une telle limitation a empêché l’auteure d’accéder à la justice et constitue une violation de l’article 2(3) lu seul et conjointement avec les articles 3, 7, 9, 24 et 26 du Pacte.
Le Comité des droits de l’Homme conclut en rappelant l’obligation de réparation qui incombe à l’État partie. Cette dernière consiste en l’espèce non seulement en la poursuite effective des individus responsables des violences subies par l’auteure de la communication, mais plus largement à la modification de la définition étroite du viol retenue par l’État ainsi qu’à l’extension du délai pour dénoncer un tel crime5. Plus largement, ces constatations marquent la première affaire dans laquelle l’organe des Nations Unies reconnaît le recours au travail forcé lors du conflit ayant frappé le pays de 1996 à 2006.
O. P.
Comité des droits de l’Homme, Ekaterina Abdoellaevna contre Pays-Bas, 26 mars 2019, communication n° 2498/2014, CCPR/C/125/D/2498/2014.
Le Comité des droits de l’Homme (le Comité), à l’occasion de sa 125e session a constaté une violation par les Pays-Bas de l’article 24 paragraphe 1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (le Pacte) garantissant le droit pour tout enfant mineur à des mesures spéciales de protection de son bien-être physique et psychologique.
Mots-clés : droits des enfants ; mesures spéciales de protection ; bien-être physique et psychologique ; intérêt supérieur de l’enfant ; délai raisonnable.
Le Comité a jugé sa demande recevable en se fondant sur une exception à l’obligation de l’épuisement des voies de recours internes. Il a considéré qu’un délai de plus de quatre ans d’attente d’une décision d’appel ne constituait pas un délai raisonnable pour l’examen d’un recours.katerina Abdoellaevna est une demandeuse d’asile originaire d’ Ouzbékistan, arrivée avec sa famille aux Pays-Bas en 2000. Suite aux rejets successifs des demandes d’asile formulées par sa famille et en son nom propre et en celui de sa fille Y née aux Pays-Bas en 2008, elle est restée sans titre de séjour jusqu’en 2014. En outre, elle est devenue apatride du fait du retrait de sa nationalité de son pays d’origine en raison d’un éloignement de plus de quatre années du pays. Dans l’impossibilité de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure Y, Ekaterina Abdoellaevna a formulé auprès de l’administration, une demande d’allocation personnalisée pour enfant à charge, qui lui a été refusée. Elle a interjeté appel contre la décision de rejet, un appel dont la décision est attendue depuis quatre ans. Elle a saisi le Comité des droits de l’Homme en son nom et au nom de sa fille mineure, Y, contre les Pays-Bas pour violation des articles 23 (§ 1), 24 (§3) et 26, lu conjointement avec les articles 23 (§1) et 24 (§ 1) du Pacte, ainsi que des droits que tient Y de l’article 24 (§ 1) du Pacte (droit à la protection spéciale des enfants mineurs).
Concernant le fond de la requête, le Comité a cherché à savoir si le rejet de la demande d’allocation personnalisée pour enfant à charge présentée par l’auteure constituait une violation des droits garantis par l’article 24 paragraphe 1 du Pacte, en l’occurrence le droit de tout enfant mineur à des mesures spéciales de protection tenant compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. Le Comité a rappelé que cet article met à la charge des États parties, l’obligation positive de protéger les enfants contre toute atteinte à leur bien-être physique et psychologique. De ce fait, il a considéré que l’absence de protection sociale en faveur des enfants peut, dans certaines circonstances, compromettre leur bien-être physique et psychologique. En outre, le Comité a précisé que l’allocation personnalisée pour enfant à charge, en tant que contribution aux frais d’entretien d’un enfant âgé de moins de 18 ans, bénéficie à la fois aux parents et à l’enfant. Le Comité a constaté que la loi néerlandaise permet à des étrangers ne possédant pas de permis de séjour de bénéficier de l’allocation personnalisée pour enfant à charge dans des circonstances spéciales. Cependant, la loi n’indique ni les critères de détermination de ces circonstances spéciales, ni si l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour déterminer l’existence de telles circonstances spéciales6. Or, selon le Comité, l’auteur et Y se trouvaient dans une situation de vulnérabilité reconnue par l’État partie à travers l’octroi en 2014 d’un permis de séjour à l’auteur. Le Comité a donc constaté une violation par les Pays-Bas des droits garantis à Y par le paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte notamment l’obligation positive de veiller à la protection du bien-être physique et psychologique de Y, par une garantie de subsistance alors que sa mère était dans l’incapacité de travailler ou de se procurer un autre revenu.
Dans une opinion conjointe concordante les membres du Comité, Marcia V. J. Kran et Yuval Shany considèrent que la constatation du Comité au titre de l’article 24 du Pacte devrait s’appuyer sur le fait que les Pays-Bas n’ont pas mis en place un programme de sécurité sociale permettant d’évaluer les besoins de la fille mineure de l’auteure et d’y répondre. En outre, l’exclusion effective de l’auteure du bénéfice de cette allocation constitue une forme de discrimination fondée sur des critères ni raisonnables ni objectifs, contrevenant aux articles 26 et 2 (§1)7, lus conjointement avec l’article 24 du Pacte.
Le Comité reste attaché à sa jurisprudence relative à l’intérêt supérieur de l’enfant dans une approche holistique. En effet, l’intérêt supérieur de l’enfant dépend de la protection sociale qui lui est accordée, mais également du devoir du parent à subvenir à ses besoins. Le Comité analyse ainsi les mesures de protection spéciales recommandées par l’article 24 paragraphe 1 à la lumière de la capacité des parents à assumer leur devoir de prise en charge et de protection de l’enfant.
O. K. S.
Comité des droits de l’Homme, Mario Staderini et Michele De Lucia contre Italie, 6 novembre 2019, communication n° 2656/2015, CCPR/C/127/D/2656/2015.
Le Comité des droits de l’Homme (le Comité), à l’occasion de sa 127e session (14 octobre–8 novembre 2019), a constaté une violation par l’Italie de l’article 25 (a) lu seul et conjointement avec l’article 2 (3)8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte) garantissant le droit de tout citoyen de prendre part à la gestion des affaires publiques. Le Comité précise que les modalités établies pour l’exercice de ce droit ne doivent comporter aucune mesure discriminatoire ou restriction déraisonnable susceptible de compromettre sa réalisation.
Mots-clés : droit de prendre part à la gestion des affaires publiques ; référendum d’initiative populaire ; droit à un recours effectif ; droit à réparation.
Le Comité considère que les auteurs ont épuisé les voies de recours internes existantes et disponibles. Toutefois, il l’a déclarée irrecevable ratione materiae au titre de l’article 25 b) du Pacte au motif que les allégations des requérants ne portent pas sur les dispositions spécifiques de cet alinéa. Ce dernier se limitant à l’expression du droit des citoyens à participer à la conduite des affaires publiques, en tant qu’électeurs ainsi que du droit à la participation aux élections en tant que candidat. En revanche, le Comité a admis la recevabilité de la communication au titre de l’article 25 a) du Pacte qui traite de la participation directe des citoyens à la conduite des affaires publiques lorsque ceux-ci décident de questions publiques par voie de référendum.Deux militants du mouvement politique les Italiens radicaux, Mario Staderini et Michele De Lucia, ont initié avec 20 autres citoyens, une procédure auprès du Bureau central des référendums de la Cour de cassation, en vue de l’organisation de six référendums nationaux destinés à abroger plusieurs dispositions législatives. Cependant, cette initiative référendaire, prévue à l’article 75 de la Constitution, n’a pas été admise par la Cour de cassation au motif qu’elle n’a rassemblé que 200 000 signatures sur les 500 000 exigées par la loi constitutionnelle n ° 352 de 1970. Les requérants attribuent l’échec de leur initiative à la procédure restrictive de recueil et d’authentification des signatures imposées par la loi n ° 352 de 1970. Ils saisissent le Comité en vue de faire constater que les lois et procédures régissant la tenue de référendums en Italie portent atteinte aux droits garantis par l’article 25 a) et b) (droit de tout citoyen de prendre part à la gestion des affaires publiques en qualité de candidat et électeurs et par des propositions législatives) du Pacte lu isolément et combiné avec l’article 2 paragraphe 3 du Pacte (obligation pour l’État de garantir un recours utile aux individus).
Dans le cadre de l’examen du fond, le Comité a cherché à déterminer si les restrictions imposées à la participation à la procédure référendaire portent atteinte aux droits prévus à l’article 25 a) du Pacte. À cet effet, le Comité s’est appuyé sur ses observations générales n° 189 et 2510 pour procéder à l’analyse des caractères raisonnables et discriminatoires des restrictions au regard des exigences de l’article 25 du Pacte. À l’issue de son examen au fond, le Comité a rappelé que les États parties n’ont, en vertu de l’article 25 a), aucune obligation d’adopter des modalités spécifiques de démocratie directe, telles que les référendums. Toutefois, lorsqu’un mode de participation directe des citoyens est établi, il pèse sur l’État une obligation de non-discrimination dans la participation des citoyens et une obligation de s’abstenir d’imposer des restrictions déraisonnables susceptibles de constituer un obstacle à la réalisation du droit de participer directement à la conduite des affaires publiques. Le Comité a conclu au caractère déraisonnable de l’obligation de recueillir des signatures en présence d’agents de l’État ou d’élus qualifiés sans procédure adéquate pour garantir leur disponibilité. Il en va de même de l’absence de réponse de la part des autorités aux griefs qui leur sont soumis dans le cadre de la procédure.
En revanche, le Comité n’a pas constaté de discrimination fondée sur l’appartenance politique ou la situation économique des auteurs à travers la différenciation des traitements en fonction du statut économique de l’auteur observé dans la procédure d’authentification des signatures. Conformément à sa jurisprudence, le Comité a rappelé que toutes les différenciations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la situation financière, la naissance ou tout autre statut, telles qu’énumérées dans le Pacte, ne constituent pas une discrimination, lorsqu’elles sont fondées sur des critères raisonnables et objectifs dans la poursuite d’un objectif légitime au regard du Pacte. En l’espèce, le Comité a considéré que la différenciation est spécifiquement liée au système d’indemnisation des acteurs étatiques et au remboursement des frais. De même, il a considéré que la restriction peut avoir pour objectif légitime de préserver et de gérer les ressources publiques et d’éviter une utilisation excessive de ces ressources pour l’authentification des signatures dans le cadre des initiatives référendaires au détriment d’autres fonctions de l’administration publique. Le Comité reste attaché à sa jurisprudenceà la gestion des affaires publiques et de non-discrimination. Il toute modalité d’exercice du droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques établie par les États ne doit comporter aucune mesure discriminatoire ou des restrictions susceptibles de compromettre sa réalisation, le Comité faisant ainsi référence à certains critères de justification du régime des restrictions fixés par l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
O. K. S.
Comité contre la torture
Comité contre la torture, M. Z. c. Belgique, 2 août 2019, communication n° 813/2017, CAT/C/67/D/813/2017.
Le Comité a déclaré la requête concernant la complicité de la Belgique dans la torture d’un ressortissant belge détenu à Guantanamo Bay irrecevable en application de l’article 22(5)(a) de la Convention contre la torture au motif que la « même question » a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), qui l’avait aussi déclarée irrecevable.
Mots-clés : irrecevabilité ; ne bis in idem.
N’ayant pu obtenir réparation en Belgique, le requérant a d’abord porté sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH). Celle-ci fut déclarée irrecevable le 2 juin 2016, par un juge unique et sans que les raisons de l’irrecevabilité ne soient détaillées. Le requérant a ensuite porté sa requête devant le Comité contre la torture.En l’espèce, le requérant, Mosa Zemmouri, a été détenu sur la base militaire états-unienne de Guantánamo Bay entre 2002 et 2005. Pendant sa détention, il a subi des violences brutales, de nombreuses privations sensorielles, ainsi que d’autres formes graves de sévices physiques et psychologiques infligés par les agents de l’administration américaine. Dans sa communication au Comité (§§ 3.1 à 3.6), M. Zemmouri allègue que des responsables belges étaient complices de ces abus du fait notamment de leurs nombreuses participations à ses interrogatoires, que la Belgique était au courant des actes de torture commis sur lui par les États-Unis mais n’a pas agi pour l’empêcher, et que les autorités belges n’ont par la suite pas mené d’enquête adéquate sur ces crimes, en violation des articles 2 (obligation de prévention), 6(1) et (2) (obligation de traduire en justice), 7(1) (obligation d’extrader), 10 (obligation de formation des agents de l’État), 12 (obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale), 13 (droit d’accès à la justice) et 14 (droit à une réparation adéquate) de la Convention contre la torture.
Les faits tels que présentés par le requérant ne sont pas contestés par le gouvernement belge. Celui-ci soulève en revanche à titre liminaire l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article 22(5)(a) de la Convention contre la torture (la Convention), au motif que la même question a déjà été examinée par la Cour EDH. Au soutien de son argument, le gouvernement belge affirme qu’en raison de la pratique de la Cour EDH, il peut être « présumé » que la Cour a déclaré la requête irrecevable pour des motifs liés aux mérites de l’affaire – en l’espèce les faits allégués par le requérant ne relèveraient pas de sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme – plutôt que pour des raisons procédurales de telles conditions de recevabilité apparaissant satisfaites en l’espèce (§§ 4.4 et 6.5). Le requérant rappelle pour sa part la jurisprudence constante du Comité en la matière et soulève, à titre subsidiaire, le fait que sa requête devant le Comité ne porte pas sur la « même question » puisque la Convention contre la Torture couvre un spectre de droits et d’obligations plus large que la Convention EDH (§§ 5.1 à 5.5).
Ayant joint l’examen de la recevabilité à celui du fond, le Comité doit néanmoins déterminer, en premier lieu, si une décision d’irrecevabilité non motivée adoptée par la Cour EDH correspond, aux termes de l’article 22(5)(a) de la Convention à l’« examen » de « la même question » par « une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ». Dans sa jurisprudence antérieure, le Comité avait conclu que les décisions d’irrecevabilité non-motivées, telle que celle du cas d’espèce, ne permettaient pas au Comité de vérifier si l’examen de l’affaire au fond avait été suffisant, et donc que le Comité n’était pas empêché par l’article 22(5)(a) d’examiner la requête11. Le Comité des droits de l’Homme suit un raisonnement similaire dans sa jurisprudence sous l’article 5(2)(a) du protocole facultatif lorsqu’une réserve de l’État étend la portée de l’article au-delà de la simple litispendance qui y est prévue pour y inclure le principe ne bis in idem, en considérant qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude qu’un examen du fond a eu lieu12.
En l’espèce, cependant, le Comité contre la torture a conclu que la Cour EDH avait déclaré la requête irrecevable au motif qu’elle est manifestement mal fondée. Cette formulation, qui reprend les termes de l’article 35(3)(a) de la Convention EDH, se réfère indirectement aux faits, et donc au fond, et a pour effet de motiver la décision de la Cour EDH à sa place. Cela permet au Comité de conclure que, l’affaire ayant déjà été examinée, elle est irrecevable en application de l’article 22(5)(a) de la Convention. Ce faisant, le Comité reprend implicitement l’argument du gouvernement belge selon lequel la Cour EDH aurait déclaré la requête irrecevable en raison de l’absence présumée de juridiction de la Belgique sur le requérant, et rompt ainsi avec sa jurisprudence antérieure, jusque-là constante.
Cette interprétation de l’article 22(5)(a) de la Convention est à regretter, pour plusieurs raisons. En se permettant, ultra vires, de motiver à sa place la décision de la Cour EDH, le Comité remet non seulement en cause la cohérence de sa propre jurisprudence, mais aussi, en se fondant sur un « soupçon d’examen » (Opinion individuelle (dissidente) de M. Abdelhawad Hani, §7) pour appliquer le principe ne bis in idem, il remet en cause le but même de ce principe censé éviter la double qualification. En l’appliquant au cas d’espèce malgré l’absence de tout examen préalable au fond par la Cour EDH, le Comité transforme ce principe en un instrument de maintien de l’impunité des États pour leurs violations des droits de l’Homme. Ce faisant, le Comité renonce à une rare et précieuse opportunité de se prononcer sur la complicité de torture au travers des activités de renseignement.
En outre, grâce à l’applicabilité ratione loci d’un plus grand nombre de dispositions de la Convention au cas d’espèce, il est possible de postuler que si la requête avait été admissible, une décision du Comité aurait été plus protectrice qu’une décision de la Cour EDH sur les mêmes faits. En effet, en raison de l’importance de la prohibition de la torture, la portée de la Convention contre la torture n’est pas limitée territorialement, et certaines de ses dispositions sont applicables sans considération de juridiction de l’État partie13. Ainsi, la complicité de torture commise en territoire étranger n’est pas soumise à l’établissement de la juridiction extraterritoriale de l’État complice14, ce qui n’est le cas qu’en matière d’extradition sous l’article 3 de la Convention EDH. La décision soulève ainsi, subsidiairement, l’incohérence et l’inadaptation de la notion de juridiction telle que développée par une majorité des organes de protection des droits de l’Homme en matière de complicité de torture.
Par ailleurs, outre leur meilleure applicabilité ratione loci, les obligations de l’État sont bien plus diverses et plus substantiellement développées sous la Convention contre la torture, et l’actus reus de complicité peut prendre de nombreuses formes que la Convention EDH ne connait pas. Cela, d’autant plus en matière de renseignement et d’interrogatoire, le sujet de l’espèce. Il convient donc de conclure, avec M. Abdelhawad Hani (Opinion individuelle (dissidente), §§ 9 et 10), que puisque la Convention couvre un spectre de droits et d’obligations spécifiques plus larges que l’article 3 de la Convention EDH, la requête présentée au Comité ne portait de fait pas sur la « même question » que celle présentée à la Cour EDH, et aurait dû être examinée au fond.
Cette décision soulève de manière prégnante la question de l’accessibilité des mécanismes de protection des droits de l’Homme aux victimes de violations et rappelle que toute « erreur » dans le choix du mécanisme par le requérant peut être fatale à l’obtention de la justice et à la mise en œuvre de la responsabilité de l’État en matière de torture.
S.D.
Comité contre la torture, A. c. Bosnie-Herzégovine, 2 août 2019, communication n° 854/2017, CAT/C/67/D/854/2017.
Le Comité constate que la Bosnie-Herzégovine a méconnu ses obligations découlant des articles 14 et 1 de la Convention contre la torture. L’État doit non seulement s’assurer que la victime perçoive concrètement la réparation qui lui est accordée par décision de justice, quand bien même le débiteur n’est pas en mesure de s’acquitter de son obligation pécuniaire, et il doit, d’autre part, tout faire pour permettre à la victime d’obtenir réparation, ce qui implique la suppression de limites légales visant à restreindre ce droit.
Mots-clés : Réparation ; torture ; obligation de l’État ; insolvabilité de l’auteur de l’infraction ; limitation du droit à obtenir réparation.
« Le conflit en Bosnie-Herzégovine sera le plus meurtrier de la période qui a suivi l’éclatement de la fédération yougoslave […] On estime à plus de 100 000 le nombre de tués […] Des milliers de femmes bosniaques sont violées »15. Parmi ces nombreuses femmes, il y a A., violée en 1992 par un membre de la « Vojska Republike Srpske », qui attend aujourd’hui encore d’obtenir la réparation financière que la justice bosniaque lui a octroyé par une décision rendue en 2015. En effet, jugé en tant qu’auteur de crimes contre les populations civiles pendant le conflit, Slavko Savic a été condamné à payer une compensation financière à A., dans les 90 jours qui suivirent la décision du 29 juin 2015, ce qu’il ne fit pas, par manque de moyens (§§2.6 et 2.7). Lorsque la victime tenta en vain d’obtenir le paiement, la justice lui fit savoir, d’une part qu’elle ne pourrait avoir gain de cause du fait de l’insolvabilité de la partie adverse, et d’autre part, qu’elle n’aurait pas de recours alternatif pour obtenir réparation puisque la législation bosniaque avait instauré une limite temporelle à la recevabilité des requêtes en réparation, quand bien même la gravité du crime en question pouvait le rendre imprescriptible aux yeux du droit international (§2.9).
Visiblement privée de tout moyen pour obtenir les réparations qui lui étaient dues, A. saisit donc le Comité contre la torture (ci-après « le Comité »), en alléguant que la Bosnie-Herzégovine a méconnu ses obligations au titre des articles 14 (droit à réparation) et 1 (définition de la torture) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants16 (ci-après « la Convention ») (§2.12).
Le Comité a ainsi eu à se prononcer sur la question de savoir si l’État pouvait se soustraire à son obligation de réparation, d’une part du fait de l’incapacité de l’auteur de la violation à s’acquitter de la réparation financière déterminée par décision de justice, et d’autre part, par une limitation temporelle de l’accès à la justice pour les victimes.
Sa réponse est tout aussi prévisible qu’elle est ferme. Après avoir confirmé que les actes allégués relevaient bien du domaine d’application de l’article 1 de la Convention (définition de la torture) (§7.3), le Comité a cherché à déterminer si la Bosnie-Herzégovine s’était acquittée de l’obligation de réparation qui est consécutive au constat de torture, conformément à l’article 14 (droit à réparation) lu en corrélation avec l’article 1 précité (§7.4). Tout d’abord, concernant les actions que l’État était tenu de mettre en œuvre pour permettre un accès aux mécanismes de réparation conformes à l’esprit de la Convention, le Comité a rappelé que d’après les obligations procédurales et substantielles qui découlent de l’article 14 de la Convention, l’État est tenu d’instaurer légalement des mécanismes pour permettre aux victimes de pouvoir demander réparation de façon concrète et effective, le droit à réparation n’étant pas un droit illusoire. Il a également précisé que l’instauration de limites temporelles pour obtenir réparation pour un crime si grave qu’il en est imprescriptible selon le droit international, et dont les effets continuent de se faire ressentir chez la victime, méconnaissait profondément les droits de celle-ci (§7.5). Le Comité a aussi insisté sur le fait que l’État est aussi tenu de s’assurer que les victimes obtiennent réellement une réparation, non seulement d’ordre financier, mais également une assistance médicale, psychologique, etc… (§7.5). En constatant que la Bosnie-Herzégovine n’a pas permis à la victime d’obtenir la moindre réparation, (hormis la décision de justice laissée sans suite faute de solvabilité de la partie adverse), assistance ou soutien, mais qu’à l’inverse elle a cherché à restreindre ses possibilités d’actions, le Comité a conclu à la violation de l’article 14 (§7.5). Toutefois, même s’il peut être objecté qu’il y a bien eu une décision de justice octroyant réparation à la victime, le Comité a considéré qu’il pèse sur l’État une responsabilité subsidiaire en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de son obligation (§7.6), et en a conséquemment conclu que la Bosnie-Herzégovine a également manqué à son devoir de réparation découlant de l’article 14 à cet égard (§8).
En considérant que la Bosnie-Herzégovine a doublement méconnu ses obligations au titre des articles 14 et 1 de la Convention, le Comité a bien souligné que les États étaient tenus, d’une part, de tout mettre en œuvre pour permettre aux victimes de bénéficier d’un éventail de mesures réparatrices en s’abstenant de porter atteinte à ce droit, et d’autre part, d’offrir à la victime une réparation financière réelle, qui va au-delà du seul prononcé de la décision en sa faveur, et ce indépendamment de la solvabilité de la partie chargée d’indemniser.
Cette décision, bien que prévisible, s’inscrit dans la continuité non seulement de sa jurisprudence17, mais également de son Observation générale n°3 (sur l’application générale de l’article 14 par les États Parties18) et confirme d’une part, l’existence d’un mouvement remarquable en faveur de l’amélioration des mesures de réparation octroyées aux victimes au niveau international, et d’autre part, qu’au niveau national, les mécanismes de réparation sont encore lacunaires quand bien même les juges internes sont au premier plan dans ce processus.
K. V.
Comité contre la torture, Cevdet Ayaz c. Serbie, 2 août 2019, communication n° 857/2017, CAT/C/67/D/857/2017.
Dans ses constatations Cevdet Ayaz c. Serbie rendues le 2 août 2019, le Comité contre la torture conclut à la violation des articles 22 (1) et 3 de la Convention contre la torture en raison du renvoi par la Serbie du requérant en Turquie alors qu’une demande de mesures provisoires avait été émise par le groupe d’experts et qu’une évaluation des risques pour lui d’y être soumis à la torture n’avait pas été effectuée par la Serbie.
Mots clefs : mesures provisoires ; extradition en Turquie ; non-évaluation des risques ; prévention de la torture.
Le 30 novembre 2016, après avoir pris la fuite pour l’Allemagne à la suite de cette décision, il fut arrêté à la frontière entre la Serbie et la Bosnie Herzégovine en raison d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par la Turquie. La Haute Cour de Šabac rendit une décision le 19 janvier 2017 sur l’extradition du requérant, considérant que toutes les conditions relatives à son renvoi en Turquie étaient remplies (§2.8). Cette dernière fut toutefois infirmée le 23 février 2017 par la Cour d’appel de Novi Sad, jugeant que l’interprétariat offert à l’auteur en première instance n’était pas adéquat et que l’infraction sur la base de laquelle il avait été condamné en Turquie n’était pas établie (§2.10). Le requérant, de nationalité turque et activiste politique kurde, fut arrêté le 6 avril 2001 par des gendarmes et des forces de lutte contre le terrorisme turcs avant d’être placé en garde à vue. Il fut par la suite détenu incommunicado durant plus de 10 jours, période pendant laquelle il prétend avoir été torturé et à l’issue de laquelle on lui aurait extorqué des confessions de culpabilité sur sa participation à l’activité du Revolutionary Party of Kurdistan (PSK). Le 27 novembre 2012, après plus de 11 ans d’investigation, il fut condamné à 15 ans d’emprisonnement par la Cour de Diyarbakir pour son implication dans une organisation armée, le PSK (§2.6). Sa condamnation fut confirmée par la Cour Suprême le 6 avril 2016 (§2.7).
Le 1er décembre 2017, malgré trois précédentes infirmations par la Cour d’appel de Novi Sad, la Haute Cour de Šabac confirma, une nouvelle fois, l’extradition de l’auteur (§2.18). Craignant alors un renvoi en Turquie, le requérant introduisit auprès du Comité contre la torture une communication le 7 décembre 2017 dans laquelle il alléguait le risque qu’il encourait d’être torturé s’il y était extradé. Le Comité émit en conséquence une demande de mesures provisoires à la Serbie le 11 décembre 2017. Le 14 décembre 2017, la Cour d’appel de Novi Sad confirma la décision de première instance. La Cour considéra toutefois que l’extradition du requérant était subordonnée à la vérification par le Ministre de la Justice serbe que la demande par la Turquie ne soit pas émise à des fins politiques (§4.4). Or, ce dernier se prononça en faveur de l’extradition du requérant le 15 décembre 2017. L’auteur de la communication fut en conséquence renvoyé vers la Turquie dans la nuit du 25 décembre 2017.
Le Comité doit alors se prononcer sur deux questions principales au regard des exigences de la Convention. Tout d’abord, il doit apprécier les conséquences juridiques du non-respect des mesures provisoires émises à l’égard de la Serbie. Ensuite, il doit établir si l’extradition du requérant vers la Turquie contrevenait, en elle-même, à l’article 3 de la Convention à raison d’un risque pour lui d’y être soumis à la torture.
Vis-à-vis de la première de ces deux questions, le Comité observe que l’État partie a fait une déclaration sur la base de l’article 22 (1) de la Convention reconnaissant sa compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers prétendant être victimes de violations. Une telle reconnaissance de compétence emporte implicitement l’engagement de l’État de coopérer de bonne foi avec le Comité en lui donnant les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen de ces dernières, de communiquer ses commentaires à l’État partie et au requérant. En ne respectant pas la demande de mesures provisoires lui ayant été transmise le 11 décembre 2017, ce dernier a donc violé ses obligations en vertu de l’article 22 de la Convention puisqu’il a fait obstacle à ce que le Comité examine pleinement la communication de l’auteur et a neutralisé sa capacité à prendre une décision qui aurait pu effectivement empêcher l’extradition de l’auteur en Turquie et constater une violation de l’article 3 de la Convention19 (§7.3). Cette position du Comité consacrant le caractère obligatoire des mesures provisoires est partagée par d’autres organes de protection des droits de l’Homme20. Elle fut toutefois contestée dans le passé. Dans ses opinions individuelles, Alessio Bruni faisait à ce titre valoir que « [l]es mesures provisoires sont prévues à l’article 114 du Règlement intérieur du Comité, auxquelles l’État partie n’a pas adhéré, et ne figurent pas à l’article 22 de la Convention, à laquelle, à l’inverse, l’État partie a adhéré librement ». 21 Sur ce point donc, le Comité maintient sa jurisprudence classique en la matière, considérant que la violation de l’article 22 découle d’une absence de coopération de bonne foi avec lui, l’empêchant alors d’examiner effectivement la requête soumise à lui, ce que prévoit justement l’article 22 de la Convention.
Une discrète rectification est toutefois notable puisque les experts abandonnent la formule utilisée auparavant selon laquelle l’État partie avait « gravement contrevenu » (seriously failed) à ses obligations découlant de l’article 22 – et plus précisément son adverbe « gravement » – pour conclure à une simple violation en l’espèce22. Une telle formulation pouvait alors suggérer qu’il existe divers degrés de violation des dispositions de la Convention contre la torture, sans pourtant que cela ne soit justifié par le Comité sur le plan juridique ou conceptuel.
Ensuite, sur la seconde question, celle de l’extradition de l’auteur, le Comité rappelle classiquement que la prohibition de la torture est absolue (§9.2) et que pour établir s’il existe des motifs sérieux de croire que la victime présumée risquerait d’être soumise à la torture il faut tenir compte de toutes les considérations pertinentes y compris l’existence de violations systémiques des droits de l’Homme dans le pays de renvoi. Le but étant d’établir que le requérant encourt un risque personnel d’être soumis à la torture s’il venait à être renvoyé (§9.3), lequel doit être « prévisible, personnel, actuel et réel » 23 (§9.4).
D’une part vis-à-vis de la situation générale des droits de l’Homme en Turquie, le Comité note, comme dans une série d’affaires précédentes24, que l’état d’urgence y était déclaré jusqu’en juillet 2018, que ses prolongations successives ont conduit à des violations profondes des droits de l’Homme envers des centaines de milliers de personnes (§9.6) et enfin que les préoccupations relatives à la prévention de la torture exprimées à l’occasion du quatrième rapport périodique de la Turquie en 2016 restent d’actualité et pertinentes (§9.7). D’autre part, en ce qui concerne la situation personnelle du requérant, le Comité observe que ni l’Asylum Office, ni les différentes juridictions n’ont réalisé une évaluation du risque de torture qu’impliquerait son extradition. Le Ministre de la Justice serbe n’a pas non plus vérifié si les charges retenues contre l’auteur en Turquie étaient de nature politique. En conséquence, l’État a méconnu son obligation de procéder à une évaluation individualisée du risque personnel et réel encouru par le requérant d’être exposé à la torture en Turquie. De plus, les documents relatifs à sa condamnation en Turquie ne furent pas adéquatement traduits par l’État partie. Ainsi le Comité est d’avis que la Serbie a échoué à établir si sa condamnation était basée sur des confessions extorquées sous la torture (§9.9). En prenant en compte tous ces éléments, il y a alors lieu de considérer que le renvoi du requérant en Turquie emporte la violation de l’article 3 de la Convention (§9.10).
En dernier lieu, le Comité rappelle classiquement qu’une obligation de réparation incombe à l’État partie, laquelle consiste notamment en une indemnisation suffisante des préjudices subis par le requérant ainsi que la recherche de moyens d’opérer un suivi des conditions de sa détention en Turquie (§11).
O.P.
Comité contre la torture, ELG c. Espagne, 26 novembre 2019, communication n° 818/2017, CAT/C/68/D/818/2017.
Le Comité est amené à se prononcer sur la violation par les autorités espagnoles de la Convention contre la torture, en raison d’actes commis lors de l’arrestation et la détention de la requérante.
Mots-clés : traitements cruels, inhumains ou dégradants, conditions de détention, enquête.
La présente communication conduit le Comité contre la torture à s’interroger sur le respect de la Convention par l’Espagne dans le cadre des contrôles de police et des arrestations. En l’espèce, la requérante allègue avoir été frappée, à de multiples reprises, lors de son arrestation et lors de son transfert au poste de police (pt. 2.1). La recevabilité de la communication prêtait à discussion sur un point particulier : la compétence ratione materiae du Comité pour connaître de l’absence de notification des droits de la personne arrêtée. L’État partie considère que cette question relève du champ matériel du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et non de la Convention contre la torture. Le Comité rappelle cependant son observation générale n°225 qui précise la nécessité de garantir certains droits aux personnes privées de liberté, notamment celui de se voir notifier leurs droits, celui d’obtenir une assistance juridique ainsi qu’une assistance médicale (pt. 7.2). Le grief tiré de l’absence de notification des droits est cependant irrecevable en l’espèce, faute pour la requérante d’avoir invoqué celui-ci dans le cadre de la procédure nationale (pt. 7.3). C’est ainsi que le Comité doit, en l’espèce, statuer sur trois points : l’existence de traitements cruels, inhumains ou dégradants imputables à l’État, la qualité de l’enquête et le refus d’aide médicale. S’agissant tout d’abord de l’existence de traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité considère que les actes litigieux constituent a minima de tels traitements (pt. 8.2). S’agissant ensuite de l’imputation de ces actes à l’État, le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe normalement au requérant. Cependant, si la situation du requérant l’empêche de produire de telles preuves, la charge de la preuve est renversée. En l’espèce, le Comité considère que les faits justifient un tel renversement de la charge de la preuve. Or, l’État n’a pas prouvé que les blessures de la requérante n’avaient pas été causées durant son arrestation et sa détention. Le Comité conclut donc que « there was prima facie evidence of cruel, inhuman or degrading treatment, which has not been refuted by the State party » (pt. 8.4). S’agissant ensuite de la prétendue violation de l’article 12 – garantissant le droit à une enquête immédiate et impartiale – le Comité conclut à l’absence de violation (pt. 8.5). S’agissant enfin du refus des autorités de délivrer une aide médicale à la requérante, le Comité considère qu’il y a violation des articles 2 et 11 de la Convention – prévoyant respectivement une obligation générale de prévention des actes de torture et une obligation spécifique de surveillance des conditions de privation de liberté – en raison de la carence de l’État (pt. 8.6). Le Comité conclut donc à la violation de l’article 2(1) de la Convention, combiné à l’article 16, à la violation de l’article 11, seul et combiné à l’article 2 et enfin, à la violation de l’article 16. Par cette décision, le Comité réaffirme la nécessité d’une vigilance particulière de l’État dans le cadre des arrestations et, a fortiori, de l’ensemble des activités des autorités de police.
C.M.
Comité des droits des personnes handicapées
Comité des droits des personnes handicapées, Z. c. République Unie de Tanzanie, 19 septembre 2019, communication n° 24/2014, CRPD/C/22/D/24/2014.
Les constatations rendues dans l’affaire Z. contre République Unie de Tanzanie le 19 septembre 2019 réaffirment fermement l’interprétation par le Comité du droit des personnes handicapées selon laquelle les personnes atteintes d’albinisme bénéficient des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Mots-clés : Discrimination contre une personne atteinte d’albinisme ; définition d’une personne handicapée ; torture et traitements inhumains et dégradants ; respect de l’intégrité mentale et physique ; droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance.
L’auteure de la communication, de nationalité tanzanienne et atteinte d’albinisme, fut attaquée par deux individus armés d’une machette la nuit du 17 octobre 2008 pendant qu’elle dormait avec son enfant et alors qu’elle était enceinte. Ses assaillants lui mutilèrent un bras, lequel fut amputé une fois arrivée à l’hôpital, et lui coupèrent l’autre avec lequel ils s’enfuirent. À la suite de cette attaque, elle fit une fausse couche et se retrouva dans l’incapacité de subvenir à ses besoins seule.
En 2011, alors que trois suspects furent arrêtés, les poursuites aboutirent à un retrait des charges pour deux d’entre eux et un acquittement pour le dernier, le standard des preuves n’ayant pas été atteint en l’espèce. L’auteure prétend que pendant ces procédures il ne fut pas suffisamment donné d’importance à son témoignage selon lequel elle aurait reconnu un des suspects. Celui-ci ne fut pas retenu au motif notamment que son acuité visuelle était déficiente.
Il est reproché à l’État partie par l’auteure de ne pas avoir pris les mesures appropriées pour la protéger d’une attaque découlant d’une pratique systématique visant les personnes atteintes d’albinisme. De plus, les procédures internes n’auraient pas été effectives, la République Unie de Tanzanie n’ayant pas poursuivi ses assaillants avec la diligence requise. Elle allègue à ce titre une violation des articles 5 (non-discrimination des personnes handicapées), 6 (non-discrimination des femmes handicapées), 8 (obligation de sensibilisation de la population), 10 (droit à la vie), 14 (droit à la liberté et sécurité), 15 (1) (droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), 16 (droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance) et 17 (droit à la protection de l’intégrité de la personne) de la Convention.
Avant de se prononcer sur le fond, le Comité décide de soulever de sa propre initiative la question de sa compétence ratione materiae. L’enjeu de cette communication résidant notamment dans le fait de savoir si les personnes atteintes d’albinisme doivent être comprises comme des « personnes handicapées » au sens de la Convention (article 1er) et bénéficier par conséquent de ses dispositions. A cette fin, le Comité mobilise un Rapport de l’Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’Homme par les personnes atteintes d’albinisme26 qui définit précisément cette maladie génétique. Cette définition, reliée au préambule de la Convention, lequel exige de prendre en compte la diversité des personnes handicapées (al. i) et de reconnaître l’interaction des personnes présentant des incapacités avec les barrières comportementales et environnementales (al. e), lui permet de conclure que les individus atteints d’albinisme sont bien visés par cette dernière. Partant, le Comité a compétence pour connaître de cette communication. Cette position n’est pas inédite puisqu’elle avait déjà été affirmée par ce dernier dans deux affaires précédentes également contre la République Unie de Tanzanie27.
Sur le fond, le Comité va conclure à la violation des articles 5, 15(1), 16 et 17, lus seuls, ainsi que les articles 6 et 8 lus conjointement avec les premiers de la Convention. Plus précisément, le Comité considère que l’attaque dont l’auteure a été la victime correspond à une pratique visant exclusivement les personnes atteintes d’albinisme. L’État partie n’a, à ce titre, pas pris de mesures effectives pour prévenir de tels actes ce qui a mis l’auteure et les autres personnes atteintes d’albinisme dans une situation de vulnérabilité en relation avec l’article 5 de la Convention. L’accès à la justice pour l’auteure a également été significativement limité puisqu’aucune enquête n’a été menée après le retrait des charges et l’acquittement des suspects, l’impunité des auteurs de l’attaque étant la plus totale 11 ans après l’évènement. Le Comité conclut qu’elle a donc été victime d’une discrimination directe fondée sur son handicap en violation de l’article 5 de la Convention.
Concernant le droit de l’auteure à ne pas être soumise à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité rappelle classiquement que l’obligation à la charge de l’État s’y afférant couvre autant les violences d’origine publique que privée. Si un fait d’origine privée ne peut pas être qualifié de torture, il demeure que les autorités ont l’obligation de prévenir et réprimer de telles violences. Or, en notant de nouveau que la poursuite des assaillants n’a pas été effective, le Comité considère que l’auteure a été mise dans une situation de « revictimisation » constituant une forme de torture ou de mauvais traitements psychologiques (§8.6). Dès lors, l’article 15 (1) de la Convention a bien été méconnu.
Quant au droit de l’auteure au respect de son intégrité mentale et physique prévu par l’article 17 de la Convention, il est noté que celui-ci englobe les traitements prohibés par l’article 15 ainsi que d’autres atteintes moins graves à l’intégrité physique et mentale d’une personne. Dès lors, le constat de violation dudit article entraine également la violation de l’article 17. De plus, alors que l’article 16 (4) prévoit une obligation de mise en place de mesures pour faciliter le rétablissement et la réinsertion de toute victime de violences liées à son handicap, il est noté que l’État n’a fourni aucun support à l’auteure pour qu’elle puisse vivre de manière indépendante après la perte de ses bras. En conséquence, le Comité constate également la méconnaissance des engagements de la Tanzanie sur la base de l’article 16 (4) de la Convention.
Il observe également que l’État n’a pas pris en compte le caractère genré des violences subies par l’auteure, consacrant ainsi en l’espèce la dimension multifactorielle de ces dernières. Une telle « invisibilisation » (§8.9) vaut en l’espèce violation de l’article 6 consacrant le droit des femmes handicapées à ne pas être discriminées, lu conjointement avec les articles 5, 15 (1), 16 et 17 de la Convention. Quant à l’article 8, le Comité observe que l’État partie n’a pas pris les mesures suffisantes pour sensibiliser la population. Il s’agit aux yeux des experts du Comité d’une acceptation implicite des crimes haineux commis à l’égard des personnes atteintes d’albinisme ce qui entraîne la violation dudit article lu conjointement avec les précédents.
Ces observations s’inscrivent ainsi dans la lignée des autres affaires examinées par le Comité et rendues à l’égard de la Tanzanie. Elles permettent d’ancrer encore davantage le principe selon lequel les États parties à la Convention ont l’obligation en vertu de cette dernière de protéger et promouvoir les droits des personnes atteintes d’albinisme, et de consolider ainsi la jurisprudence récemment initiée par le Comité. Outre le renforcement de ce principe, on se satisfera également du choix des termes employés, au travers notamment des expressions de « revictimisation » ou d’« invisibilisation », exposant avec justesse la situation des personnes, et plus précisément des femmes, atteintes d’albinisme dans de tels contextes.
O. P.
Comité des droits de l’enfant
Comité des droits de l’enfant, D.D. c. Espagne, 1er février 2019, communication n°4/2016, CRC/C/80/D/4/2016.
Le Comité constate la violation par l’État des obligations qui lui incombaient de vérifier l’identité et d’évaluer la situation d’un mineur non accompagné, quand bien même celui-ci aurait été intercepté à sa frontière.
Mots-clés : intérêt supérieur de l’enfant ; non-refoulement ; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Les constatations adoptées par le Comité des droits de l’enfant (ci-après le Comité) concernent la communication d’un ressortissant malien, portant sur les circonstances dans lesquelles il a été arrêté puis refoulé à la frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole de Melilla, par la garde civile espagnole, alors même qu’il était mineur au moment des faits. En l’occurrence, dans une énième tentative pour franchir la frontière, le concerné avait grimpé en haut des grillages, y demeurant plusieurs heures par peur, selon lui, d’être expulsé et assujetti aux mauvais traitements des forces marocaines. Après une longue attente, durant laquelle aucune forme d’assistance ne lui a été proposée par les autorités espagnoles, il est finalement descendu des grilles. Sitôt qu’il eut posé le pied sur le territoire espagnol, il fut arrêté puis menotté avant d’être sommairement expulsé vers le Maroc. Le Comité devait donc examiner si en agissant de la sorte, l’Espagne, par le truchement de ses forces de police, s’était acquittée de ses obligations issues de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après la Convention). Il a conclu à la violation des articles 20 (protection et assistance dues aux mineurs non accompagnés), 37 (interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et 3 (relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant) de la Convention.
Dans son examen au fond, le Comité a ainsi rappelé que les obligations qui incombent à l’État-partie, au titre de l’article 20 de la Convention, s’appliquent « y compris à l’égard des enfants qui passent sous sa juridiction en tentant de pénétrer sur son territoire » 28 et que « le versant positif de ces obligations […] englobe l’obligation pour l’État de prendre aussitôt que possible toutes les mesures nécessaires pour déterminer si un enfant est non accompagné ou est séparé, notamment à la frontière (…) » 29.
S’agissant de l’article 37 et conformément au principe de non-refoulement, le Comité a précisé, à nouveau, que l’État-partie ne doit pas « renvoyer un enfant à la frontière s’il y a des motifs sérieux de croire que cet enfant sera exposé à un risque réel de dommage irréparable […] dans ledit pays ou dans tout autre pays vers lequel l’enfant est susceptible d’être transféré ultérieurement (…) » 30. Enfin, le Comité a souligné que dans le contexte de l’évaluation de l’intérêt supérieur et dans le cadre des procédures de détermination de l’intérêt supérieur, les enfants ont « le droit d’avoir accès au territoire, qu’ils aient ou non des documents et quels que soient les documents en leur possession, et le droit d’être dirigés vers les autorités chargées d’évaluer leurs besoins en matière de protection de leurs droits »31.
Par ses constatations, le Comité rappelle l’illicéité des expulsions sommaires de mineurs non accompagnés aux frontières. Il se distingue en ce sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et plus particulièrement de l’arrêt rendu par sa Grande chambre récemment sur des faits similaires, mais concernant des ressortissants étrangers majeurs. Dans l’affaire N.D. et N.T. c. Espagne32, celle-ci a en effet conclu à la non-violation de l’article 4 du Protocole n°4 (interdiction des expulsions collectives) de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la Convention EDH) combiné avec l’article 13 de la Convention EDH (droit à un recours effectif). En l’occurrence la Cour EDH a considéré que « l’absence de procédure individualisée d’éloignement était la conséquence du propre comportement des requérants33 » et qu’elle « ne saurait tenir l’État défendeur pour responsable de l’absence à Melilla d’une voie de recours légale qui leur aurait permis de contester le dit éloignement34 ».
M-L. L.
Comité des droits de l’enfant, A.L. c. Espagne et J.A.B c. Espagne, 31 mai 2019, communications n°16/2017 et 22/2017, CRC/C/81/D/22/ 017 ; M.T. c. Espagne et R.K. c. Espagne, 18 septembre 2019, communications n°17/2017 et 27/2017, CRC/C/82/D/27/2017.
Le Comité considère que la procédure de détermination de l’âge (compte tenu en particulier du test osseux utilisé pour le déterminer) à laquelle ont été soumis les auteurs des communications, qui affirmaient être des enfants, n’a pas été assortie des garanties nécessaires pour protéger les droits que ceux-ci tiennent de la Convention.
Mots-clés : intérêt supérieur de l’enfant ; droit à l’identité ; mineurs non accompagnés ; détermination de l’âge ; tests osseux.
Les constatations adoptées par le Comité des droits de l’enfant (ci-après le Comité) dans les affaires susmentionnées concernent les communications de ressortissants algérien, camerounais, ivoirien et guinéen, concernant les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la procédure de détermination de leur âge par la justice espagnole, alors qu’ils étaient mineurs et non accompagnés au moment des faits. En l’occurrence, les concernés étaient arrivés sur le territoire espagnol où il n’avait été tenu aucun compte des documents d’identité présentés par certains d’entre eux dans la procédure de détermination de leur âge, qui a finalement conclu à leur majorité sur la seule base des résultats d’examens osseux ou de leur refus de s’y soumettre. Cette procédure s’est d’ailleurs déroulée sans que les intéressés ne se soient vu désigner un tuteur ou un représentant pour défendre leurs intérêts en leur qualité présumée d’enfant. Le Comité devait donc examiner si, dans les circonstances propres à chacune de ces affaires, la procédure de détermination de l’âge à laquelle ont été soumis les auteurs des communications, constitue une violation de leurs droits garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après la Convention). Le Comité a généralement conclu à la violation des articles 3 (intérêt supérieur de l’enfant), 8 (droit à l’identité), 12 (droit de l’enfant d’être entendu) et 20.1 (protection et assistance dues aux mineurs non accompagnés) de la Convention. Dans son examen au fond, il a rappelé, s’agissant de la protection spéciale de l’article 20.1, que « la détermination de l’âge d’une jeune personne qui affirme être mineure revêt une importance capitale, puisque le résultat de cette procédure permet d’établir si la personne en question peut ou non prétendre à la protection nationale en qualité d’enfant […]. De même la jouissance des droits énoncés dans la Convention est liée à cette détermination35 » (A.L. c. Espagne § 12.3 ; J.A.B c. Espagne § 13.3 ; M.T. c. Espagne § 13.2 ; R.K. c. Espagne § 9.3). En outre, conformément aux articles 3 et 12 (combinés) de la Convention « le fait de faciliter la représentation de ces personnes au cours de la procédure de détermination de l’âge revient à leur accorder le bénéfice du doute et constitue une garantie essentielle pour le respect de leur intérêt supérieur et de leur droit d’être entendus36 » (A.L. c. Espagne § 12.8 ; J.A.B c. Espagne § 13.7 ; M.T. c. Espagne § 13.5 ; R.K. c. Espagne § 9.8). Par ailleurs, en ce qui concerne la présentation de documents d’identité dans cette procédure de détermination de l’âge, le Comité a rappelé que « les documents qui sont disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire37 » (J.A.B c. Espagne et M.T. c. Espagne § 13.4). En l’absence de documents d’identité ou d’autres moyens appropriés, le Comité a souligné que pour obtenir une estimation éclairée de l’âge, « les États doivent faire procéder à une évaluation complète du développement physique et psychologique de l’enfant par des pédiatres, des spécialistes et d’autres professionnels capables d’examiner conjointement différents aspects du développement38 » (A.L. c. Espagne § 12.4 et R.K. c. Espagne § 9.4). Enfin, pour ce qui est des tests osseux, le Comité a été clair : « les États doivent s’abstenir de recourir à des méthodes médicales fondées sur les analyses osseuses et dentaires, qui peuvent non seulement être imprécises et présenter de grandes marges d’erreur, mais aussi être traumatisantes et entraîner des procédures juridiques inutiles39 » (A.L. c. Espagne §12.4 et R.K. c. Espagne §9.4). Cette dernière observation du Comité se distingue considérablement de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 21 mars 201940. En l’occurrence, les « Sages » de la rue de Montpensier avaient été saisis d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l’article 388 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant. Cet article qui prévoit le recours, très controversé, à des « examens radiologiques osseux aux fins de déterminations de l’âge en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable » a été déclaré conforme à la Constitution. Tout en reconnaissant « la marge d’erreur que peuvent comporter les résultats de ce type d’examen41 », le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que « compte tenu des garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux […] le législateur n’a pas méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant (…) de la Constitution de 1946 »42.
M-L. L.
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, O.M c. Ukraine, 19 juillet 2019, communication n° 87/2015, CEDAW/C/73/D/87/2015.
Le Comité condamne l’Ukraine pour violation de la Convention pour n’avoir pas porté protection, assistance et appui à une de ses ressortissantes victime de violence fondée sur le genre en Jordanie. Bien que la protection consulaire n’entre pas dans le champ d’application de la Convention, le Comité met à la charge de l’Ukraine l’obligation de l’exercer auprès de ses ressortissants.
Mots-clés : Violence domestique, protection consulaire.
L’auteure de la communication (O.M) est une ressortissante ukrainienne, mariée à un ressortissant jordanien et résidente en Jordanie, victime pendant plusieurs années des maltraitances physiques, psychologiques et financières de la part de son mari. Malgré ses demandes auprès de l’ambassade d’Ukraine à Amman afin d’obtenir de l’aide pour quitter le pays avec sa fille et une aide juridique, l’auteure n’a bénéficié d’aucune assistance. En effet, elle a comparu à plusieurs reprises devant le tribunal de la charia, sans être assistée par un fonctionnaire de l’ambassade, ni par un avocat ou un interprète. Les décisions des tribunaux jordaniens l’ont notamment amenée à perdre la garde d’une de ses filles et à devoir quitter la Jordanie. Les autorités ukrainiennes ont fait valoir, quant à elles, que l’auteure avait pu bénéficier d’un avocat jordanien et des recommandations de l’ambassade concernant ses droits en Jordanie en tant que chrétienne. Elles soulignent également que l’auteure n’avait pas introduit une requête auprès du tribunal de la Charia afin d’obtenir la garde de sa fille cadette, ni fait appel à la police jordanienne et au département des droits de l’homme de la Jordanie pour s’assurer des conditions de vie de sa fille.
Au vu des arguments des deux parties, le Comité a déclaré la communication recevable, à l’exception de la partie de la communication de l’auteure concernant la non-exécution des décisions des tribunaux ukrainiens en Jordanie qui prononçaient le divorce et accordaient à l’auteure la garde exclusive de ses filles. Selon le Comité, ce point ne pouvait pas être retenu contre l’Ukraine en l’absence d’un accord bilatéral sur l’aide juridique et la garde d’enfants entre cet État et la Jordanie (pt. 8.3). Le Comité a ensuite procédé à l’examen du fond de la communication. Au début de son analyse il souligne que l’État partie ne saurait être tenu responsable d’une discrimination commise par une juridiction étrangère, en l’espèce la Jordanie (pt. 9.2). Il fait observer que, bien que la protection consulaire n’entre pas dans le champ d’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’État « doit agir avec la diligence voulue pour protéger [ses ressortissants] lorsqu’ils sont victimes d’une violation de leurs droits fondamentaux, en particulier quand l’État partie est représenté à l’étranger » (pt. 9.2). Le Comité relève que la législation et la Constitution ukrainiennes consacrent un droit personnel et subjectif à la protection diplomatique, et que l’article 25 §3 garantit la prise en charge et la protection de ses citoyens à l’étranger. En outre, il se réfère à la Convention de Vienne sur les relations consulaires ratifiée par l’Ukraine qui définit en son article 5 les « fonctions consulaires » exercées par les services consulaires à l’étranger (pt. 9.5). Selon le Comité, « l’auteure, en tant qu’étrangère en situation de vulnérabilité et mère de conviction chrétienne dans un État gouverné par la charia avait été livrée à elle-même » (pt. 9.7) et n’avait pas reçu en temps voulu une assistance adéquate de la part de l’ambassade ukrainienne à Amman. Ces omissions ont enfreint les droits de l’auteure à une protection, une assistance et un appui en tant que victime de violence fondée sur le genre qui découlent des articles 2 (a) (d) et (f), 3 et 5 de la Convention (pt. 10). Par conséquent, le Comité recommande à l’État de veiller à l’effective mise en place de la protection consulaire ainsi que de fournir une aide juridique à ses ressortissantes à l’étranger qui s’estiment victimes et qui nécessitent assistance. Les membres du Comité recommandent également aux autorités ukrainiennes de veiller à ce que les agents consulaires suivent des formations relatives aux conventions ratifiées par leur État et de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à un accord avec la Jordanie sur l’entraide judiciaire et la garde d’enfant (pt. 11).
C.G.
- Voir CCPR, Yuba Kumari Katwal c. Népal, 5 mai 2015, communication n° 2000/2010, CCPR/C/113/D/2000/2010, §6.3.
- Voir Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, Nepal Conflict Report (2012), p. 131. https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/OHCHR_Nepal_Conflict_Report2012.pdf, consulté le 25 juin 2020.
- Voir CCPR, Bernadette Faure c. Australie, 31 octobre 2005, communication n° 1036/2001, CCPR/C/85/D/1036/2001.
- Voir CCPR, Purna Maya c. Népal, 17 mars 2017, communication n° 2245/2013, CCPR/C/119/D/2245/2013, §12.7.
- Le Comité des droits de l’Homme appelait déjà le Népal à adopter de telles mesures : voir CCPR, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Népal, 26 mars 2014, CCPR/C/NPL/CO/2.
- Voir CRC, observation générale n°17, 17 avril 2013, CRC/C/GC/17, §. 4, et CCPR, Monaco de Gallicchio c. Argentine, 2 avril, 1990, communication n° 400/1990, CCPR/C/53/D/400/1990, §§. 10.5 ; CCPR, Bakhtiyari et Bakhtiyari c. Australie, 29 octobre 2003, communication n° 1069/2002, CCPR/C/79/D/1069/2002, §§. 9.7.
- L’obligation pour les États de garantir à tous les individus présents sur leur territoire ou relevant de leur compétence la jouissance de l’ensemble des droits reconnus dans le Pacte sans aucune discrimination.
- Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à Y un recours utile. Il a l’obligation d’accorder pleine réparation aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés.
- CCPR, observation générale n° 18, 10 novembre 1989, CCPR/HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I).
- CCPR, observation générale n° 25, 12 juillet 1996, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7.
- Voir CAT, Jean Baptiste Mugimba c. Pays-Bas, 16 mai 2019, communication n° 768/2016, CAT/C/66/D/768/2016, §9.1 ; CAT, S c. Suède, 16 novembre 2018, communication n° 691/2015, CAT/C/65/D/691/2015, §§ 7.2-7.6 ; et CAT, H.A. c. Suède, 11 mai 2018, communication n° 744/2016, CAT/C/63/D/744/2016, §§ 6.3-6.6.
- CCPR, Miriana Hebbadj c. France, 17 juillet 2018, communication no 2807/2016, CCPR/C/123/D/2807/2016, §§ 6.2 à 6.4 ; CCPR, lzery c. Suède, 10 novembre 2006, communication n° 1416/2005, CCPR/C/88/D/1416/2005, § 8.1.
- Voir par exemple les articles 4 à 9, 14 et 15 de la Convention contre la torture.
- Bien que le terme de complicité ne soit pas défini dans la Convention, la définition de la torture à l’article 1 prévoit que les actes constituent de la torture lorsqu’ils sont commis « par ou à l’instigation ou avec le consentement ou l’acquiescement d’un agent public ou d’une autre personne agissant en une qualité officielle ». En référence à l’article 1, la complicité sous l’article 4 a donc été interprétée comme incluant l’incitation, l’instigation, les ordres ou instructions supérieurs, le consentement, l’acquiescement et la dissimulation. En ce sens, bien qu’indirectement, l’article 4 impose aux États l’obligation de ne pas se rendre complices de torture par les actes de leurs officiels, sans limitation territoriale.
- Source : site internet du Tribunal Pénal international pour l’ex-Yougoslavie (https://www.icty.org/fr/le-tribunal-en-bref/quest-ce-que-lex-yougoslavie/les-conflits)[consulté le 25/06/2020].
- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, Nations Unies, Recueil des traités, vol.1465, p.85.
- Voir en ce sens par exemple : CAT, Hajrizi Dzemajl et al. v. Yugoslavia, 21 novembre 2002, communication n° 161/2000, CAT/C/29/D/161/2000 ; CAT, Agiza c. Suède, 20 mai 2005, communication n° 233/2003, CAT/C/34/D/233/2003 ; CAT, E.N c. Burundi, 25 novembre 2015, communication n° 578/2013, CAT/C/56/D/578/2013 ; Comité contre la torture, Taoufik Elaïba c. Tunisie, 6 mai 2016, communication n°551/2013, CAT/C/57/D/551/2013.
- Voir CAT, observation générale n°3, 13 décembre 2012, CAT/C/GC/3, 13.
- Pour un raisonnement similaire, voir CAT, Thirugnanasampantha c. Australie, 9 août 2017, communication n° 614/2014, CAT/C/61/D/614/2014, §6.3.
- Voir par exemple Cour EDH [GC], Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2009, req. n°46827/99 et 46951/99, §128 ; CCPR, Piandiong et al c. Philippines, 19 octobre 2000, communication n° 869/1999, CCPR/C/70/D/869/1999, §§5.2-5.4.
- Opinions dissidentes de M. Alessio Bruni, CAT, Thirugnanasampantha c. Australie, 9 août 2017, communication n° 614/2014, CAT/C/61/D/614/2014, §6.3 ; CAT, Khairullo Tursunov c. Kazakhstan, 8 mai 2015, communication n° 538/2013, CAT/C/54/D/538/2013, §7,2.
- Voir par exemple CAT, Thirugnanasampantha c. Australie, 9 août 2017, communication n° 614/2014, CAT/C/61/D/614/2014, §6.3 ; CAT, Khairullo Tursunov c. Kazakhstan, 8 mai 2015, communication n° 538/2013, CAT/C/54/D/538/2013, §7,2.
- CAT, Observation générale n°4, 4 septembre 2018, CAT/C/GC/4, §11.
- CAT, Elmas Ayden c. Maroc, 10 mai 2019, communication n° 846/2017, CAT/C/66/D/846/2017, § 8.7 ; CAT, Mustafa Onder c. Maroc, 10 mai 2019, communication n° 845/2017, CAT/C/66/D/845/2017, §7.6 ; CAT, Ferhat Erdoğan c. Maroc, 10 mai 2019, communication n° 827/2017CAT/C/66/D/827/2017, §9.8.
- CAT, Observation générale n° 2, janvier 2008, CAT/C/GC/224, §13.
- Conseil des droits de l’homme, Rapport de l’Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’Homme par les personnes atteintes d’albinisme, 24 mars 2017, A/HRC/34/59.
- Voir CRPD, X c. République Unie de Tanzanie, 18 août 2017, communication n° 22/2014, CPRD/C/18/D/22/2014, §7.6 et CRPD, Y c. République Unie de Tanzanie, 31 août 2017, communication n° 23/2014, CRPD/C/20/D/23/2014, §7.5.
- CRC, observation générale n° 6, 1er septembre 2005, CRC/GC/2005/6, §. 12.
- Ibid., §. 13.
- CMW, observation générale conjointe n° 3, 7 juin 2017 et CRC, observation générale n° 22, 16 novembre 2017, CMW/C/GC/3−CRC/C/GC/22, §. 46.
- CMW, observation générale conjointe n° 4 (2017) et CRC, observation générale conjointe n° 23, 16 novembre 2017, CMW/C/GC/4−CRC/C/GC/23, §. 17.
- Cour EDH, GC, N.D. et N.T. c. Espagne, arrêt du 13 février 2020, req. n° 8675/15 et 8697/15.
- Cour EDH, GC, N.D. et N.T. c. Espagne, arrêt du 13 février 2020, req. n° 8675/15 et 8697/15, § 242.
- Ibid.
- CRC, N.B.F. c. Espagne, 27 septembre 2018, communication n°11/2017, CRC/C/79/D/11/2017, § 12.3.
- CRC, N.B.F. c. Espagne, 27 septembre 2018, communication n°11/2017, CRC/C/79/D/11/2017, § 12.8.
- Ibid., § 12.4 et CMW, observation générale conjointe n° 4 (2017) et CRC, observation générale conjointe n°23 sur les obligations des États en matière de droits de l’Homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, 16 novembre 2017, CMW/C/GC/4−CRC/C/GC/23, § 4.
- CRC, observation générale conjointe n°23 sur les obligations des États en matière de droits de l’Homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, 16 novembre 2017, CMW/C/GC/4−CRC/C/GC/23, § 4.
- Ibid.
- Conseil Constitutionnel, décision n° 2018-768 QPC, 21 mars 2019, M. Adama S.
- Conseil Constitutionnel, décision n° 2018-768 QPC, 21 mars 2019, M. Adama S., § 7.
- Ibid., § 13.
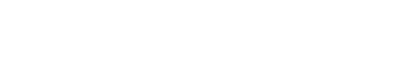

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
