
Les migrations, les voyages et les échanges sont au cœur du droit international, Celui-ci est, depuis l’origine, fondé sur les relations entre les Etats à travers des traités de commerce et d’amitié, allant de pair avec le développement de la protection consulaire, mais également sur les relations transnationales entre de nombreux acteurs privés. L’autarcie – comme le « splendide isolement » – est un leurre alors que le « doux commerce » devient pour Montesquieu un gage de paix. Pourtant de la conquête de l’Amérique jusqu’aux guerres de l’opium, de la traite négrière jusqu’au travail forcé des coolies, le commerce est d’abord une violence qui semble échapper aux principes fondamentaux du droit.
Le développement du droit international privé tout au long du XIXème siècle fait la part belle à la protection des étrangers, la protection des biens comme des personnes, en distinguant statut personnel et statut territorial, en cherchant des privilèges pour les sujets européens ou leurs « protégés », à travers le régime des concessions et les traités inégaux, ou bien au contraire en concluant des accords de réciprocité octroyant la « clause de la nation la plus favorisée », voire du « traitement national » quitte à imposer le régime de la « porte ouverte » aux territoires disputés par les puissances coloniales. Cette dialectique, fondée sur une dissymétrie entre nations civilisées et pays colonisés, échappe pour une large part au droit international public, centré sur les « éléments constitutifs » de l’Etat à travers la souveraineté territoriale et l’allégeance personnelle, le contrôle des frontières comme la « police des étrangers ». Les guerres et les traités de paix redessinent les frontières et provoquent des « échanges de populations », en dehors de toute consultation des personnes concernées, sous réserve des droits des « optants ». Mais dans le même temps, afin de préserver leur foi ou pour échapper à la terreur politique, poussés par l’espoir d’une vie meilleure ou chassés par la famine, des groupes humains ont quitté volontairement leur terre natale pour rechercher un Eldorado ou fonder un « Nouveau monde ».
Entre « carcan étatique » et droit transnational, le droit des migrations a longtemps cherché sa place. Il faut se reporter aux auteurs du tournant du XIXème siècle, pour voir se dessiner des lignes de force. Georges Bry, dans l’édition de 1901 de son Précis élémentaire de droit international public, distinguait nettement deux phénomènes complémentaires au sein des flux de populations, l’émigration et l’immigration, qui dépassent l’échelle individuelle.
D’un côté, évoquant les « mesures destinées à conserver la population sur le territoire de l’Etat », il considère qu’ « il est naturel que les Puissances emploient tous leurs moyens pour prévenir l’émigration, qui, en dépeuplant leur territoire, porterait atteinte à la force et au développement de l’Etat. Mais elles ne peuvent songer à restreindre l’exercice de la liberté individuelle. Elles doivent donc retenir leurs sujets en perfectionnant l’organisation politique et sociale, (…) en assurant, en un mot, la prospérité morale et matérielle de la nation. Mais l’Etat ne peut aller au-delà et empêcher une personne d’émigrer ou même d’aller, en s’expatriant, solliciter une nationalité étrangère ». Toutefois, ce qui est en cause c’est moins le respect d’un choix individuel que le contrôle d’exodes massifs : « Toutes les mesures destinées à la surveillance des agences d’émigration, dans le but d’éviter les spéculations et les fraudes, rentrent dans les moyens légitimes que peut prendre un Etat pour assurer sa conservation. Les compagnies d’émigration cherchent trop souvent à échapper à la surveillance de l’Etat, en employant des agents secrets et en faisant embarquer les émigrants dans des ports étrangers. Une action utile ne peut être exercée en cette matière que moyennant une entente entre des pays intéressés » concluait le doyen Bry 1.
D’un autre côté, le « droit d’immigration » est strictement contrôlé, si l’Etat « craint qu’une invasion d’étrangers ne compromette les intérêts et le bon ordre du pays ». Et de citer les législations américaines, comme le Chinese Exclusion Act de 1892, pour interdire l’immigration chinoise aux Etats-Unis. Bien plus, l’Institut de droit international estimait, lors de sa session de Genève de la même année, avec une formulation malheureuse, « que l’immigration pouvait être interdite à raison d’une différence fondamentale de mœurs et de civilisation ou d’une organisation ou accumulation dangereuse d’étrangers se présentant en masse, [et] non pour la seule raison de protéger le travail national ». Lors de la session de Copenhague de 1897 une conception plus équilibrée semble prévaloir avec un « projet d’un règlement contenant les principes de nature à servir de base à une convention internationale », assorti de « vœux relatifs à la restriction de l’émigration, lorsqu’elle peut être funeste aux Etats et à la détermination des règles nécessaires à la constitution et au fonctionnement des agences d’émigration »2. Le projet pose en effet le principe de la « liberté d’émigrer et d’immigrer, isolément ou en masse, sans distinction de nationalité », écartant toute discrimination raciale, tout en maintenant une possibilité d’exception au principe, avec des conditions de forme et de fond, cette liberté pouvant « être restreinte par décision dûment publiée des gouvernements dans les limites rigoureuses des nécessités d’ordre social et politique ». Ainsi aux yeux de Paul Fauchille, l’Institut « prend des précautions pour sauvegarder la sécurité de l’émigrant aussi bien que celle de l’Etat »3.
Vingt ans après, au lendemain de la première guerre mondiale et de la révolution soviétique, Paul Fauchille a lui-même une tout autre démarche avec un chapitre portant sur « le droit d’émigration » après un premier chapitre sur la « protection et inviolabilité de la personne humaine » ouvrant son tableau de « l’homme dans les rapports internationaux ». Deux autres chapitres concernent les « droits et devoirs de l’Etat envers ses sujets résidant à l’étranger » et aux « droits et devoirs des Etats envers les étrangers » où la question de l’immigration est vue sous l’angle de l’admission des étrangers. De manière symptomatique, dans l’index, le mot immigration est un simple renvoi au mot émigration D’emblée, Fauchille cherche à remonter au principe dont découle l’émigration : « Est-ce un fait qui dépend de la volonté des Etats ou qui au contraire s’impose à eux ? Cela revient à se demander s’il faut la considérer comme une application du droit de souveraineté de l’Etat ou comme un droit propre de l’individu ». Mais si l’émigration « constitue un de ces droits que l’homme possède en tant qu’homme et non pas en tant que membre de telle ou telle nation », ce n’est pas pour autant un « droit absolu »4. Lorsque dans le même esprit, Fauchille affronte la question symétrique : « L’Etat qu’abordent des étrangers, a-t-il ou n’a-t-il pas l’obligation de les admettre sur son sol ? les étrangers ont-ils ou non un droit à l’accès du territoire ? », c’est pour récuser une souveraineté absolue des Etats, au nom du « principe de leur interdépendance » et de « la notion même de communauté internationale et par suite celle de droit des gens »5. Cherchant un équilibre entre les thèses en présence, il met en avant la « liberté individuelle » : « On n’admet plus dans le droit moderne que chaque homme soit rivé à sa propre patrie : il possède comme tel, le droit d’aller et de venir où bon lui semble afin de trouver dans une société qu’il juge meilleure des facilités plus grandes pour arriver à l’accomplissement de sa fin, c’est-à-dire à son perfectionnement matériel et moral. Comment l’individu pourrait-il avoir le droit imprescriptible d’émigrer ou de s’expatrier, sans avoir le droit de se fixer nulle part ? »6. Mais l’Etat garde lui-même le droit de « veiller à sa propre conservation » que Fauchille entend encadrer par des limites très strictes, évitant les mesures générales et arbitraires. Il ne néglige pas les risques de conflits géopolitiques entre les Etats en cas de déséquilibres démographiques, faisant allusion à la théorie de « l’espace vital ». A cet égard, il s’interroge de manière prophétique : « Peut-être, afin d’assurer une certaine unité entre les Etats, serait-il utile qu’intervinssent ici, au lieu de traités bilatéraux, des traités collectifs qui poseraient des règles générales dont la réglementation détaillée serait faite par les lois particulières de chaque pays »7.
Ces rappels historiques ne sont pas inutiles pour mesurer la permanence des débats théoriques et des enjeux pratiques, à travers la recherche d’un cadre juridique conciliant souveraineté étatique et liberté individuelle. A chaque fois aussi l’idée d’un corpus de références communes, à travers les « règles générales » envisagées par Fauchille, il y a maintenant un siècle, sert de synthèse.
D’une certaine manière, ce sont les travaux de droit international privé de l’Institut de droit international (IDI) qui seront la matrice de la protection internationale des droits de l’homme dans l’entre-deux-guerres, avec les rapports présentés par André Mandelstam8. Face aux Etats totalitaires qui deviennent une « prison des peuples », les Etats libéraux ont beau jeu de revendiquer la liberté d’aller et venir « sans considération de frontière ». La Déclaration universelle des droits de l’homme est le concentré de toutes ces contradictions, puisque tout en soulignant avec force l’importance du lien de nationalité pour mieux limiter les hypothèses d’apatridie (article 15)9, l’article 13 §.2 proclame que « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans ce pays » ce qui n’implique pas pour autant le droit d’entrer librement dans n’importe quel autre pays. Bien plus, si la Déclaration précise, à l’article 14 §.1, que « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays », le débiteur de cette obligation solidaire reste lui-même indéterminé… Autrement dit, ces grands principes restent asymétriques, faute d’articulation entre droits individuels et responsabilités collectives, ils nécessitent une traduction concrète, pour passer des vœux pieux aux garanties effectives.
C’est tout le défi systémique du sujet à traiter, que nous esquisserons en deux volets : après avoir tenté de cerner le « cadre juridique » de référence (I), il nous faudra en définir le contenu à travers les engagements politiques récents que constituent la Déclaration de New York du 19 septembre 2016 et e le Pacte de Marrakech voté le 19 décembre 2018 (II).
I – Quel cadre juridique ?
Peut-on parler aujourd’hui d’un cadre normatif d’ensemble pour la gouvernance mondiale ? Faut-il parler d’un cadre juridique ou de cadres juridiques ? Et face à ce puzzle épars, ne faut-il pas recenser des trous béants, contrairement à l’idée d’une cartographie systématique fondée sur un principe d’hospitalité, principe éthique renforcé par l’affirmation universelle d’une « famille humaine » transcendant toutes les discriminations, voire les distinctions ? Trois questions préalables s’imposent pour tenter de démêler cet écheveau normatif, avant toute forme d’inventaire. Peut-on parler d’un droit spécifique à travers la multiplication des régimes particuliers ? Faut-il au contraire rechercher les composantes d’un « droit commun » ayant un rôle fédérateur ? Enfin quelle serait la nature juridique d’un « droit objectif » s’imposant à tous, erga omnes ?
1/ Quelle est la place d’un droit spécifique, né de la multiplication de régimes particuliers, sectoriels et/ou régionaux ?
Le premier constat est sans doute que nous ne sommes pas dans un vide juridique. Des solidarités de proximité se sont développées. Ainsi dans le cadre régional, le droit de l’Union européenne fait la distinction entre ressortissants communautaires et les étrangers non-communautaires, non seulement dans les domaines des « quatre libertés » mais également des droits de l’homme comme l’illustrait maladroitement le mandat de Cologne qui a servi de base à l’élaboration de la Charte de Nice, en visant « les droits fondamentaux réservés aux citoyens de l’Union ». Plus largement, dans tous les continents, une série d’espaces économiques (« marché commun », union douanière, accords de libre-échange) ont été mises en place à travers le monde, avec des règles spécifiques concernant la libre circulation des personnes : certains étrangers sont moins étrangers que d’autres. Bien plus, en dehors d’accords bilatéraux fondés sur la réciprocité, visant à favoriser des relations privilégiées entre les nationaux de deux pays (on peut penser au « modèle » esquissé par les accords d’Evian), des ensembles politiques définissent leur propre « citoyenneté » (citizenship), se superposant à la nationalité au sens étroit, comme cela a été longtemps le cas du Commonwealth.
Parallèlement à cette approche régionale ou sous-régionale, des régimes sectoriels ont également été mis en place, les deux démarches pouvant se répondre avec un effet de miroir. Ainsi, s’agissant de la protection de réfugiés, on oublie trop que la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés – qui est aujourd’hui ratifiée par 146 Etats – avait initialement une portée limitée dans le temps et dans l’espace, en visant, selon le choix des Etats, les « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ». C’est le Protocole de New York de 1967 – ratifié lui-même par 147 Etats parties dont les Etats-Unis – qui en généralise la portée. Parallèlement, il faut rappeler que des systèmes régionaux ont été mis en place, comme la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969…
L’article 33 de la Convention de Genève consacre le principe de non-refoulement en cas de risque pour la vie ou la liberté d’un « réfugié », étant entendu que cette garantie est beaucoup plus large, dans la mesure où elle vise tout demandeur d’asile dès son arrivée à la frontière, voire, selon la jurisprudence et les traités internationaux comme la Convention contre la torture de 1984 et la Convention sur les disparitions forcées de 2006, toute personne risquant de subir des traitements inhumains dans son pays d’origine. D’une certaine manière, cette obligation qui pèse sur le pays de « premier accueil » vient combler la lacune juridique qui existait dans l’articulation de l’article 14 de la Déclaration universelle : le droit de « chercher asile » a pour contrepartie le principe de non-refoulement d’un demandeur en situation de risque.
Il est symptomatique que les travaux entrepris dans le cadre onusien, depuis les années soixante-dix, comme dans celui du Conseil de l’Europe pour aller plus loin en la matière soient restés lettre morte10. C’est dans un contexte géopolitique très différent que les Etats européens ont tenté d’harmoniser les règles du droit d’asile avec des directives et des règlements européens en mettant l’accent sur le burden-sharing, ce que le préambule de la Convention de Genève de 1951 appelait en français « une solidarité internationale » face à des charges exceptionnellement lourdes (4ème cons.) Le préambule exprime aussi le vœu que « tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats » (5ème cons.). Ce n’est pas le lieu d’entrer en détail dans les tensions politiques entre les Etats, qu’il suffise de rappeler la jurisprudence de plus en plus fournie de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant les Etats européens, isolément ou solidairement, pour leur mise en œuvre du droit de l’Union, depuis l’arrêt de Grande chambre MSS c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011.
A côté du régime des réfugiés, un autre régime de protection très cohérent est celui défini par l’OIT depuis un siècle. La philosophie profonde de l’organisation est d’associer paix universelle et justice sociale, en considérant « qu’il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger […] Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain fait obstacles aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays »11. Face aux risques de « dumping social », figurait ainsi en bonne place « la défense des intérêts des travailleurs occupés à l’étranger ». Pour autant la question des migrations n’étaient pas prise en compte comme telle alors que la grande crise multipliait les barrières protectionnistes. Il faudra attendre 1939 pour voir rédiger une première convention sur les travailleurs migrants qui deviendra la Convention « révisée » n° 97, adoptée en 1949 et ratifiée par 49 Etats – dont la France en 1954. En 1975, une nouvelle convention n° 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) sera adoptée mais sans rencontrer un vrai succès avec seulement 23 ratifications. Plus récemment, en 2016, l’OIT a élaboré une étude d’ensemble de ses conventions et recommandations en la matière, sous le titre « promouvoir une migration équitable », mais force est de reconnaitre que la protection du marché du travail, y compris par des systèmes de closed-shop a longtemps primé sur la mobilité de la main d’œuvre, a fortiori face à la traite des personnes et au travail clandestin des « réfugiés économiques »…
D’une certaine manière, la Convention internationale pour la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 répond à cet objectif en définissant un cadre global, mais malheureusement son succès est tout relatif avec 54 Etats parties, près de 30 ans après son adoption, d’autant qu’il s’agit d’Etats de « départ » ou de « transit » et non de pays de destination, ce qui fausse toute la logique du système. En fait nous sommes en présence d’une convention internationale qui garde une vocation universelle et figure au sein des « core instruments » en matière de droits de l’homme définis par les Nations Unies, mais qui a une portée géographique limitée, comme l’illustre cruellement la carte qui figure sur le site du Comité. Il s’agit en quelque sorte d’une convention internationale « régionalisée », avec tous les effets de surenchère que peut entraîner un tel déséquilibre, mais les absents ont toujours tort.
Les Etats membres de l’Union européenne se réfugient derrière une solidarité européenne de façade ou le droit de l’Union pour refuser toute ouverture, en invoquant l’absence de distinction entre migrants en situation régulière et clandestins, alors que l’article 5 définit ces deux catégories. Dans sa troisième partie, la Convention internationale énumère les « droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille », alors que la quatrième partie vise spécifiquement les « autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière ». Une autre partie vise certaines catégories particulières, comme les frontaliers, les travailleurs saisonniers, les itinérants. Enfin la sixième partie porte sur la « promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales ». En français comme en anglais – « promotion of sound, equitable, humane and lawful conditions in connection with international migration » – ces formules semblent annoncer l’intitulé du Pacte mondial…
2/ Quelles sont les limites à l’application du corpus de droit commun des droits de l’homme aux migrants quelle que soit leur « situation » ?
Mais si l’on peut ainsi énumérer des régimes spécifiques, plus ou moins élaborés, universels dans leur principe mais régionalisés en pratique, car traduisant des déséquilibres géopolitiques évidents, il ne faudrait pas oublier l’existence d’un droit commun des droits de l’homme valables pour tous ?
Comme le dit l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale ; de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». Même si l’énumération n’est pas close (« notamment », « toute autre situation »), l’article 2 qui sera la matrice des traités de base, prend bien soin de parler d’ « origine nationale » et non de « nationalité ». Autrement dit, malgré son caractère universel, la Déclaration n’exclut pas toute forme de distinction entre nationaux et étrangers. C’est le sens de l’article 25 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques (PIDCP) qui prévoit que « tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : a) de prendre part à la direction des affaires publiques (…) ». De même l’article 2 §.3 du Pacte international relatifs aux droits économiques sociaux et culturels (PIDESC) précise que « les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants ».
Mais il s’agit d’exceptions limitées, le principe général restant l’affirmation de droits fondamentaux « sans considération de frontières ». Bien plus, dès l’affaire Gueye et al. c. la France de 1989, le Comité des droits de l’homme a considéré que la cristallisation des pensions des anciens soldats africains de l’Armée française, contrairement à l’évolution de la situation des pensionnés de nationalité française, qu’ils résident en métropole ou en Afrique, constituait une discrimination fondée sur « l’origine nationale », c’est-à-dire en l’espèce sur la nationalité12.
Il en va de même dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme où les restrictions politiques de l’article 16 à l’encontre des étrangers sont devenues lettre morte – c’est aussi le cas en France pour les associations ou les publications étrangères – alors que l’interprétation de l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale était interprétée comme une garantie du séjour des étrangers, notamment des immigrés de la « seconde génération », sans attaches avec leur pays d’origine dont ils avaient pourtant encore la nationalité, tandis que l’interdiction de la torture de l’article 3 prenait une portée extraterritoriale en cas d’expulsion ou d’extradition, y compris dans des affaires de terrorisme. Enfin, à défaut d’avoir ratifié le protocole n° 12 de la Convention européenne, la France est soumise à l’interprétation « par ricochet » de l’article 14 qui vise notamment les prestations sociales, comme le montre l’arrêt Koua Poirrez c. France13 du 30 septembre 2003, s’agissant du refus d’accorder à un jeune ivoirien l’allocation pour adulte handicapé. Autrement dit, l’évolution générale du droit international des droits de l’homme s’est montrée très protectrice des droits des étrangers, faisant primer les droits individuels sur les considérations d’ordre public qui ont longtemps prévalu en droit administratif en matière de « police des étrangers »…
Ce n’est pas le lieu de faire l’inventaire des jurisprudences européenne ou internes concernant les étrangers, ce qui serait un beau sujet de thèse, ni d’ailleurs politiques comme le « regroupement familial », ou des pratiques en matière de santé publique ou de scolarisation qui ont été fondées sur les mêmes principes, mais on peut considérer que, dans son esprit comme dans sa lettre, le droit international des droits de l’homme s’applique de manière très générale aux migrants, malgré des limites expresses ou implicites, concernant notamment l’accès au territoire. On retrouve ainsi, dans tous les pays, la distinction entre droit au séjour régulier et situation de facto, avec pendant longtemps des régularisations de masse – fondées sur des critères individuels de durée, d’adaptation ou d’intégration – ou au contraire des reconduites systématiques à la frontière, voire des expulsions collectives que les responsables politiques justifient par la crainte d’un « appel d’air », au risque de transformer l’eldorado en enfer.
La question théorique reste la nature du principe de non-discrimination qui est à la base du droit international des droits de l’homme. Toute distinction n’est pas une discrimination, selon la justice commutative d’Aristote qui implique de traiter également des personnes dans une situation identique. La jurisprudence du Conseil constitutionnel s’inspire logiquement du même principe, même s’il y a une contradiction fondamentale entre une conception nationale de « droits de l’homme et du citoyen » issue de la Déclaration française de 1789 et une consécration universelle des droits de l’homme. Comment articuler cette citoyenneté sans frontières et l’appartenance à une « société démocratique » ? Comment réconcilier la double exigence de l’article 28 de la Déclaration universelle qui proclame que « toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet » ? D’une certaine manière les droits se trouvent ainsi à l’interface entre « ordre démocratique » dans le cadre national d’un Etat de droit et « ordre international » en devenir.
Mais de manière beaucoup plus immédiate, devant cette application potentielle du droit international des droits de l’homme, ne faut-il pas s’interroger aussi sur la valeur ajoutée d’un instrument spécifique comme la Convention internationale de 1990, si ce n’est en matière de suivi, avec la création d’un organe conventionnel spécialisé ? D’autant plus que le fait de ne pas ratifier la Convention donne aux Etats le sentiment illusoire d’un opting out, leur permettant de dénier tout droit aux travailleurs migrants et à leur famille, alors même que de manière générale ils bénéficient des droits fondamentaux reconnus à toute personne !
3/ Enfin, dans quelle mesure peut-on parler d’un corpus objectif, fondé sur des principes fondamentaux s’appliquant erga omnes quels que soient les engagements relatifs souscrits par un Etat ?
Là encore les principes de base sont clairs, y compris s’agissant des traités internationaux sur les droits de l’homme, avec l’effet relatif des traités, la pratique des réserves et des déclarations interprétatives. Mais pour autant la jurisprudence est souvent fondée sur une interprétation objective s’imposant à tous, qui dépasse le volontarisme étatique classique, tout comme la logique de subsidiarité entre les différents systèmes de protection. Est-ce à dire qu’au-delà des obligations conventionnelles, les juges cristallisent des principes généraux de droit ou des normes de nature coutumière ? Dans ce cas, c’est l’interprétation donnée par le juge national ou par le juge européen qui est en cause – comme en matière de regroupement familial – avec le risque de susciter des campagnes politiques visant à dénoncer les traités relatifs aux droits de l’homme, à commencer par la Convention européenne des droits de l’homme, alors qu’une telle dénonciation symbolique, qui supprimerait la supervision par les instances supranationales, ne changerait rien pour autant à la substance du droit applicable dans un pays donné.
Une autre difficulté découle de la hiérarchie des normes, à travers l’enchevêtrement du droit dur et de la « soft law ». D’une certaine manière, les organes conventionnels en interprétant les traités de base sont la source d’un droit dérivé, qui prend la forme de « constatations » individuelles ou d’observations générales »14. Dès 1986, le Comité des droits de l’homme a adopté son observation générale n°15 sur « la situation des étrangers au regard du Pacte », à côté d’observations transversales, tout comme le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) avec sa recommandation générale XXX concernant « la discrimination contre les non-ressortissants » de 2005.
La même année, le Comité des droits de l’enfant a adopté son observation générale n°6 sur le « traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine »15. Le Comité des travailleurs migrants a lui aussi élaboré ses premières observations générales, avec notamment l’Observation générale n° 1 de 2011 sur les travailleurs domestiques migrants et l’Observation générale n° 2 de 2013 sur les travailleurs migrants en situation irrégulière, mais un développement très original est survenu en 2017 avec l’adoption simultanée le même jour de deux observations générales conjointes du Comité sur les travailleurs migrants (CMW) et du Comité des droits de l’enfant, d’une part « sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations »16 et d’autre part sur « les obligations des Etats » en la matière, « dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour ».
On peut s’interroger sur la complexité de l’articulation verticale ainsi faite entre des « principes généraux » et des « obligations juridiques » mais surtout sur les destinataires des standards, sachant que la Convention sur les droits de l’enfant de 1989 est de portée quasi-universelle alors que la Convention sur les travailleurs migrants de 1990 garde un champ très limité, obéissant au principe inter alia acta, sans pouvoir s’appliquer, directement ni même indirectement, aux Etats tiers. Nous sommes donc à l’extrême limite de la cross-fertilization avec l’interprétation conjointe ou conjuguée des deux instruments au strict croisement des matières pour se concentrer sur les mineurs migrants ou les migrants mineurs, mais sans s’interroger sur la superposition juridique entre deux traités, l’un de nature objective, l’autre de portée subjective17. Peut-on passer ainsi de l’essence à l’existence, en jouant les vases communicants entre des traités de portée sinon de nature différente, en transformant les obligations telles qu’elles sont en droits tels qu’ils devraient être ?
On retrouve cette dynamique à l’œuvre dans les travaux des organes subsidiaires du Conseil des droits de l’homme, à commencer par le mandat du rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants institué par la résolution 199/44 de la Commission des droits de l’homme. Depuis lors quatre rapporteurs se sont succédé, le plus souvent provenant du Groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC). Le Canadien François Crépeau, dans son dernier rapport présenté en 2017 a fait un bilan des six années d’activités en se projetant à l’horizon 2035, tandis qu’en 2018 le nouveau titulaire, le Chilien Felipe Gonzales Morales a consacré son premier rapport à la question du retour et de la réintégration, marquant un changement significatif de perspectives18. Ainsi en une vingtaine d’années, une production intensive des rapporteurs spéciaux, scandée par les résolutions des organes interétatiques, Conseil des droits de l’homme et Assemblée générale, mais aussi par les polémiques suscitées par certaines visites sur le terrain, s’est développée, à mi-chemin entre description et prescription.
Cette complexité a récemment été aggravée par des ambiguïtés de vocabulaire ou des incertitudes de traduction concernant le Pacte de Marrakech : le Global Compact, ce « paquet » hétéroclite issu des négociations se traduit en français par « Pacte mondial » – tout comme le Pacte mondial sur les réfugiés – au risque de créer une confusion avec les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme de 1966, les Covenants qui sont des traités à vocation universelle, ou plus encore avec le Pacte de la SDN qui est un « Pacte fondateur », alors que le Global Compact, le « Pacte mondial » qui avait été lancé à Davos par Kofi Annan n’était qu’un catalogue d’engagements volontaires des multinationales… La confusion est portée à son comble, avec l’initiative de Laurent Fabius désireux à la suite du succès diplomatique de la COP 21 de faire adopter un « troisième Pacte » sur l’environnement, reprenant les vieilles thèses de Karel Vasak sur les générations des droits de l’homme, au risque de dénaturer les droits fondamentaux. Devant l’impossibilité de remettre en cause le noyau de la « Charte internationale des droits de l’homme », autour de la Déclaration de 1948 et des deux Pactes internationaux, on observe un glissement du vocabulaire, quand ce Pacte mondial pour l’environnement devient un Global Pact for Environment, soutenu par des « juristes renommés »19. Autrement dit, si en français il ne faut pas confondre Pacte et Pacte, on a l’embarras du choix en anglais avec Covenant, Compact ou Pact… Pire, face à cette surenchère verbale où la soft law chasse le droit dur, comme « la mauvaise monnaie chasse la bonne », c’est la nature juridique du Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme traité international qui s’est trouvée remise en cause par les fake-news !
Il est temps de revenir à la substance du débat, en nous interrogeant sur le contenu des engagements politiques récemment assumés par les Etats dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies, pour tenter d’y trouver une opinio juris individuelle ou collective.
II – QUEL CONTENU JURIDIQUE ?
Pour ce faire, il faut revenir, aux références de base recensées dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, adoptée sans vote le 19 septembre 2016 par l’Assemblée générale (A/RES/71/1), avant de prendre en compte le Pacte de Marrakech dans ses diverses étapes, avec une adoption finale beaucoup plus controversée.
1/ Le point de départ consensuel de la Déclaration de New York du 19 septembre 2016
La Déclaration de New York prend une forme solennelle : « Nous chefs d’Etat et de gouvernement …», à l’instar des déclarations politiques issues des grands sommets internationaux, depuis la Charte de Paris pour une nouvelle Europe en 1990, faisant écho au « Nous peuples des Nations Unies », avec le risque d’une certaine banalisation, lorsque les dirigeants se bornent à réitérer de manière consensuelle des principes fondamentaux. Ainsi, après avoir « réaffirm[é] » les buts et principes de la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle (§.5), ils « rappel[lent]» les « principaux instruments internationaux » en matière de droit de l’homme, sans préciser la portée de ce rappel, alors que plus loin ils s’engagent en déclarant que « nous nous conformerons à nos obligations au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant » (§.32). Dans le même registre du constat d’évidence, ils réaffirment, et continueront de « protéger pleinement, les droits fondamentaux de tous les réfugiés et migrants, quel que soient leur statut : tous ont des droits. Notre action témoignera de notre plein respect du droit international et du droit international des droits de l’homme, et, le cas échéant, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire » (§.5). Tout en distinguant les différentes catégories juridiques, l’introduction de la Déclaration de New York a comme leitmotiv la référence aux « libertés fondamentales et droits de l’homme universels ».
Sur cette base, une série d’engagements communs ou différenciés sont présentés après un bref chapeau explicatif : « Nous le faisons en prenant en compte la différence des réalités, des capacités et des niveaux de développement des pays et en respectant les priorités et politiques nationales. Nous réaffirmons notre attachement au droit international et soulignons que la mise en œuvre de la présente Déclaration et de ses annexes devra être conforme aux droits et obligations que ce droit fait aux Etats» (§.21). Selon le plan de la Déclaration sont ainsi passés en revue les « engagements s’appliquant aussi bien aux réfugiés qu’aux migrants » (II), les « engagements en faveur des migrants » (III) et les « engagements en faveur des réfugiés » (IV), que prolongent deux annexes l’une visant un « Cadre d’action global pour les réfugiés » et l’autre intitulée, « Vers un pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières ».
Au passage, on peut relever que plusieurs traités sont visés, comme la convention contre la criminalité transfrontière organisée et ses protocoles dont l’importance est réaffirmée, tandis que les Etats encouragent « la ratification des instruments internationaux pertinents relatifs à la prévention de la traite des êtres humains et du trafic des migrants, à la lutte contre ceux-ci » (§.34) dans la partie des engagements communs. S’agissant des migrants, les formules sont fort prudentes : « Nous demandons aux Etats qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de ratifier la convention » sur les travailleurs migrants (§.48) et les conventions pertinentes de l’OIT, « selon qu’il conviendra ». Et dans une formule qui reste beaucoup trop allusive : « Nous notons, en outre, que les migrants jouissent de droit et bénéficient d’une protection en vertu de diverses dispositions du droit international » (§.48). S’agissant des réfugiés, il est réaffirmé que la Convention de 1951 et le Protocole de 1967, « constituent la pierre angulaire du régime international de protection des réfugiés » (§.65), avant de noter « avec satisfaction que 148 Etats sont actuellement parties à l’un de ces textes ou aux deux », et d’engager les autres Etats à y adhérer. Mais pour autant, afin de ne vexer personne, il est constaté « par ailleurs que certains Etats non parties aux instruments internationaux applicables ont fait preuve de générosité dans l’accueil des réfugiés » (§.65), comme si une solution précaire sur une base volontaire pouvait remplacer le cadre normatif et institutionnel du HCR… De même les conventions sur l’apatridie sont rappelées (§.72).
Comme on le voit, à ce stade, nous avons à faire à un inventaire à la carte, sans cristallisation d’une opinio juris précise, en dehors de rappels aussi généreux que collectifs. L’accent est d’ailleurs mis sur le « suivi et réexamen de nos engagements » en considérant « qu’il faut mettre en place un dispositif de suivi et de réexamen systématiques de tous les engagements souscrits aujourd’hui ». La Déclaration parle même des « engagements contractés » et envisage des « évaluations périodiques à l’intention de l’Assemblée générale, au regard du programme de développement durable à l’horizon 2030, selon ce qu’il conviendra » (§.88). L’accent est également mis, comme pour les objectifs de développement durable (ODD), sur le volet financier, afin « de parvenir à une plus grande efficacité, notamment sur le plan opérationnel et celui de la cohérence systémique, ainsi que de renforcer les liens de l’Organisation des Nations Unies avec les institutions financières internationales et le secteur privé, afin de donner plein effet aux engagements énoncés dans la présente Déclaration » (§.90).
Les deux annexes préparent le terrain pour « l’adoption d’un pacte mondial sur les réfugiés en 2018 » comme pour « l’adoption d’un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en 2018 » ces termes étant mis en opposition dès l’introduction de la Déclaration avec « les déplacements forcés et les flux migratoires irréguliers » (§.4) De par son caractère global le Pacte traduit sans doute une impossible synthèse, mais seule une certaine malhonnêteté intellectuelle permet d’isoler une formulation de son contexte : « Le pacte mondial constituerait un ensemble de principes, d’engagements et d’accords entre les Etats membres concernant les migrations internationales sous tous leurs aspects ; il serait une contribution importante à la gouvernance mondiale (…) il traiterait de tous les aspects des migrations internationales, notamment de l’aide humanitaire, du développement et des droits de l’homme » (annexe II, §.2). Cette esquisse du contenu traduit la nature de patchwork du processus, en juxtaposant des « principes » – et sans doute des « principes fondamentaux » ou des « principes généraux du droit », ayant une portée universelle, erga omnes, si ce n’est des normes de jus cogens – et des « engagements » juridiques, issus des traités internationaux, à côté d’engagements contractuels, reposant sur la réciprocité, ou de « bonnes pratiques »… Le mélange des genres propice au consensus est évident, en attendant l’épreuve de vérité.
2/ L’aboutissement controversé constitué par le Pacte de Marrakech
Entre temps, le projet a connu une mutation politique avec la convocation d’une « conférence intergouvernementale en vue de l’adoption d’un pacte mondial », alors que le texte final avait été agréé dès juillet 2018. Il s’agissait sans doute d’une étape de trop, avec cette conférence de Marrakech organisée les 10 et 11 décembre 2018, à une date symbolique éclipsant le 70ème anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle par l’Assemblée générale des Nations Unies à Paris… Mais surtout, le changement du contexte international avait fait oublier la crise de 2015 et la nécessité d’une réponse collective à un défi global, laissant libre cours aux réactions isolées, obéissant à des logiques politiques internes, l’Europe étant la première à étaler ses divisions.
Après les campagnes contre le Pacte de Marrakech, et des défections importantes lors de la conférence, le retour devant l’Assemblée générale s’est fait dans des conditions délicates, avec l’adoption de la résolution 73/195, votée par 152 voix contre 5 avec 12 abstentions, le 19 décembre 2018, dont l’annexe reprend le texte du Pacte (41 pages)20. Ce passage du consensus au vote nominal, à la demande des Etats-Unis, même si les explications de vote sont très différentes, aura des conséquences politiques sur le suivi, certains Etats remettant en cause tout le processus en se comportant en « objecteur persistant ». Pour autant faut-il considérer que tout l’édifice juridique, accumulant droit dur et droit mou, comme autant de couches géologiques, et surtout la dynamique institutionnelle, sur base de multi-multilatéralisme, ainsi lancée sont remis en cause ?
Tel qu’il figure dans l’annexe de la résolution 73/195 adoptée le 19 décembre 2018, le « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » comporte 3 grands volets.
Cette construction baroque commence par un « Préambule » qui n’en est pas un, en mêlant le style direct des déclarations diplomatiques et la numérotation continue des documents internationaux alignant des §§. Sur le fond, nous n’avons pas affaire à des considérants, mais à une série de précisions juridiques fixant un cadre de référence : Ainsi dès le §.1, il est affirmé que « Le Pacte mondial repose sur les buts et principes consacrés par la Charte » : le choix du verbe (rests on) est assez bizarre, pour un document adopté sous les auspices des Nations Unies et on peut le supposer dans le cadre de la Charte. Le §.2 ouvre l’éventail des références, en indiquant qu’« Il s’appuie également » (it also rests ») sur une série de sources juridiques, comme la Déclaration universelle, les deux Pactes et les « autres instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme » (core instruments) – en faisant figurer une note avec la liste complète de ces traités dont la portée reste relative. L’énumération se poursuit avecanalyse normative critique la convention sur la criminalité transfrontière organisée et ses 2 protocoles, la convention sur l’esclavage, les conventions sur les changements climatiques, y compris « L’accord de Paris », « les conventions de l’OIT sur la promotion d’un travail décent et les migrations de main-d’œuvre – avec aussi une note visant notamment la convention 97 et la convention 143 – et divers « programmes d’action », comme les ODD de 2030… Le Préambule fait divers rappels historiques et liste d’autres « sources d’inspiration » lors des « travaux préparatoires ». Il souligne au §.6 que le Pacte « fait fond » sur les ODD (it is rooted)… On l’aura compris tous ces termes vagues « repose », « s’appuie », « fait fond » ne font qu’esquiver l’enjeu juridique, alors que, c’est bien connu, à force de s’appuyer sur les principes, on risque de les faire plier.
Il s’agit donc plus d’un contexte documentaire que d’une base juridique, à proprement parler. C’est une auberge espagnole où chacun retrouve ce qu’il a apporté, avec « un cadre de coopération juridiquement non contraignant qui repose sur les engagements convenus par les Etats membres dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Il favorise la coopération internationale en matière de migration entre tous les acteurs compétents, sachant qu’aucun Etat ne peut gérer seul la question des migrations, et respecte la souveraineté des Etats et les obligations que leur fait le droit international » (§.7).
Cet ensemble d’engagements découlant de la Déclaration de 2016 repose sur une « vision », qui constitue le deuxième volet du document, la version française parle pour sa part de « nos ambitions et principes directeurs» (our vision and guiding principles), en évoquant des « responsabilités partagées » qui débouchent sur des « ambitions communes », (« unity of purpose ») avant de détailler « un ensemble de principes directeurs transversaux et interdépendants » (§.15) qui forment une sorte de décalogue.
Le premier principe est la « priorité à la dimension humaine », en soulignant que « le Pacte mondial comporte une forte dimension humaine, inhérente à la migration même. Il promeut le bien-être des migrants et des communautés dans les pays d’origine, de transit et de destination. Il est donc centré sur l’individu » (§.15.a). Mais cette priorité vient s’inscrire dans une dialectique complexe entre la coopération internationale et la souveraineté nationale, instaurant un équilibre quelque peu instable. A ce titre, il est répété que « Le Pacte mondial est un cadre de coopération juridiquement non-contraignant créé en considération du fait qu’aucun Etat ne peut seul faire face aux migrations, compte tenu de la nature transnationale du phénomène. Porteur de coopération et de dialogue aux niveaux international, régional et bilatéral, le Pacte fait autorité de part sa nature consensuelle, sa crédibilité, l’appropriation collective dont il fait l’objet, sa mise en œuvre conjointe et ses mécanismes de suivi et d’examen » (§.15.b). Au passage on peut noter la bonne définition des outils techniques permettant de consolider le droit mou, dans ses sources s’imposant avec la force de l’évidence et ses méthodes de mise en œuvre, à travers le suivi (follow up and review). La réaffirmation parallèle de la souveraineté nationale est beaucoup plus directe : « Le Pacte réaffirme le droit souverain des Etats de définir leurs politiques migratoires nationales et leur droit de gérer les migrations relevant de leur compétence, dans le respect du droit international » (§.15.c).
Resterait à définir le contenu du droit international, mais le flou est d’autant plus entretenu, que les principes suivants traduisent un certain désordre logique. Certes le quatrième principe met l’accent sur la « primauté du droit », à travers les notions de « rule of law et due process », en y intégrant l’accès à la justice, en référence une nouvelle fois avec le « droit international » (§.15.d), mais le contenu du droit est évoqué un peu plus loin, après la référence au développement durable (sic). Sous la rubrique « droits de l’homme », il est répété que « Le Pacte mondial est fondé sur le droit international des droits de l’homme et respecte les principes de non-régression et de non-discrimination. En appliquant le Pacte mondial, nous veillons au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, à tous les stades de la migration » (§.15.f). Cette fois c’est le terme fort de « based » qui est employé, tout comme la reprise du triptyque des obligations juridiques en matière de droits de l’homme : « respect, protection and fullfilment ». Pour autant, on comprend mal si la base des obligations ainsi assumées est le Pacte mondial ou le droit international à proprement parler. Après la prise en compte de la problématique femmes-hommes (gender-responsive) (§.15.g) et des besoins des enfants (child-sensitive) (§.15.h), les deux derniers principes visent à mobiliser les pouvoirs publics (§.15.i) et « l’ensemble de la société » (§.15.j). On passe ainsi de principes fondamentaux à des préconisations de bonne gouvernance, sans régler les contradictions qui peuvent exister entre les différentes directives.
Le troisième grand volet présente le « cadre de coopération », avec l’énumération de 23 objectifs qui figurent de manière synthétique dans un encadré, mais sont ensuite détaillé avec une liste des « objectifs et engagements ». Un chapeau vient préciser l’articulation d’ensemble du document : « Avec la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, nous avons adopté non seulement une déclaration politique mais aussi un ensemble d’engagements. Nous réaffirmons la Déclaration dans son intégralité et allons plus loin en définissant le cadre de coopération ci-après, qui comprend 23 objectifs et prévoit des moyens de mise en œuvre du Pacte mondial ainsi que des mécanismes de suivi et d’examen. Chaque objectif est associé à un engagement, suivi d’une série de mesures regroupant des moyens d’action et des pratiques optimales. Nous puiserons dans ces actions pour atteindre les 23 objectifs et faire en sorte que les migrations soient sûres, ordonnées et régulières à toutes les étapes » (§.16). D’autres plus compétents expliqueront l’articulation des engagements différenciés qui ressemble à la technique de la Charte sociale européenne, à cette nuance près que la Charte assortissait les principes généraux d’une série d’engagements « à la carte » mais relevant du droit des traités.
Mais cette feuille de route détaillée d’une trentaine de pages, chaque objectif faisant l’objet d’un long paragraphe, gros de subdivisions, de l’objectif 1 (§.17) à l’objectif 23 (§.39), n’est pas tracée dans le vide. Elle s’achève par des dispositions pratiques en matière de « mise en œuvre » (§§.40 et sq) et de « suivi et examen » (§§.48 sq). Une dernière fois, les Etats réaffirment au passage leur « attachement au droit international », là où la version anglaise parle de « commitment », avant de souligner « que le Pacte devra être mis en œuvre dans le respect des droits et obligations découlant du droit international » (§.41), « implemented in a manner that is consistent with our rights and obligations under international law ».
Le Pacte offre ainsi un guide de bonnes pratiques, une boite à outils pour la coopération internationale, avec une logique pragmatique. L’accent est mis sur le process multi-acteurs, plus que sur la consolidation du corpus juridique. On parle de renforcement des capacités, de « connection hub » et de « start-up fund », que la version française s’efforce de traduire par « pôle de liaison » et « fonds d’amorçage » (§.43), allant jusqu’à voir un « avis consultatif » dans la fonction de conseil (advising on). Paradoxalement très peu de place est faite aux organes juridiques ou aux experts indépendants.
Ce flou volontaire sur les engagements assumés par les Etats, en vertu du droit international et notamment des traités de base relatif aux droits de l’homme traduit sans doute les rapports de force entre les Etats et la méfiance à l’égard de la Convention internationale sur les travailleurs migrants, cette mal-aimée, mais il reflète aussi la tentation de la négociation permanente, ou pour tout dire, du surplace, comme si le droit lui aussi était une chose trop sérieuse pour être confié à des juristes.
A force de réaffirmations contradictoires et de références croisées où les engagements deviennent des objectifs à défaut de voir les obligations de résultat se traduire par les obligations de moyen, on se trouve devant un cercle vicieux : le Pacte mondial va-t-il se retrouver dans la liste des « instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme » consacrés aux droits des migrants, qui reste une des sections les plus brèves du recueil officiel des Nations Unies ?
- Georges Bry, Précis élémentaire de droit international public, 4ème éd, Larose, 1901, pp. 100 et 101.
- Ibid, pp. 101 et 102.
- Paul Fauchille, Traité de droit international public, tome I, Ière partie, La paix, Rousseau, 1922, p. 836. Cf . aussi p. 891.
- Ibid, p.826.
- Ibid, p.889.
- Ibid, p. 893.
- Ibid, p.897.
- Cf . Notre rapport sur la « pré-écriture de la Déclaration universelle des droits de l’homme » dans le colloque de la CNCDH et de l’EHESS, sous la dir. de Valentine Zuber à paraitre.
- Emmanuel Decaux, « Le droit à une nationalité en tant que droit de l’homme », RTDH 2011/237.
- François Leduc, « L’asile territorial, conférence des Nations Unies (Genève, janvier 1977) », AFDI, 1977.
- Préambule de la partie XIII du traité de Versailles.
- Communication n°196/185, constatations du 13 avril 1989, in Sélection des décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu du Protocole facultatif, vol.3, p.107, CCPR/C/OP/3, Nations Unies, 2002.
- Cour EDH, 2ème sect., Koua Poirrez c. France, 30 septembre 2003, Requête no 40892/98.
- Sur cette problématique, cf. notre contribution « Soft law et bonne foi », dans les Mélanges en l’honneur d’Elisabeth Zoller, Penser le droit à partir de l’individu, Dalloz, 2018.
- HRI/GEN/1/Rev.8.
- CRC/C/GC/22 et CMW/C/GC/3 ;
- Sur des objections de principe dans le contexte européen, cf. le débat sur la subsidiarité lors du premier Cycle de conférences du Conseil d’Etat, Le droit européen des droits de l’homme, la Doc.fr, 2011, notamment p.45.
- Comp. A/HRC/35/25 et A/HRC/38/41.
- L’infortuné « Pacte de stabilité », cette initiative diplomatique, lancée par M. Balladur en pleine cohabitation avait déjà cette traduction faible en anglais, « Pact »…Cf. Emmanuel Decaux, « le Pacte de stabilité en Europe, action commune ou pacte manqué ? » in Mélanges offerts à Hubert Thierry, L’évolution du droit international, Pedone, 1998.
- Ont voté contre les Etats-Unis, la Hongrie, Israël, la Pologne et la République tchèque.
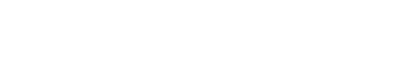

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
