La procédure d’extradition de Mario Sandoval vers l’Argentine, afin qu’il réponde devant ses juridictions des crimes qu’il est accusé d’avoir perpétrés durant la dictature militaire, devrait bientôt connaître son épilogue. Elle aura été longue, l’individu ayant su déployer, au service de la guérilla judiciaire, l’ardeur, le talent et l’obstination qu’il lui est reproché d’avoir auparavant consacré à la contre-insurrection policière. M. Sandoval aura ainsi contribué à faire progresser le droit de l’entraide judiciaire en matière pénale français, puisque sont désormais, grâce à lui, précisées les règles qui régissent le contrôle de la double incrimination et de la prescription, mais aussi celles afférentes à l’extradition des personnes ayant acquis la nationalité française entre la commission des faits qui leur sont reprochés et la demande d’extradition qui les vise1.
Les faits à l’origine de cette procédure et les principales étapes de cette dernière peuvent être brièvement rappelés.
Mario Alfredo Sandoval, surnommé « Churrasco », a été officier-inspecteur de la Police Fédérale, affecté aux « affaires politiques » au sein de la Coordination fédérale2 à Buenos Aires, entre 1976 et 1979; son dossier professionnel mentionne qu’il était en charge des enseignements de lutte « anti subversive » et qu’en novembre 1976, il a été « recommandé » pour son action dans les « opérations contre les subversifs ». Il a quitté l’Argentine pour la France en 1985, dont il obtiendra la nationalité en 1997. Après un diplôme d’études approfondies en philosophie politique et un doctorat en science politique à la Sorbonne, il a fait carrière dans l’intelligence économique et comme chargé d’enseignements dans diverses institutions universitaires françaises.
Son passé a été révélé par des enquêtes journalistiques, d’abord en France en 20073, puis en Argentine en 20084. Il a, alors, déposé plainte pour diffamation, arguant être victime d’une homonymie, mais a été débouté par le tribunal correctionnel d’Auxerre le 16 février 2012. Le 6 mars 2012, le juge argentin S. Torres a émis à son encontre un mandat d’arrêt international suivi, le 2 août de la même année, d’une demande d’extradition adressée aux autorités françaises pour des faits qualifiés de « tortures, tortures suivies de mort, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l’humanité » perpétrés à l’encontre de plusieurs centaines de victimes. Certaines des exactions perpétrées par M. Sandoval sont répertoriées dans le rapport, publié en 1984, de la commission nationale sur la disparition des personnes (CONADEP), mise en place après la restauration de la démocratie pour enquêter sur la pratique des disparitions forcées pendant la dictature5. La même commission a établi que les « disparus » avaient souvent été jetés d’avions dans le Rio de la Plata, qui marque la frontière entre l’Argentine et l’Uruguay6.
Sandoval a été interpellé le 13 juin 2013 et, présenté le lendemain aux autorités judiciaires, il a déclaré ne pas consentir à son extradition. Après une première audience en date du 9 octobre 2013, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a rendu, le 28 mai 2014, un avis partiellement favorable à cette extradition, d’une part, en limitant la procédure au seul cas de Hernan Abriata, étudiant en architecture interpelé à son domicile le 30 octobre 1976 par une équipe dirigée par M. Sandoval et disparu après une période de détention à l’Ecole supérieure de mécanique de la marine (ESMA)7 et, d’autre part, en écartant la qualification de « crimes contre l’humanité », par application des exigences de la légalité criminelle, cette infraction n’ayant été pleinement intégrée dans le droit pénal français qu’en 1994.
Devant la Cour de cassation, M. Sandoval a d’abord soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, arguant de la rupture d’égalité entre citoyens, ceux ayant acquis la nationalité française après la date de commission des faits querellés étant privés du bénéfice du privilège de non-extradition des nationaux. Transmise au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation, la QPC n’a pas prospéré et l’affaire est venue devant la chambre criminelle. Adoptant la position de l’Avocat Général, celle-ci a cassé, le 18 février 2015, l’arrêt de la cour d’appel, motif pris que la juridiction ne s’était pas suffisamment justifiée sur l’éventuelle prescription des faits : la victime ayant disparu en 1976 et n’étant pas reparu depuis la fin de la dictature en 1983, il était vraisemblable qu’elle soit morte ; la procédure d’extradition ayant été initiée presque quarante ans après les faits, il existait des motifs sérieux de penser que le crime de séquestration8 ayant entraîné la mort était prescrit par application du droit pénal français9. Elle a, en conséquence, ordonné le renvoi devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles.
Par arrêt en date du 19 octobre 201710, celle-ci a émis un nouvel avis partiellement favorable à l’extradition « pour les seuls faits qualifiés, en droit français, de détention ou séquestration d’une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, et, en droit argentin, de privation illégale de liberté aggravée, de tortures, ainsi que de crimes contre l’humanité » en limitant, elle aussi, les faits permettant l’extradition au cas Abriata. Lors de l’audience tenue le 14 septembre précédent, la présidente de la chambre de l’instruction avait rappelé la coïncidence entre les informations transmises par la justice argentine sur l’identité de M. Sandoval, particulièrement celles contenues dans le dossier afférent à sa carrière de policier, celles qu’il a fournies à l’administration française dans son dossier de demande de naturalisation et les témoignages de proches d’Abriata et d’anciens détenus à l’ESMA devant la CONADEP, et insisté sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité en droit pénal argentin. L’avocate de l’Etat argentin, autorisée à intervenir, avait rappelé le respect des règles du procès équitable et les garanties offertes aux accusés par la justice argentine lors des cent quatre-vingt procès au cours desquels ont déjà été jugés près de 3 000 agents, civils ou militaires, de la dictature après l’abrogation des lois d’amnistie en 2003 et la confirmation de l’inconstitutionnalité de celles-ci par la Cour suprême en 2005. L’Avocat général avait démontré que la prescription n’était pas acquise puisque, faute de dépouille d’Abriata ou d’aveu de Sandoval, l’infraction d’enlèvement suivi de séquestration devait être considérée comme continue, comme le confirmaient les nouvelles dispositions relatives à la prescription de l’action publique issues de la loi adoptée en 2017, levant ainsi les difficultés juridiques qui avaient conduit à la cassation de l’avis de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris11. M. Sandoval a, en conséquence, formé un pourvoi en cassation, rejeté le 24 mai 2018 par la chambre criminelle12.
Le 31 août de la même année, le gouvernement français a autorisé par décret son extradition vers l’Argentine13; un recours pour excès de pouvoir a été formé devant le Conseil d’Etat. Lors de l’audience, M. Sandoval a soulevé une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la norme suprême des règles qui régissent la prescription des infractions continues. Saisi, le Conseil constitutionnel a, le 24 mai 2019, refusé de lui donner satisfaction, et a jugé « conformes à la Constitution les dispositions de l’article 7 du code de procédure pénale », telles qu’interprétées par la chambre criminelle de la Cour de cassation14. Lorsque le Conseil d’Etat se sera prononcé, s’il n’estime pas le décret d’extradition entaché d’excès de pouvoir, plus rien ne s’opposera à la mise à exécution par les autorités françaises de l’extradition de M. Sandoval vers l’Argentine afin qu’il y soit enfin jugé, probablement lors du quatrième volet du procès relatif aux crimes commis dans l’enceinte de l’ESMA.
Le présent commentaire s’articule autour de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 24 mai 2018, par lequel elle rejette le pourvoi formé par M. Sandoval contre l’avis de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, partiellement favorable à son extradition vers l’Argentine15.
Cette décision est intéressante à plusieurs titres.
D’abord, parce qu’un avis défavorable de l’autorité judiciaire à l’extradition s’impose au gouvernement qui ne peut passer outre; or, le motif de cassation adopté par la Haute juridiction pénale en 201516 semblait difficile à surmonter puisqu’il était fondé sur un raisonnement conforme aux jurisprudences, nationale et internationale, pertinentes en la matière et qu’il exigeait a priori pour être dépassé un revirement radical de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les effets de la norme internationale au regard des exigences du principe de légalité en matière pénale17. Non sans ingéniosité, la Cour parvient, toutefois, à masquer la liberté qu’elle s’autorise à l’égard de sa cohérence jurisprudentielle et valide l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, permettant ainsi la poursuite, par la phase administrative, de la procédure d’extradition de M. Sandoval. Néanmoins, elle ne va pas, ce faisant, jusqu’à reconnaître le crime de disparition forcée comme partie intégrante des crimes contre l’humanité, ni a fortiori jusqu’à faire évoluer sa jurisprudence relative à la consécration par le droit pénal national de ces infractions – jurisprudence certes protectrice des éventuels auteurs de crimes internationaux perpétrés pendant les guerres d’indépendance dans les anciennes colonies françaises mais qui est aussi, à cet titre, garante de l’impunité des auteurs de tels crimes perpétrés avant 1994, qui auraient eu, quelle que soit leur nationalité, l’idée de s’établir sur le territoire français18.
Ensuite, l’intérêt de la décision découle aussi de la clarification qui en résulte s’agissant à la fois du contrôle de la double incrimination et de celui de l’éventuelle acquisition de la prescription pour les faits querellés à l’origine de la demande d’extradition; sur ce dernier point, cet arrêt a donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel qui l’a conforté et, quant au premier point, il a été rendu concomitamment à un arrêt du Conseil d’Etat qui, sur la même question, a décidé d’une manière similaire et confirmé la convergence, voire la mise en cohérence, des contrôles juridictionnels exercés sur les phases judiciaire et administrative de l’extradition.
Enfin, l’arrêt est remarquable en ce que la Haute juridiction pénale, si elle permet, en l’espèce, l’extradition probable d’un individu suspecté d’être l’auteur de crimes de disparition forcée, ne lève pas pour autant par cette décision toutes les entraves à la coopération des autorités françaises à la poursuite des auteurs de tels crimes perpétrés avant l’entrée en vigueur en France de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée en 200619. Certes, la Convention ne le prévoit pas mais le juge pénal français aurait pu décider de mettre sa pratique en accord avec le haut degré d’implication de la France dans la négociation et la mise en œuvre de la Convention.
La décision ici commentée a été précédée d’un arrêt du 24 janvier 2018, qu’il faut ici évoquer car il permet de mieux cerner les questions de droit qu’a ensuite eu à trancher la chambre criminelle. Par cet arrêt du 24 janvier 2018, celle-ci a, en effet, autorisé la réouverture des débats20 après le pourvoi formé par M. Sandoval contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles en date du 19 octobre 2017, au motif « qu’il y a lieu, pour le cas où la chambre criminelle estimerait que l’article 696-3 du code de procédure pénale, applicable en l’absence de convention d’extradition entre l’Argentine et la France, n’implique pas de contrôler la qualification juridique des faits dans l’Etat requérant, de s’interroger sur l’application de l’article 696-4, 5°, dudit code, relatif à la prescription, s’agissant des faits qualifiés par l’Etat requérant de crimes contre l’humanité », et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 28 mars 2018 en invitant les parties à présenter leurs observations au moins deux semaines avant. La première disposition du code de procédure pénale visée définit « les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition », soit « tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant » et « les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la peine d’emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans », sous réserve, lorsque comme en l’espèce la France est l’Etat requis, que les faits sur lesquels est fondée la demande d’extradition soient punis « par la loi française d’une peine criminelle ou correctionnelle » ; la seconde prévoit un motif absolu de refus d’extrader « lorsque, d’après la loi de l’Etat requérant ou la loi française, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition […] et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant est éteinte ». En d’autres termes, la chambre criminelle de la Cour de cassation sollicite les observations des parties sur, d’une part, l’étendue du contrôle de la double incrimination qui devra être opéré en l’espèce et, d’autre part, dans le cas où ce contrôle n’impliquerait pas de vérifier la qualification retenue par l’Etat requérant, sur l’éventuelle acquisition de la prescription de l’action publique à l’égard des faits susceptibles d’être qualifiés en droit argentin de crimes contre l’humanité – c’est-à-dire le crime de disparition forcée potentiellement infligé à Abriata. C’est donc sans surprise que l’arrêt du 24 mai 2018 se concentre sur ces deux questions.
La Cour commence par rappeler que, l’Etat requérant n’étant pas partie à la procédure, il ne peut « déposer un mémoire ou des observations devant la Cour de cassation »21 ; elle écarte, en conséquence, les « observations » produites au nom de l’Etat argentin après la réouverture des débats. Elle procède, ensuite, à l’exposé synthétique du contenu de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles en date du 19 octobre 2017. Est ensuite exposé le « moyen unique de cassation » soulevé dans le pourvoi, qui confirme la stratégie de M. Sandoval, consistant à « faire feu de tout bois » et mélangeant, dans les quatorze branches du moyen, les arguments les plus sérieux et les plus fantaisistes.
Au nombre des arguments peu convaincants sont ainsi soulevés, d’abord, la contradiction de motifs prétendument identifiée dans la mention par la Cour d’appel de la piètre qualité de la traductions de certaines pièces, qui n’aurait cependant pas constitué un obstacle à leur compréhension ou dans la déduction de la participation de M. Sandoval à l’enlèvement de M. Abriata de son appartenance à la police fédérale, tout en écartant les 595 autres crimes reprochés au nom du principe constitutionnel de la responsabilité pénale individuelle; ensuite, le défaut de motifs résultant de l’erreur évidente sur la personne, de l’absence de document administratif établissant le rattachement de M. Sandoval à l’ESMA ou établissant son pouvoir hiérarchique et/ou son rôle d’instigateur dans l’arrestation d’Abriata, de prétendues incohérences sur son âge au moment des faits et du défaut de vérification de l’existence en l’espèce d’un éventuel commandement de l’autorité légitime22 et, enfin, le manquement aux conditions essentielles de l’existence légale de l’arrêt consistant dans l’absence de vérification du respect des exigences du procès équitable en Argentine ou dans l’absence d’explication sur la contribution de M. Sandoval à la poursuite de la séquestration après qu’il a quitté l’Argentine pour la France en 198523.
En revanche, plusieurs arguments retiennent l’attention, même s’ils procèdent parfois d’une lecture quelque peu biaisée de la décision de la chambre de l’instruction versaillaise. La défense de M. Sandoval évoque ainsi une triple violation de l’article 696-3 du code de procédure pénale qui priverait l’arrêt des conditions essentielles de son existence légale, résultant, d’abord, de la contrariété entre la qualification de « crimes contre l’humanité » appliquée aux faits pour lesquels est donné l’avis favorable à l’extradition et l’impossibilité de les qualifier de la sorte en droit français, ensuite, d’avoir écarté l’argument de la défense relatif à l’absence d’incrimination des crimes contre l’humanité en Argentine entre 1976 et 1979 en invoquant le défaut de compétence pour vérifier l’exactitude de la qualification retenue par l’autorité requérante alors qu’il s’agissait d’une remise en cause de l’existence même de l’incrimination au temps de la commission de l’infraction et, enfin, d’avoir invoqué son défaut de compétence pour contrôler la manière dont l’Etat requérant entendait appliquer dans son ordre juridique interne les conventions internationales, afin de se soustraire à l’examen de la reconstruction rétroactive des « crimes contre l’humanité » à laquelle les autorités argentines ont procédé. De surcroît, la défense de M. Sandoval soulevait l’obstacle à l’extradition qui résulte de l’acquisition de la prescription de l’action publique et invoquait, à son soutien, le défaut de motifs consistant pour la juridiction du fond à ne pas avoir expliqué, « ainsi que la Cour de cassation lui en avait fait obligation dans son arrêt du 18 février 2015 », comment la séquestration avait pu se poursuivre après le retour à la démocratie, et l’atteinte à la présomption d’innocence consistant à imposer à M. Sandoval d’établir le sort réservé à Abriata.
Sans s’exposer à une quelconque critique, la chambre criminelle de la Cour de cassation écarte comme n’étant « pas de nature à être admis », les griefs tirés de la piètre qualité des traductions, du défaut d’établissement du pouvoir hiérarchique exercé par M. Sandoval ou du rôle d’instigateur de l’enlèvement d’Abriata, et de l’éventuelle existence en l’espèce d’un commandement de l’autorité légitime. De même, s’agissant des griefs d’erreur sur la personne, d’absence de démonstration du rattachement de M. Sandoval à l’ESMA, d’incohérence entre l’âge de M. Sandoval au moment des faits querellés et les fonctions qu’il était censé exercer au sein de la police argentine et de manquement au principe d’individualité de la responsabilité pénale, la Haute juridiction pénale rappelle les éléments matériels, particulièrement les témoignages sur lesquels la Cour d’appel de Versailles s’est fondée, pour estimer que cette dernière a justifié « sans insuffisance ni contradiction » sa décision de ne pas considérer que la demande d’extradition était affectée d’une « erreur évidente ». Enfin, elle approuve la chambre de l’instruction d’avoir écarté le grief de possible manquement aux exigences du procès équitable en rappelant que celle-ci a fondé sa décision en la matière sur les instruments de protection des droits fondamentaux auxquels l’Argentine est partie, sur l’existence d’un traité d’extradition entre la France et l’Argentine, censé établir « l’indépendance et de l’impartialité de la justice » argentine24, et sur les garanties fournies par les autorités de cet Etat.
Le grief de manquement aux implications du principe de la légalité criminelle à raison du défaut d’incrimination des crimes contre l’humanité, en droit pénal français et argentin, à la date de commission des faits querellés, est lui aussi écarté par la chambre criminelle. Après avoir rappelé le raisonnement adopté par la chambre de l’instruction – qui établit de facto la reconstruction a posteriori comme crimes contre l’humanité, par les autorités politiques et judiciaires argentines, des infractions perpétrées durant la dictature militaire –, la chambre criminelle approuve la juridiction versaillaise, au motif que « s’il appartient aux juridictions françaises, lorsqu’elles se prononcent sur une demande d’extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l’extradition est demandée étaient incriminés par l’Etat requérant au moment de leur commission, il ne leur appartient pas de vérifier si ces faits ont reçu, de la part des autorités de cet État, une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de ce dernier ». Ce faisant, la Cour distingue donc la question de la légalité de celle de la prescription pour les rendre autonomes l’une de l’autre, ce qui peut susciter quelques réserves.
Enfin, sur les griefs tirés de l’éventuelle prescription de l’action publique, acquise en droit français, à la date de la demande d’extradition, la Cour de cassation, après avoir rappelé le raisonnement suivi par la chambre de l’instruction pour estimer que la prescription de la séquestration dont Abriata a été victime n’a pas commencé à courir, approuve cette décision en affirmant que « dès lors que la prescription des infractions continues ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets, et que ce point de départ, en l’état de la procédure, ne peut être déterminé, la chambre de l’instruction a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ».
En conséquence, elle rejette le pourvoi.
La chambre criminelle de la Cour de cassation s’était, par son précédent arrêt dans cette affaire25, placée dans une situation délicate: d’une application conforme de sa jurisprudence, elle avait déduit une exigence envers le juge du fond qui risquait de limiter drastiquement toute possibilité d’extradition des auteurs de crimes de disparition forcée perpétrés avant l’entrée en vigueur des articles 221-12 et seq. du code pénal, créés par la loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, alors même que la France est, avec l’Argentine, l’Etat qui a principalement œuvré pour l’adoption de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 200626. La très habile insoumission de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de renvoi lui a offert la possibilité de s’extirper de cette inconfortable situation en contournant l’écueil de la prescription dressé par la Haute juridiction pénale elle-même, tout en n’imposant pas à cette dernière la solution suggérée par la doctrine. Divers auteurs avaient en effet plaidé en faveur d’un revirement de jurisprudence qui l’aurait conduite à consacrer, comme son homologue argentine, le caractère déclaratoire de la consécration en droit national des crimes contre l’humanité et, donc, l’effet rétroactif des dispositions des articles 211-1 et seq. du code pénal. L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 24 mai 2018, est ainsi l’occasion pour la Haute juridiction pénale de confirmer deux principes, l’un relatif à l’étendue du contrôle de la double incrimination (I) et l’autre afférent au contrôle de l’acquisition de la prescription (II). Il convient de préciser ces principes en les confrontant aux particularités du crime de disparition forcée.
I. Le contrôle de la double incrimination
Pour bien saisir l’enjeu du contrôle de la double incrimination, il faut opérer un retour en arrière et rappeler le raisonnement adopté par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, première juridiction à avoir donné un avis sur la demande d’extradition visant M. Sandoval. Par un arrêt abondamment motivé en date du 28 mai 2014, elle avait proposé une démonstration qui ne se distinguait ni pas sa clarté, ni par son adresse.
En effet, après avoir rappelé « qu’il est de jurisprudence constante […] que le respect du principe de la double incrimination par la législation de l’Etat requérant et par celle de l’Etat requis n’implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations considérées mais requiert seulement qu’ils soient incriminés par l’une et par l’autre et qu’ils satisfassent aux peines fixées par les dispositions légales applicables », elle avait exclu, par référence à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les affaires rwandaises, la qualification de crimes contre l’humanité à propos des faits qu’il était reproché à M. Sandoval d’avoir perpétrés à l’encontre d’Abriata, ainsi que celles de « crimes d’arrestation » et « d’enlèvement », à raison de l’acquisition de la prescription. Elle avait, en conséquence, considéré que, dès lors qu’Abriata n’avait « à ce jour, toujours pas été retrouvé et aucune pièce du dossier ne permettant de déduire que sa détention et sa séquestration [avaient] cessé, il n’en [était], en revanche, pas de même, des faits qualifiés en droit français de détention ou de séquestration d’une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, dont il aurait notamment été victime, infractions dont il est établi, aux termes d’une jurisprudence constante, d’une part, qu’elles sont juridiquement distinctes de celles de l’arrestation et de l’enlèvement (cf. notamment Crim., 26 juillet 1966 in Bull. crim n° 211 et crim 12 juin1981 in Bull. crim n° 198) et d’autre part, qu’étant considérées comme constitutives d’infractions continues » pour en conclure que ces infractions « ne se prescrivent qu’à partir du moment où elles ont pris fin (cf. notamment Crim., 3 mars 1983 in Bull. crim n° 92) ». Elle s’était ensuite assurée de l’existence d’une incrimination équivalente, en droit pénal argentin, à l’époque des faits27 comme en droit contemporain28. Jusque-là, le raisonnement n’était pas critiquable.
Mais, à grand renfort de références à la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice de la Nation argentine et à celle des juridictions pénales internationales ad hoc, elle avait ensuite examiné la qualification de « crimes contre l’humanité » appliquée en Argentine aux faits constitutifs de « disparitions forcées ». Or, après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’Etat, aux termes de laquelle « il n’appartient pas aux autorités françaises, lorsqu’elles se prononcent sur une demande d’extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l’extradition est demandée ont reçu, de la part des autorités de l’Etat requérant, une qualification juridique exacte au regard de la loi pénale de cet Etat » et « qu’il en est ainsi quand bien même ladite qualification pénale revêtirait-elle celle notamment de crimes contre l’humanité », elle ajoutait maladroitement, par référence à l’article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, que « le principe de légalité est respecté dès lors que les faits, dont la personne poursuivie pénalement aurait été l’auteur, sont incriminés par le droit national ou par le droit international », sans distinction « entre le droit international coutumier et le droit international conventionnel ». Puis, après avoir rappelé que le principe de l’égalité souveraine de tous les Etats implique « qu’il n’appartient pas aux autorités françaises, lorsqu’elle se prononcent sur une demande d’extradition, d’apprécier les conditions dans lesquelles l’Etat requérant entend appliquer, dans son ordre juridique interne, les stipulations des traités ou des accords internationaux auxquels ledit Etat est partie et qui sont visés dans sa demande d’extradition », elle en concluait, sans que la logique et la rigueur du raisonnement soient évidentes, « que la teneur du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 prévaut, eu égard à l’économie de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur celle des articles 111-3 et 112-1 du code pénal ». Elle prétendait renforcer ce dernier argument par une référence à l’article 49.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, combinée à la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour, par le biais quelque peu extravagant de l’article 62 de la Constitution, affirmer qu’il s’imposait à elle. En conclusion, elle estimait que « l’avocat de M. Sandoval est mal fondé à soutenir dans son mémoire que la demande d’extradition dont le susnommé fait l’objet contrevient au principe de légalité » et « que les faits qualifiés en droit français de détention ou de séquestration d’une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, et en droit argentin de privation illégale de liberté aggravée, de tortures, ainsi que de crimes contre l’humanité, pour lesquels l’extradition de M. Sandoval est susceptible d’intervenir, étant incriminés en droit français aussi bien qu’en droit argentin et étant punis dans les deux droits considérés de peines d’un quantum idoine, les dispositions de l’article 696-3 du code de procédure pénale, relatives à la double incrimination des faits extraditionnels dans l’Etat requérant et dans l’Etat requis, se [trouvaient] respectées ». Comble de la maladresse, elle ajoutait de manière parfaitement superfétatoire que « la jurisprudence considérée de la Cour Suprême de Justice de la Nation n’est pas sans rappeler celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avant que les crimes contre l’humanité ne soient expressément incriminés dans le » nouveau » code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, […], jurisprudence, aux termes de laquelle d’une part, la loi du 26 décembre 1964 (tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité) s’est bornée à confirmer qu’était déjà acquise en droit interne par l’effet des accords internationaux auxquels la France avait adhéré, l’intégration de l’incrimination (des crimes contre l’humanité)/ cf. notamment arrêt » Barbie » du 26 janvier 1984 in Bull, crim. n° 34) et d’autre part, les crimes contre l’humanité étaient considérés comme constituant des » crimes de droit commun commis dans certaines circonstances et pour certains motifs » et punissables des peines prévues pour les qualifications de droit commun correspondant aux faits réprimés (cf. notamment arrêt » Touvier » du 6 février 1975 in Bull, crim n° 42 et arrêt » Bousquet » du 31 janvier 1991 in Bull, Crim. n° 54) ».
De ce salmigondis juridique résultait donc la remise en cause de la jurisprudence patiemment construite par la chambre criminelle de la Cour de cassation afin de s’assurer que la qualification de crimes contre l’humanité ne pourrait trouver à s’appliquer aux exactions perpétrées par les agents civils et militaires français durant les guerres d’indépendance dans les anciennes colonies. Arguant des exigences du principe de légalité, la Haute juridiction considère, en effet, que, jusqu’à l’entrée en vigueur du code pénal en 1994, qui a introduit dans le droit commun les crimes contre l’humanité29, ces qualifications ne sont susceptibles de s’appliquer qu’à des actes accomplis durant la seconde guerre mondiale, et uniquement par des agents au service des puissances de l’Axe30; non sans ironie s’agissant des faits reprochés à M. Sandoval, elle a expressément exclu la coutume internationale des sources du droit pénal pour faire échapper à la justice un ancien militaire français, qui revendiquait avoir pratiqué la torture, les « corvées de bois » et les « crevettes Bigeard » durant la guerre d’Algérie31. Or, la décision de la Cour d’appel de Paris ouvrait la voie à une assimilation de la baie d’Alger au Rio de la Plata par un revirement de jurisprudence donnant plein effet aux dispositions des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 15.1 du Pacte de 1966, ce que, malgré les demandes argumentées de la doctrine, la chambre criminelle s’était toujours refusée à faire – y compris lorsque cela impliquait l’impunité de génocidaires présumés32. Le motif de cassation choisi dans l’arrêt du 18 février 2015 est tellement peu convaincant qu’il ne peut être exclu que c’est, au moins autant que l’éventuelle prescription, la consécration potentielle du jus cogens comme source de droit pénal que la chambre criminelle a souhaité censurer, sans avoir à le dire expressément.
La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles devait donc se montrer plus habile; elle n’y a pas manqué. Après avoir exposé la solution qu’elle a retenue et ses conséquences en droit de l’extradition (A), nous examinerons dans quelle mesure cette solution permet la répression effective des crimes de disparition forcée (B).
A. Retour à l’orthodoxie légaliste
En prenant garde de ne plus s’aventurer sur le terrain des crimes internationaux, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt en date du 19 octobre 2017, limite son contrôle de la double incrimination à la vérification qu’il existait bien, entre 1976 et 1979 et en droit positif, en droit pénal français et en droit pénal argentin, des qualifications pénales susceptibles de s’appliquer au crime de disparition forcée que M. Sandoval est suspecté d’avoir perpétré à l’encontre d’Hernan Abriata.
Il fallait, pour se faire, que la juridiction satisfît aux exigences du respect de l’ordre public français et du principe de réciprocité comme condition de l’entraide judiciaire en matière pénale, qui fonde l’exigence de double incrimination consacrée à l’article 696-3 du code pénal, mais aussi qu’elle respecte la souveraineté de l’Argentine. Pour ce faire – et comme l’avait au demeurant fait avant elle la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris -, elle va s’appuyer sur un principe bien établi du droit français de l’extradition, aux termes duquel « s’il appartient aux juridictions françaises, lorsqu’elles se prononcent sur une demande d’extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l’extradition est demandée étaient incriminés par l’Etat requérant au moment de leur commission, il ne leur appartient pas de vérifier si ces faits ont reçu, de la part des autorités de cet Etat, une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de ce dernier »33.
Le raisonnement de la chambre de l’instruction mérite d’être exposé. Comme la Cour d’appel de Paris, elle commence par exclure les qualifications d’arrestation et enlèvement, estimant, à juste titre, que faute d’acte interruptif, la prescription est acquise à leur égard en application du l’article 7 du code de procédure pénale. Elle évoque ensuite les arguments avancés par les autorités argentines pour qualifier ces faits de crimes contre l’humanité pour en conclure que, si « à l’époque de la commission des faits reprochés à M. Mario Sandoval, de 1976 à 1979, la qualification de crimes contre l’humanité n’existait pas en tant que telle, et ne s’appliquait pas à la jurisprudence argentine », ces arguments « expliquaient que ce critère [ait] été recueilli plus tard, lorsque la démocratie [a] été rétablie et qu’il s’agissait d’une notion générique d’interprétation ». Cela lui permet d’écarter le grief soulevé par la défense, selon lequel « la qualification de crimes contre l’humanité donnée aux faits par les autorités requérantes était de pure opportunité ». Mais elle ne poursuit pas plus avant sa discussion sur l’applicabilité aux faits de l’espèce de la qualification de crimes contre l’humanité, motifs pris « qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas aux autorités françaises, lorsqu’elles se prononcent sur une demande d’extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l’extradition est demandée ont reçu, de la part des autorités de l’Etat requérant, une qualification juridique exacte au regard de la loi pénale de cet Etat » et « qu’en application du principe de l’égalité souveraine de tous les Etats, consacré par l’article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, il n’appartient pas non plus aux autorités françaises, lorsqu’elles se prononcent sur une demande d’extradition, d’apprécier les conditions dans lesquelles l’Etat requérant entend appliquer, dans son ordre juridique interne, les stipulations des accords ou traités internationaux auxquels il est partie, et qui sont mentionnés dans sa demande d’extradition ». Au contraire, dans un mouvement d’apparente soumission, elle estime que, conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle, « au regard de la loi française, notamment en application de l’article 112-1 du code pénal, seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que les crimes contre l’humanité n’ont été définis et réprimés que par les articles 211-1 à 213-4-1 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 » et « qu’en conséquence, en application des principes de la légalité des délits et des peines et de la non rétroactivité de la loi pénale, les faits reprochés à M. Mario Sandoval et qui auraient été commis entre le 30 octobre 1976 et le 19 septembre 1979 ne peuvent être qualifiés, en droit français, de crimes contre l’humanité ». Cette qualification étant écartée, comme toute référence à l’effet du jus cogens en droit pénal national, elle peut alors affirmer que, parmi les comportements reprochés à M. Sandoval, subsiste, s’agissant de l’affaire Abriata, la qualification « d’imposition de tortures et de privation illégale de liberté aggravée, en droit argentin et de détention ou séquestration sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, en droit français », qui constituent « dans les deux législations des infractions continues », et satisfaire ainsi à l’exigence de double incrimination dans ses dimensions rationae materiae et temporis.
Cette démonstration est validée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2018, d’autant plus aisément que la juridiction versaillaise s’est manifestement inspirée d’un arrêt rendu peu avant sa décision par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 12 juillet 2016, la chambre criminelle, pour confirmer l’avis favorable donné par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris à l’extradition d’un individu réclamé par la Bosnie-Herzégovine sur le fondement de la seule qualification de crimes contre l’humanité à raison de faits perpétrés en 1992, avait considéré qu’« après avoir énoncé qu’il lui appartenait de s’assurer du respect du principe de la double incrimination et des conventions internationales auxquelles la France est partie, l’arrêt retient, notamment, que les crimes contre l’humanité étaient définis et réprimés par la législation de l’ex-Yougoslavie au moment des faits et par l’actuel code pénal de Bosnie-Herzégovine et que la remise de M. X… par la France aux autorités de l’Etat requérant pour crime contre l’humanité correspondrait de facto à une remise pour assassinat » et « qu’en l’état de ces seuls motifs, et dès lors que l’incrimination de crime contre l’humanité était définie précisément dans la législation de l’Etat requérant par les articles 141 et 142 du code pénal de la république fédérative de Yougoslavie, applicable au moment des faits, puis dans les articles 171 et 172 du code pénal de l’actuelle Bosnie-Herzégovine, comme étant, notamment, des meurtres et actes d’extermination perpétrés contre des populations civiles et que la loi française, déjà applicable au moment des faits, réprimait corrélativement l’assassinat, la chambre de l’instruction, qui a vérifié l’existence de la double incrimination prévue par la Convention européenne d’extradition, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées »34.
Eu égard aux suites de la procédure diligentée contre M. Sandoval, ce raisonnement présente de surcroît l’insigne intérêt de renforcer la convergence des jurisprudences judiciaire et administrative en matière de contrôle du respect de la condition de double incrimination dans les procédures d’extradition.
En effet, dans un arrêt du 18 juin 201835, le Conseil d’Etat, saisi lui aussi de faits perpétrés avant le 1er mars 1994 et qualifiés de « crimes contre l’humanité » par les autorités de l’Etat requérant, a énoncé, dans un considérant de principe, « qu’il résulte des principes généraux du droit de l’extradition qu’il n’appartient pas aux autorités françaises, lorsqu’elles se prononcent sur une demande d’extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l’extradition est demandée ont reçu, de la part des autorités de l’Etat requérant, une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de cet Etat ; qu’il leur appartient, en revanche, de vérifier qu’est respecté́ le principe, […] de la double incrimination par la législation de l’Etat requérant et par celle de l’Etat requis qui, s’il n’implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans ces deux législations, requiert que les faits soient incriminés par l’une et l’autre et satisfassent à la condition relative aux peines encourues, dans le respect des principes de non-rétroactivité́ de la loi pénale et d’application immédiate de la loi pénale moins sévère, tels qu’ils sont imposés par l’ordre public français »36. S. Roussel et C. Nicolas37 relèvent que « cet alignement de la position du Conseil d’Etat, dont le droit pénal n’est pas le cœur de métier, sur celui de la Cour de cassation était opportun, tant les contrôles exercés, d’une part, par la chambre criminelle dans le cadre d’un pourvoi en cassation formé contre l’avis motivé de la chambre d’accusation sur une demande d’extradition et, d’autre part, par le Conseil d’Etat dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’extradition […] tendent à se rapprocher ». Il est donc peu vraisemblable que le Conseil d’Etat, lorsqu’il examinera le recours pour excès de pouvoir formé par M. Sandoval, trouve quelque irrégularité dans le contrôle exercé, en cette affaire, sur la double incrimination des faits.
Est-ce à dire, pour autant, que le raisonnement adopté par les juridictions suprêmes permet de passer outre l’obstacle de la double incrimination chaque fois que sera requise des autorités françaises l’extradition d’un individu à raison d’un crime de disparition forcée perpétré avant le 1er mars 1994 ?
B. La solution adoptée satisfait-elle aux exigences du droit international pénal?
L’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées définit la disparition forcée comme « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ». Aux termes de l’article 5 du même texte, « la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit ». Il est établi que, durant la période dite de « processus de réorganisation nationale », soit la dictature militaire, en Argentine, la pratique des disparitions forcées a présenté un caractère systématique.
Dès lors, en écartant la qualification de « crimes contre l’humanité », la justice pénale française permet-elle néanmoins à l’Etat d’assumer ses obligations internationales ?
A priori, la réponse est positive, dès lors que, comme en l’espèce, les comportements constitutifs du crime de disparition forcée font l’objet d’autres incriminations, anciennes, dans le code pénal national. En quelque sorte, avant l’intégration de la Convention de 2006 dans le droit pénal national, le crime de disparition forcé était incriminé par le biais de ses différentes composantes. Cela aurait pu permettre aux juridictions répressives nationales, sur le fondement des qualifications d’arrestation et séquestration arbitraires, éventuellement accompagnées de tortures et actes de barbarie, de sanctionner les auteurs de tels crimes perpétrés avant 2013 ; en matière d’extradition, ces incriminations autonomes des éléments constitutifs du crime de disparition forcée fournissent la norme répressive nécessaire aux juridictions pour constater qu’il est satisfait à l’exigence de double incrimination 38.
De même, le principe de spécialité qui s’applique en matière d’extradition ne constitue pas un obstacle dès lors qu’il n’interdit pas la modification, par les juridictions d’un Etat souverain, de la qualification des faits pour lesquels l’extradition a été accordée mais s’oppose seulement à ce que la personne extradée soit jugée pour d’autres infractions perpétrées antérieurement à sa remise aux autorités de l’Etat requérant et qui n’étaient pas mentionnées dans la demande d’extradition39.
En conséquence, s’agissant de la seule question de la qualification juridique des faits, dans les relations induites par l’entraide judiciaire en matière pénale comme pour la répression des auteurs étrangers de crimes de disparition forcée perpétrés contre des ressortissants français, par application de la compétence personnelle passive de la loi pénale française, le refus des juridictions pénales nationales d’appliquer la qualification de crimes contre l’humanité à des actes de disparition forcée perpétrés avant le 1er mars 1994 n’entrave pas l’efficacité de la répression, dès lors que des qualifications alternatives existent.
En revanche, et cela ne peut qu’être regretté, elle interdit que l’action publique soit engagée contre les agents de nationalité française, civils ou militaires, qui se sont rendus coupables de crimes de disparition forcée durant les guerres d’indépendance dans les anciennes colonies, protégés qu’ils sont par les lois d’amnistie et l’acquisition de la prescription pour les crimes relevant des qualifications « de substitution ». En cette matière, la chambre criminelle de la Cour de cassation serait donc bien avisée de suivre l’exemple de son homologue argentine, la Cour Suprême de Justice de la Nation, qui, par un arrêt du 2 novembre 1995, a affirmé le caractère déclaratif des textes nationaux intégrant la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et qualifié de crimes contre l’humanité les exactions perpétrées par les agents de la junte durant la dictature militaire40. Il lui suffirait, pour ce faire, d’opérer un revirement de jurisprudence en supprimant la restriction aux seuls actes accomplis « au nom ou pour le compte d’une puissance de l’Axe » du champ d’application de l’infraction de crimes contre l’humanité pour les faits perpétrés avant le 1er mars 1994 et de considérer comme déclaratives les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, issues de la réforme de 1992, qui consacrent l’imprescriptibilité de ces crimes.
Outre la clarification des règles afférentes au contrôle de la double incrimination, la chambre criminelle précise aussi, dans son arrêt du 24 mai 2018, ses exigences relatives à l’examen de l’éventuelle acquisition de la prescription de l’action publique en matière d’infractions continues.
II. Le contrôle de l’acquisition de la prescription de l’action publique
Dans une tribune publiée dans le journal Libération à la veille du premier arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’affaire Sandoval, Louis Joinet41 écrivait: « Dans la plupart des systèmes juridiques, les crimes non élucidés sont, en effet, prescrits après une longue période […]. Passé ce délai, l’auteur ne peut plus être poursuivi et les recherches cessent donc. Cette prime à l’impunité explique pourquoi cette pratique est utilisée intensivement (30 000 disparus en Argentine) par les régimes violateurs car cette prescription leur permet d’organiser juridiquement l’oubli en tournant la page après un certain temps. Pour tenir en échec cette impunité encouragée par la loi, les pays démocratiques ont organisé la lutte contre le temps qui passe par une jurisprudence qualifiant ces crimes de ‘crimes continus’ de telle sorte que le point de départ de la prescription se trouve retardé tant que, morte ou vivante, la victime n’est pas réapparue. C’est toute la portée de la décision que doit rendre la Cour de cassation. On comprendra aisément l’importance de l’enjeu car, au-delà de l’Argentine, ce sont tous les pays violateurs qui sont visés. Remettre en cause le caractère continu de ce crime serait donc allé à l’encontre de l’évolution générale du droit international et, par intégrisme légaliste, à priver les proches – qui sont aussi des victimes – du droit de savoir et du droit à la justice consacrés par la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cette convention, fruit de la coopération franco-argentine, outre qu’elle qualifie les disparitions forcées de crimes contre l’humanité imprescriptibles, stipule (article 8 b) que ‘l’Etat qui applique un régime de prescription à la disparition forcée prend les mesures nécessaires pour que le délai de prescription de l’action pénale commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu’. Ce jour, la justice française a l’occasion de permettre à un pays victime dans son histoire récente d’effroyables exactions d’en poursuivre les auteurs par une interprétation humaniste de la loi et non de leur offrir l’impunité par l’asile »42. D. Rebut rappelle, en outre, que l’effet donné à la prescription dans l’Etat requis a été critiqué par la doctrine – entre autre par Donnedieu de Vabres – car elle n’est pas soutenue par des justifications aussi sérieuses que celles qui fondent l’exigence de double incrimination43.
Pourtant, dans son arrêt en date du 15 février 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation devait adopter les motifs suivants: « L’arrêt d’une chambre de l’instruction, statuant en matière d’extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que, pour rejeter l’exception de prescription de l’action publique invoquée par l’avocat de M. Sandoval, qui soutenait que le délai de dix ans prévu par l’article 7 du code de procédure pénale était expiré à la date de la demande d’extradition, le 2 août 2012, l’arrêt énonce, en substance, que le crime de détention ou séquestration d’une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, est une infraction continue qui se prescrit à partir du moment où elle a pris fin, que M. Hernan Abriata, opposant politique à la dictature argentine, enlevé le 30 octobre 1976, n’a toujours pas été retrouvé, qu’on ne peut déduire des pièces du dossier que sa détention ou sa séquestration a cessé, et que dès lors la prescription de l’action n’est pas acquise au regard du droit français ; Mais attendu qu’en se déterminant par des motifs hypothétiques, sans mieux s’expliquer sur la prolongation de la séquestration d’Hernan Abriata, au-delà du renversement du régime dictatorial argentin en 1983, jusqu’à une date permettant d’écarter la prescription prévue par l’article 7 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ».
Les autorités argentines ont, pour leur part, fait le nécessaire pour écarter la prescription de l’action publique en matière de crimes de disparition forcée perpétrés durant la dictature militaire. Si, en décembre 1986, le Parlement argentin a adopté la Ley de Punto Final n°23.492, qui raccourcissait drastiquement le délai de prescription des délits et crimes commis par les agents de la junte, complétée, en mai 1987, par Ley de Obediencia debida n°23.521, qui exemptait de responsabilité pénale l’essentiel des subordonnés, si la Cour suprême a validé ces textes en 1987 et que le gouvernement a, alors, multiplié les décrets de grâce, l’arrivée à la Présidence de N. Kirchner a renversé cette organisation légale de l’impunité. Depuis lors, les textes exonérant la responsabilité des agents de la dictature ont été abrogés et la Cour suprême a conféré valeur constitutionnelle aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits fondamentaux, mais aussi à la convention de 2006 sur les disparitions forcées, permettant, en outre, de considérer ces dernières comme des crimes contre l’humanité, imprescriptibles.
L’arrêt du 24 mai 2018 revient sur l’interprétation adoptée en 2015 (A). L’état du droit positif qui en résulte est certainement satisfaisant pour le règlement de l’affaire Sandoval, mais il ne garantit peut-être pas que les auteurs de disparitions forcées perpétrées avant le 1er mars 1994 ne pourront, en se réfugiant en France, y trouver l’impunité (B).
A. Retour à la raison
Pour contourner l’obstacle de la prescription de l’action publique, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait, en 2014, considéré que la « privation illégale de liberté aggravée et de torture, dont Mario Sandoval aurait notamment été l’auteur à partir su 30 octobre 1976 sur la personne de Hernan Abriata » est une infraction continue dont la prescription « n’a pas encore commencé à courir, à la date de la demande d’extradition du gouvernement argentin (soit le 2 août 2012), étant, au surplus, observé à supposer même que le code pénal argentin eut ignoré le concept d’infraction continue, que les infractions considérées, en ce qu’elles sont constitutives également de crimes contre l’humanité, ne sont pas prescrites en droit argentin sur le fondement aussi bien de l’article 7 de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes du 9 juin 1994 que de l’article 1er de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité du 26 novembre 1968, article dont il est constant qu’il stipule que les crimes contre l’humanité (ainsi d’ailleurs que les crimes de guerre) sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis et ce même si ces actes ne constituaient pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis ; qu’ainsi que cela résulte de la teneur des considérants développés supra, que, conformément aux exigences » a contrario » de l’article 696-4 (5°) du code de procédure pénale, la prescription de l’action publique relativement aux faits extraditionnels pour lesquels la remise de M. X…est susceptible d’intervenir, ne se trouve acquise, ni en droit français ni en droit argentin, à la date de la demande d’extradition du gouvernement argentin (soit le 2 août 2012) ». Il n’est pas surprenant que la chambre criminelle n’ait pas été convaincue par cette démonstration, fondée sur un raisonnement mal articulé, et charitablement qualifiée de « motifs hypothétiques ».
La chambre de l’instruction versaillaise propose donc une analyse mieux structurée. Pour ne pas faire droit à l’exception de prescription de l’action publique soulevée par M. Sandoval, elle infère que les comportements, qualifiés « d’imposition de tortures et de privation illégale de liberté aggravée, en droit argentin et de détention ou séquestration sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, en droit français », constituent « dans les deux législations, des infractions continues dont la prescription a pour point de départ le jour où l’acte délictueux a pris fin » ; or, contrairement aux allégations de la défense, « la chambre criminelle n’a pas énoncé dans son arrêt du 18 février 2015 que ‘les faits allégués concernant la disparition de M. Hernan Abriata étaient prescrits’ », ce qui aurait entraîné « une cassation sans renvoi ». Elle relève ensuite que « depuis son enlèvement à son domicile le 30 octobre 1976, M. Hernan Abriata avait été vu fin 1976 dans les locaux de l’ESMA par d’autres personnes privées illégalement de liberté comme lui ; que depuis lors, il n’était pas réapparu, que son corps n’avait pas non plus été retrouvé, comme l’admettait la défense de M. Mario Sandoval dans son mémoire ; que le sort qui lui avait été réservé demeurait encore inconnu à ce jour ; qu’il était toujours porté disparu ; qu’en l’absence de découverte de M. Hernan Abriata, vivant ou mort, il ne pouvait être affirmé que sa détention ou séquestration arbitraire avait cessé, et ce, quand bien même la dictature militaire avait pris fin en Argentine en 1983 ». Elle ajoute que « de même, il importait peu que M. Mario Sandoval ait quitté l’Argentine pour la France en 1985 ; qu’il suffisait d’estimer plausible son implication dans la séquestration de M. Hernan Abriata qui avait commencé lors de sa conduite dans les locaux de l’Esma immédiatement après son enlèvement à son domicile le 30 octobre 1976 » et que « la fin de la séquestration de M. Hernan Abriata ne pouvait être fixée de manière arbitraire et théorique en 1983, époque à laquelle la dictature militaire avait cessé en Argentine ». Elle en conclut « qu’en raison de l’ignorance du sort réservé à M. Abriata, il demeurait porté disparu et que dans cette situation, la prescription de la séquestration dont il avait été victime n’avait pas commencé à courir, l’infraction n’ayant pas pris fin », et elle en déduit que les faits querellés « n’étaient pas atteints par la prescription ».
Se voyant ainsi offrir la possibilité de revenir à une appréciation de la temporalité des infractions sous-jacentes au crime de disparition forcée davantage conforme à la réalité de ce dernier et aux objectifs de la Convention de 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation approuve la chambre de l’instruction et constate que « dès lors que la prescription des infractions continues ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets, et que ce point de départ, en l’état de la procédure, ne peut être déterminé, la chambre de l’instruction a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale »44. Ce faisant ; la chambre criminelle revient à sa jurisprudence traditionnelle en matière de prescription des infractions continues45. A. Gogorza souligne avec pertinence que « la solution satisfait, compte tenu de la nature des faits examinés. Ces derniers ne relèvent pas de la simple séquestration mais d’une figure plus complexe de disparition forcée […], laquelle se consomme non seulement par une privation de liberté mais également par le ‘déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue’ »46. En d’autres termes, dès lors que la dissimulation des suites de l’arrestation est un élément constitutif de la disparition forcée, ce que consacre implicitement en l’espèce la Haute juridiction pénale, l’activité délinquante ne cesse que par la révélation du sort de la victime, qui seule peut mettre un terme à la consommation et aux effets de l’infraction, lesquels, en la matière, se confondent.
En outre, si la chambre criminelle n’admet pas que la qualification de crimes contre l’humanité soit appliquée à des faits perpétrés avant le 1er mars 1994, elle avait précédemment admis, en matière d’extradition, que des faits qualifiés de crimes contre l’humanité par l’Etat requérant puissent recevoir une qualification de crimes de droit commun en droit pénal français, l’appréciation de l’éventuelle acquisition de la prescription ne s’opérant dès lors que par référence aux dispositions du code de procédure pénale national. Ainsi, dans l’arrêt précité du 12 juillet 201647, à propos d’une demande d’extradition requise par la Bosnie-Herzégovine pour des « crimes contre l’humanité » perpétrés les 13 et 14 juin 1992, la Haute juridiction relève qu’une enquête à été ouverte par le parquet territorialement compétent le 5 juin 2002 et que des actes d’investigation ont été menés jusqu’en 2013 et approuve, en conséquence, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris d’avoir considéré que « les crimes reprochés à M. X…, punissables dans la législation nationale au travers des infractions de droit commun prévues tant par le code pénal applicable au moment des faits que par le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, en particulier le crime d’assassinat, ne sont pas couverts par la prescription de l’action publique et qu’ainsi, celle-ci a été régulièrement interrompue par des actes de poursuite, tant au regard des lois de l’Etat requérant que de la France, Etat requis, tenu en l’espèce par la seule prescription des crimes de droit commun, et que moins de dix ans se sont écoulés entre la date de la commission des faits et chacun des actes interruptifs subséquents, jusqu’à ce jour ».
De surcroît, cette interprétation s’inscrit dans les pas du législateur qui, par la loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, a manifesté son hostilité à l’impunité des auteurs de crimes en allongeant substantiellement le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle, mais aussi en consacrant les jurisprudences repoussant le point de départ de la prescription48.
Enfin, elle a été récemment approuvée par le Conseil constitutionnel49. Les Sages ont été saisis par le Conseil d’Etat50 d’une question prioritaire de constitutionnalité déposée par les avocats de M. Sandoval, portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 7 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n°2006-399, relative à la prescription de l’action publique en matière criminelle, directement dirigée contre l’interprétation, consacrée par la Cour de cassation dans l’arrêt ici commenté, des règles qui régissent la prescription de l’action publique en matière d’infraction continue. M. Sandoval contestait particulièrement l’interprétation de cette disposition par la Cour de cassation, estimant qu’en décidant que « le délai de prescription de l’action publique pour les infractions continues ne commence à courir qu’à compter du jour où elles ont cessé », le juge pénal rendait ces infractions imprescriptibles « lorsque la partie poursuivie a échoué à démontrer qu’elle n’a pas été commise ou qu’elle a pris fin ». Il invoquait, en premier lieu, une méconnaissance d’un « principe fondamental reconnu par les lois de la République », qu’il demandait au Conseil de consacrer, qui imposerait « au législateur de prévoir un délai de prescription de l’action publique pour les infractions ‘dont la nature n’est pas d’être imprescriptible’ »; en deuxième lieu, une atteinte « au principe d’égalité devant la loi » en ce que la jurisprudence contestée instituerait « une différence de traitement inconstitutionnelle entre les règles de prescription applicables aux infractions instantanées et celles applicables aux infractions continues ‘dont le terme ne peut être fixé avec certitude’ » ; en troisième lieu, une violation « des exigences de nécessité et de proportionnalité des peines » en conséquence de l’imprescriptibilité d’origine prétorienne dont il alléguait; en quatrième lieu, une atteinte à la présomption d’innocence consistant dans le renversement de la charge de la preuve imposant à la personne poursuivie de démontrer que l’infraction a pris fin pour pouvoir bénéficier de la prescription de l’action publique; en cinquième lieu, une atteinte aux droits de la défense « dans la mesure où la personne poursuivie ne pourrait plus, à l’issue d’un certain délai, disposer des preuves nécessaires à sa défense » ; enfin, que la jurisprudence querellée « contreviendrait au principe de sécurité juridique ».
Le Conseil constitutionnel a commencé par écarter l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, constatant qu’au moins deux textes, adoptés avant 1946, écartaient la prescription de l’action publique. La démonstration n’est pas entièrement convaincante. Les deux textes évoqués par le Conseil constitutionnel51 sont des textes de droit pénal militaire. Sans aller jusqu’à l’appréciation prêtée à Clemenceau sur la justice militaire, la représentation nationale elle-même a reconnu que les fondements du droit pénal militaire ne sont pas identiques à ceux du droit pénal civil52. De même, le contexte dans lequel ils ont été adoptés, à la veille de la seconde guerre mondiale, aurait pu suffire à justifier leur caractère exceptionnel. Reste que cette interprétation sert les partisans de l’extradition de M. Sandoval.
En revanche, le Conseil constitutionnel a déduit des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, consacrant respectivement le principe de nécessité des peines et de la garantie des droits, « un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions ». Il n’en a pas moins approuvé le report du point de départ de la prescription de l’action publique en matière d’infractions continues « au jour où l’infraction a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets », estimant qu’« en prévoyant que ces infractions ne peuvent commencer à se prescrire tant qu’elles sont en train de se commettre, les dispositions contestées fixent des règles qui ne sont pas manifestement inadaptées à la nature de ces infractions ». Rapportée au crime de disparition forcée, cette interprétation préserve, en outre, la cohérence de la jurisprudence du Conseil puisque, dans leur décision n°98-408 DC du 22 janvier 1999, les Sages avaient jugé « qu’aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n’interdit l’imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté́ internationale ». Enfin, le Conseil a contesté l’impossibilité alléguée pour la personne poursuivie de démontrer qu’une infraction continue a pris fin en relevant que « le juge pénal [apprécie] souverainement les éléments qui lui sont soumis afin de déterminer la date à laquelle l’infraction a cessé »53.
D’apparence solide et convaincante, la solution adoptée par la chambre criminelle n’échappe cependant pas totalement à la critique lorsqu’elle est confrontée au crime de disparition forcée.
B. Une solution insuffisante au regard du droit international pénal
En approuvant l’interprétation proposée par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, la chambre criminelle semble avoir mis un terme aux errements de sa jurisprudence qui l’avaient conduite, par l’arrêt du 15 février 2018, à priver potentiellement de tout effet juridique l’incrimination des disparitions forcées. Pourtant, une analyse plus approfondie conduit à constater que le refus d’appliquer la qualification de crimes contre l’humanité aux faits reprochés à M. Sandoval laisse ouverte la possibilité pour ce dernier d’échapper à son extradition et n’exclut pas que, dans d’autres affaires, l’analyse adoptée en 2015 puisse à nouveau prospérer, voire – et cela est plus critiquable encore – que les dispositions du code pénal afférentes à la prescription du crime de disparition forcée ne fassent obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, y compris en adoptant l’interprétation consacrée par la Cour de cassation le 24 mai 2018.
Pour le démontrer, il faut d’abord rappeler que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2006 prévoit, en son article 8, que « sans préjudice de l’article 5, 1. Tout État partie qui applique un régime de prescription à la disparition forcée prend les mesures nécessaires pour que le délai de prescription de l’action pénale : a ) Soit de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de ce crime ; b ) Commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu. 2. Tout État partie garantit le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription » et, en son article 13, que « 6. L’extradition est, dans tous les cas, subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l’État partie requis peut refuser l’extradition ou l’assujettir à certaines conditions »54.
Précisément, le droit pénal français est au nombre de ceux qui prévoient un régime de prescription en matière de disparition forcée. Reprenant les termes de l’article 221-18 du code pénal, l’article 7 du code de procédure pénale dispose, en son deuxième alinéa, que « l’action publique des crimes mentionnés aux articles […] et 221-12 du code pénal […] se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ». La loi n°2017-242 n’a pas modifié ces dispositions55.
Or, ces dernières sont inquiétantes en ce qu’elles ne prennent pas en compte le caractère continu de l’infraction de disparition forcée – contrairement à ce qu’exige l’article 8.1, b) de la Convention de 2006 -, mais fixent le début de l’écoulement du délai de prescription de l’action publique « à compter du jour où l’infraction a été commise ». De manière regrettable, l’avancée que constitue l’arrêt du 24 mai 2018 en matière de répression des crimes de disparition forcée pourrait ainsi être anéantie à l’avenir pour la poursuite des crimes perpétrés après 2013, qui seront poursuivis sur le fondement des articles 221-12 et suivants du code pénal.
En effet, les exceptions prévues par le code de procédure pénale semblent offrir peu d’alternative. Ainsi, l’article 9-1 dudit code prévoit, en ses alinéas deux et suivants, que, « par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». Cet article est donc doublement inopérant s’agissant du crime de disparition forcée, d’abord parce que les définitions de l’infraction occulte et de l’infraction dissimulée qu’il porte ne sont pas susceptibles de s’appliquer à cette infraction – la disparition forcée est connue de la victime et de ses proches et ce n’est pas l’infraction qui est dissimulée mais ses effets – et, ensuite, parce que le délai butoir de trente ans qu’il prévoit en matière criminelle court « à compter du jour où l’infraction a été commise », ce qui renvoie à l’obstacle précédemment signalé à propos des articles 221-18 du code pénal et 7 du code de procédure pénale. Ne restent donc que les possibilités offertes par les articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale, créés par la loi n°2017-242. Le premier énumère les actes interruptifs de prescription. Or, ceux-ci ne peuvent émaner que de la victime ou d’une autorité publique (officier de police judiciaire ou magistrat). S’agissant des crimes internationaux, il est regrettable que le législateur n’ait pas ajouté les actes des commissions ad hoc de type « vérité et réconciliation » comme la CONADEP. En effet, les travaux de ces institutions dites de « justice transitionnelle » sont parfois longs et, dès lors qu’ils ne constituent aucun des actes interruptifs ou suspensifs de prescription énumérés par la réforme de 2017, ils doivent – malgré leur utilité – être considérés en l’état comme affectant le délai de prescription utile à la coopération judiciaire en matière pénale. Certes, dès lors que la prescription de l’action publique en matière de disparition forcée est fixée à trente ans, il peut être considéré qu’il est satisfait, en l’espèce, aux exigences de l’article 8.1, a) de la Convention de 2006, d’autant – et l’affaire qui intéresse la présente étude le confirme – que l’histoire permet de considérer que la durée d’existence des régimes pratiquant la disparition forcée et le temps d’effacement des législations d’auto-protection que leurs agents s’octroient avant de quitter le pouvoir, dépasse rarement trente ans. Le second définit les obstacles à l’engagement de l’action publique qui permettent la suspension de la prescription. Au regard du sujet qui nous intéresse, c’est indéniablement la disposition la plus intéressante puisqu’il est disposé que « tout obstacle de droit, prévu par la loi, […] ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription ». Ainsi, devraient être considérées comme des obstacles de droit les lois d’amnistie ou de limitation de la responsabilité pénale adoptées, avant de quitter le pouvoir, par les autorités des régimes ayant eu recours aux disparitions forcées – par exemple, dans l’affaire Sandoval, la loi sur l’obéissance due – et comme un obstacle de fait toute la durée d’existence de ces régimes. La jurisprudence devra cependant confirmer cette analyse.
Par ailleurs, la solution adoptée par l’arrêt du 24 mai 2018 ne garantit pas que M. Sandoval pourra être extradé.
Pour l’expliquer, il faut revenir sur la décision du Conseil constitutionnel du 24 mai 2019, qui a confirmé la conformité à la Constitution de l’interprétation des règles qui régissent la prescription des infractions continues, telles qu’elles résultent de la jurisprudence et, plus particulièrement, de l’arrêt de la chambre criminelle du 24 mai 2018. Au nombre des griefs avancés, M. Sandoval arguait d’une atteinte à la présomption d’innocence consistant dans le renversement de la charge de la preuve qui résulterait de l’obligation faite à la personne poursuivie de démontrer que l’infraction a pris fin pour pouvoir bénéficier de la prescription de l’action publique. Il peut immédiatement être relevé qu’en l’occurrence, la difficulté consistait plus précisément dans une éventuelle atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais peut-être la jurisprudence récente du Conseil en cette matière a-t-elle dissuadé M. Sandoval d’invoquer spécifiquement ce droit56.
Le Conseil répond que « contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces dispositions une impossibilité pour une personne poursuivie pour une infraction continue de démontrer que cette infraction a pris fin, le juge pénal appréciant souverainement les éléments qui lui sont soumis afin de déterminer la date à laquelle l’infraction a cessé »57. Le commentaire officiel de cette décision précise qu’« il ne pouvait être fait droit à ce grief dès lors qu’en réalité il ne résultait pas de la jurisprudence contestée une telle impossibilité́. En effet, lorsqu’une juridiction de jugement doit se prononcer sur des poursuites diligentées pour une infraction continue, il lui appartient d’apprécier si cette infraction est prescrite ou non et, pour ce faire, de déterminer souverainement à quel moment elle estime que l’infraction a cessé́. À cet égard, il ne pouvait être déduit de la décision de la Cour de cassation à l’occasion de laquelle la QPC avait été́ soulevée, décision statuant dans le cadre d’une procédure d’extradition et non dans le cadre d’un jugement au fond des faits contestés, ni qu’il appartient à̀ un accusé de prouver que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, ni qu’une telle preuve est impossible s’agissant d’une infraction continue, y compris dans le cas du crime de séquestration ».
Et c’est à ce titre que le bât blesse. Car l’exception qu’édicte le Conseil constitutionnel est précisément celle qu’avait mise en œuvre la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’arrêt du 18 février 2015. Le conseil de M. Sandoval a affirmé devant les Sages: « On présume qu’il est coupable » en exigeant de lui « une preuve impossible à rapporter »58. Ce n’est que partiellement vrai. En effet, les pratiques de la dictature argentine, telles que dévoilées dans le rapport de la CONADEP, autorisent à penser qu’après sa mort à l’ESMA, le corps d’Abriata a été jeté dans le Rio de la Plata. Il est donc probablement impossible de le retrouver. Imaginons, néanmoins, que M. Sandoval reconnaisse ces faits. Par application du principe de l’intime conviction des magistrats, une juridiction pénale pourrait tout à fait estimer qu’il a apporté ainsi une preuve suffisante de la cessation de la disparition forcée et requalifier en conséquence les faits en meurtre aggravé – infraction pour laquelle la prescription de l’action publique serait acquise au regard du droit pénal français, ce qui ne pourrait être légalement remis en cause59, et ferait obstacle à l’extradition.
Ainsi, en l’état actuel du droit français, issu des textes et de la jurisprudence, il subsiste potentiellement une contradiction dans la capacité de l’autorité judiciaire nationale à satisfaire les objectifs de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2006, tels qu’ils sont énumérés dans le préambule. En effet, si M. Sandoval avoue, les victimes pourront, certes, « savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et […] connaître le sort de la personne disparue » ; en revanche, il risque de n’être pas possible de « lutter contre l’impunité du crime de disparition forcée ». Le seul moyen d’échapper à cet écueil est que le législateur ou le juge consacrent enfin le caractère de crimes contre l’humanité, à ce titre imprescriptibles, des disparitions forcées et qu’ils fassent, comme le suggère une partie de la doctrin60, rétroagir cette qualification en constatant, comme les autorités argentines, le caractère déclaratoire de l’intégration en droit national des crimes « qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ».
- Art. 696-4, 1°, du code de procédure pénale; Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-427 QPC du 14 novembre 2014, M. Mario S. [Extradition des personnes ayant acquis la nationalité française], cons. 6, sur renvoi de Cass crim. 3 septembre 2014, n°14-84193, inédit.
- Devenue, ensuite, la Superintendencia de Seguridad Fedral.
- L. Mazure, « Imprudences et connivences », Le Monde diplomatique, mai 2007, pp.8-9. Dans cet article consacré à la compromission du régime colombien avec les paramilitaires, l’auteure écrivait: « Scandale majeur, la ‘parapolitique’ […] pose la question des soutiens internationaux dont ont bénéficié les paramilitaires. Y compris dans le cas de la France. Plusieurs personnalités colombiennes compromises, dont le sénateur Miguel de la Espriella et M. Carlos Ordosgoitia, haut fonctionnaire et directeur de l’Institut national des concessions (INCO), organisme d’Etat, ont souligné la présence de ‘deux universitaires de la Sorbonne’ d’origine argentine agissant comme conseillers politiques des chefs des Autodéfenses unies de Colombie (AUC) Carlos Castaño et Salvatore Mancuso lors d’une réunion illégale et clandestine, à Ralito, en juillet 2001. Selon M. de la Espriella, les ‘universitaires’ ont ‘proposé la création d’un mouvement communautaire et politique qui, d’une certaine façon, défendrait les idées des Autodéfenses et mènerait à un processus de paix’. […]. Puis, ils ont exposé une stratégie dont le but était de convertir les Autodéfenses en “un acteur politique reconnu du conflit interne”, pour reprendre les termes de l’un d’entre eux’. En fait, la veille, lors d’une interview avec Radio Caracol, le même haut fonctionnaire se rappelait très bien le nom de l’un des deux intervenants : un certain Mario Sandoval, qui a été lié à l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (Iheal, Paris), à l’université de la Sorbonne nouvelle et à l’université de Marne-la-Vallée. Ses activités les plus récentes se déroulent dans les milieux dits de l’intelligence économique… ». Elle évoquait ensuite les activités de M. Sandoval au sein de la police politique de la junte argentine.
- P. Grenet, « Marathon judiciaire sur l’extradition du présumé tortionnaire argentin Mario Sandoval », Médiapart, Le blog de Pierre Grenet, 15 septembre 2017.
- La synthèse du rapport été publiée par la CONADEP, sous le titre Nunca Mas. Cf. aussi F. Genoux, « Extradition d’un ex-policier de la junte : ‘Mario Sandoval doit être jugé en Argentine’», Le Parisien, 24 mai 2019.
- Cf. E. Crenzel, « The National Commission on the Disappearance of Persons: Contributions to Transitional Justice », The International Journal of Transitional Justice, vol. 2, no2/2008, pp.182-183; M. Gérard, « Les ‘vols de la mort’ vont être jugés pour la première fois en Argentine », Le Monde, 28 novembre 2012.
- Des témoignages, recueillis par la CONADEP, impliquent nommément M. Sandoval dans l’enlèvement d’Hernan Abriata (cf. P. Grenet, précité).
- Art. 224-1 et seq. du code pénal.
- V. notre commentaire, « La loi impose-t-elle de « Laisse(r) les morts ensevelir les morts »? – A propos de Crim. 18 février 2015, Sandoval, n°14-84193 », Droits fondamentaux, n°14, 2016, http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr.
- M. Rubetti, « La justice française favorable à l’extradition de Mario Sandoval vers l’Argentine », Le Figaro, 19/10/2017.
- P. Grenet, op. cit.
- A. Montoya, « La Cour de cassation confirme l’extradition vers l’Argentine d’un tortionnaire présumé », Le Monde, 24 mai 2018 ; A. Bariéty, « La Cour de cassation autorise l’extradition de Mario Sandoval vers l’Argentine », Le Figaro, 24/05/2018; cf. infra.
- « Dictature argentine : la France autorise l’extradition de l’ex-policier Mario Sandoval », Le Monde avec AFP, 24 octobre 2018 ; « Dictature argentine: la France autorise l’extradition de Sandoval », Le figaro.fr avec AFP, 24/10/2018.
- A. Montoya, « Le Conseil constitutionnel ouvre la voie à l’extradition de l’Argentin Mario Sandoval, accusé de crimes contre l’humanité », Le Monde, 24 mai 2019.
- Cass. crim. 24 mai 2018, n°17-86340, publié au bulletin.
- Crim. 18 février 2015, Sandoval, n°14-84193.
- Cf. notre art., précité.
- Cf., sur ce point, notre commentaire précité.
- Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2716,p. 3; Doc.A/61/448. La Convention a été ouverte à signature le 6 février 2007, à Paris, et est entrée en vigueur le 23 décembre 2010, après les vingt premières ratifications dont celles de l’Argentine et de la France.
- Cass. crim. 24 janvier 2018, n°17-86340, inédit.
- Art. 696-16 CPP; Crim. 9 avril 2014, Bull. crim. n°110; D. Rebut, Droit pénal international, 2è éd., Dalloz, coll. Précis, 2014, pp.198-199.
- Notons la faiblesse de l’argument, qui – même si la défense prend la peine de préciser « les faits, à les supposer établis » – ne peut qu’affecter l’impression suscitée par la défense. En effet, l’article 122-4 du code pénal, pris en son alinéa 2, dispose: « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal », qualificatif qui s’applique au crime de disparition forcée. De surcroît, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré conforme à l’article 7 de la Convention les condamnations pour des faits manifestement criminels alors qu’ils étaient justifiés au regard de la loi en vigueur au moment de leur commission (CEDH, GC, 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne n°35532/97, 34044/96 et 44801/98 ; CEDH, 17 mai 2010, Kononov c. Lettonie, n°36376/04, RSC 2010. 696, obs. D. Roets). Pour mémoire, l’article 6.2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2006 dispose: « Aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée ».
- L’argument est peu sérieux, le crime d’enlèvement suivi de séquestration et, a fortiori, celui de disparition forcée, n’impliquant pas l’unicité d’auteur ni n’exigeant pour se constituer que l’auteur de l’enlèvement soit aussi le geôlier, dès lors que la jurisprudence considère les deux faits comme distincts (Crim. 21 février 1979, Bull. crim. n°80).
- L’argument peut légitimement surprendre, la France étant liée par un traité d’extradition avec de nombreux Etats, signataires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, dont l’indépendance et l’impartialité de la magistrature sont insuffisamment établies.
- Crim. 18 février 2015, précit.
- Notre commentaire, précité.
- La « privation illégale de liberté aggravée, prévue et réprimée par les articles 144 bis, premier paragraphe, et 142 du code pénal argentin alors en vigueur (soit celui résultant en particulier de la loi de 1958), d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement ainsi que de celle de tortures, prévue et réprimée par l’article 144 ter, alinéas lier et 2, de ce même code, d’une peine de trois a quinze ans d’emprisonnement ».
- La « privation illégale de liberté aggravée, prévue et réprimée par les articles 144 bis, premier paragraphe, et 142, alinéas lier et 5ème code pénal argentin (tel que modifié notamment par la loi 23. 077 de 1984), d’une peine (toujours) de deux à six ans d’emprisonnement ainsi que de celle de tortures, prévue et réprimée par l’article 144 ter, alinéas lier et 3, de ce même code, d’une peine (désormais) de huit a vingt-cinq ans d’emprisonnement ».
- Art. 211-1 et seq. du code pénal.
- V. Malabat, Droit pénal spécial, 8è éd., Dalloz, coll. Hypercours,, p.7 et seq.; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial. Infractions du code pénal, 8è éd., Dalloz, coll. Précis, 2018, p. 809 et seq.
- Crim. 17 juin 2003, Bull. crim. n°122.
- Crim. 26 février 2014, Bull. crim. n°59 et 60 – D. 2014. 702 obs. D. Roets confirmé par Crim. 5 octobre 2016, n°16-84717.
- Sur tous ces points, cf. D. Rebut, op. cit., pp.166-167 ; cf. aussi O. Beauvallet (dir.), Chronique « Un an de droit pénal international », Droit pénal, 2/2019, p.13.
- Crim. 12 juillet 2016, n°16-82664, inédit.
- CE, 18 juin 2018, n°415046, Susjnar.
- Cons. 4.
- S. Roussel et C. Nicolas, « De l’extradition pour crime contre l’humanité. Note sous CE, 18 juin 2018, Susjnar », AJDA, 2018, pp.1446.
- Pour une mise en pratique de ce raisonnement « Chili : cinq ex-agents condamnés pour la disparition d’un Français sous la dictature », Le Monde avec AFP Publié le 09 août 2014. Il n’en reste pas moins que la notion de « crime autonome » est au cœur de la Convention de 2006. Le Comité des disparitions forcées insiste à chaque occasion sur l’importance d’une incrimination spécifique, comme dans ses observations finales sur le rapport de la France qui ont été adoptées en avril 2013, CED/C/FRA/CO/1.
- Ainsi, par exemple, le Traité d’extradition entre la République française et la République argentine, signé à Paris le 26 juillet 2011, s’il prévoit, en son article 2, que « donnent lieu à extradition les faits considérés comme une infraction par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise, quelle que soit leur qualification juridique, et punis par la législation des deux Parties d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins deux ans » ajoute, en son article 16, que « la personne extradée en vertu du présent Traité ne peut être ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de la Partie requérante pour d’autres infractions antérieures à la date de la remise effective, non mentionnées dans la demande d’extradition […]. Lorsque la qualification légale des faits pour lesquels une personne est extradée est modifiée, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l’infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux pour lesquels l’extradition a été accordée et peut donner lieu à extradition dans les conditions du présent Traité ».
- C. Berlaud, « Les crimes imprescriptibles le sont plus encore lorsqu’il n’est pas prouvé qu’ils ont pris fin (comm. Crim. 24 mai 2018) », Gaz. Pal. n°24/2018, pp.2192-2193.
- L. Joinet, dans le cadre de la Sous-Commission des droits de l’homme puis comme rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, a été le rédacteur du premier projet de Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et l’un des principaux artisans de son adoption (cf. O. de Frouville, « La Convention des Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées: les enjeux juridiques d’une négociation exemplaire – Première partie: les dispositions substantielles », Droits fondamentaux, 2006).
- L. Joinet, « Faut-il extrader Sandoval vers l’Argentine ? », Libération, 17 février 2015.
- D. Rebut, op. cit., p.180.
- O. Beauvallet (dir.), Chronique « Un an de droit pénal international », Droit pénal, 2/2019, p.13
- Crim., 19 février 1957, Bull. crim. n°166.
- A. Gogorza, « Affaire ‘Sandoval’ : vers une extradition de l’ex-policier argentin ? », D. 2018. 1480.
- Crim. 12 juillet 2016, n°16-82664, inédit.
- Circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale NOR : JUSD1706599C, BOMJ n°2017-03 du 31 mars 2017 – JUSD1706599C.
- Décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019 M. Mario S. [Point de départ du délai de prescription de l’action publique en matière criminelle] Conformité, JORF n°0121 du 25 mai 2019, texte n° 126
- Conseil d’État, 28 février 2019, n°424993, Inédit au recueil Lebon.
- La loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l’armée de terre ; la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l’armée de mer.
- A. Voilquin, Avis n°322 présenté au nom de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées (1) sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale portant suppression des tribunaux permanents des forces armées en temps de paix et modifiant le Code de procédure pénale et le Code de justice militaire, Sénat, 7 mai 1982 : « il faut se souvenir que, le 11 juin 1903, le même Clemenceau déclarait à la Chambre des députés : ‘Il faut nous rendre à cette évidence qu’il y a une société́ civile fondée sur la liberté́ et une société́ militaire fondée sur l’obéissance. Tant que nous aurons une armée, c’est un sacrifice auquel il faudra nous résigner que d’avoir des tribunaux spéciaux pour juger des délits et des crimes qui sont vraiment spéciaux’ » et « Avec le magistrat gé́néral Gardon, qui avait été́ l’un des pères du Code de 1965, nous estimons qu’il existe un ordre public militaire, fondamentalement différent de l’ordre public tout court ; celui-ci a pour base la liberté́ de chacun, celui-là, l’obéissance hiérarchique’ (Communication à l’assemblé́e générale de l’association « Libre justice », 10 février 1962) ».
- Cons. 7 et 8.
- Pour mémoire, l’article 5 du traité d’extradition entre la République française et la République argentine dispose que « l’extradition n’est pas accordée si l’action pénale ou la peine est prescrite d’après la législation de la Partie requise ».
- Circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale NOR : JUSD1706599C, BOMJ n°2017-03 du 31 mars 2017 – JUSD1706599C, Tableaux récapitulatifs des délais de prescription de l’action publique.
- CConst., déc. n°2018-696 QPC du 30 mars 2018, M. Malek B. [Pénalisation du refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie].
- Précit., cons. 9.
- Cité par A. Montoya, « Le Conseil constitutionnel ouvre la voie à l’extradition de l’Argentin Mario Sandoval, accusé de crimes contre l’humanité », Le Monde, 24 mai 2019.
- Crim., 8 février 1994, n° 92-86333.
- D. Roets, 2014, op. cit. ; S. Roussel et C. Nicolas, op. cit. et notre article, précité, II. B.
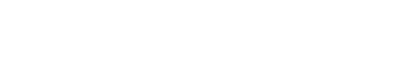

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
