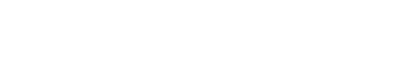La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.
Dans cette affaire, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes confirme, s’il en était besoin, la permanence du principe selon lequel la privation de liberté n’entraîne pas la privation de la jouissance des droits humains, y compris au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Si la conventionnalisation, opérée par référence directe aux différentes règles internationales en matière de détention, renforce prima facie la cohérence du droit international des droits humains, elle implique toutefois une revalorisation du fondement « biologique » dans l’appareil conceptuel de la lutte contre les discriminations faites aux femmes, potentiellement préjudiciable.
De prime abord, il n’apparaît pas surprenant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après le « Comité ») constate dans cette affaire relative aux conditions de détention administrative de deux femmes des violations par le Bélarus de ses obligations au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (ci-après la « Convention »).
En effet, les deux auteures de la communication dénoncent plusieurs traitements dont elles ont été l’objet dans divers lieux de détention (§§ 2.3 et 2.4) : difficultés à maintenir leur hygiène corporelle (absence d’eau chaude, pas d’accès à des produits d’hygiène menstruelle (§ 2.3), restrictions d’accès aux douches (§ 5.7)…) ; surveillance uniquement ou principalement par des hommes (voir également § 5.6), sans intimité, notamment lors de la toilette (caméras dans les cellules, disposition des sanitaires, voir également § 5.8) ; diverses tentatives d’humiliation et de dégradation, notamment lors des fouilles corporelles (§ 2.5). Ces conditions, en tant que traitements humiliants et dégradants (§ 2.5), auraient notamment mis en danger leur santé (par ex. une cystite non prise en charge, § 2.5). En outre, à l’occasion des différents recours internes administratifs et judiciaires intentés par les autrices (§§ 2.7 et 2.8), celles-ci n’ont pas été en mesure de prendre connaissance des enquêtes qui avaient été effectuées (§§ 2.8 et 5.4).
En interprétant la Convention à la lumière des standards internationaux en matière de conditions de détention – l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution no 70/175 du 17 décembre 2015, U.N. doc. A/RES/70/175, ci-après les « Règles Nelson Mandela ») et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution no 65/229 du 21 décembre 2010, U.N. doc. A/RES/65/229, ci-après les « Règles de Bangkok ») -, le Comité conclut que le Bélarus a violé les obligations découlant des articles 1er – définissant la discrimination à l’égard des femme -, 2 – sur l’obligation pour l’État de condamner cette discrimination -, 3 – l’obligation d’adopter des mesures visant l’égalité entre les femmes et les hommes -, 5 al. a – sur l’obligation de modifier les schémas et modèles socio-culturels ainsi que les pratiques fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe – et 12 – relatif à la santé (§ 7.8).
Pour ce faire, le Comité entreprend d’abord de « conventionnaliser » les engagements étatiques découlant des instruments relatifs aux conditions de détention en qualifiant « le fait que les centres de détention ne répondent pas aux besoins particuliers des femmes » comme une discrimination au titre de l’article 1er de la Convention (§ 7.5). De même, le Comité reprend à son compte le rattachement effectué par le Principe 5 § 2 des Règles Nelson Mandela et le Commentaire des Règles de Bangkok (Règles de Bangkok, précitées, p. 25) avec l’article 4 § 2 de la Convention (§ 7.5). Ce paragraphe précise que des mesures spéciales, « qui visent à protéger la maternité » de manière permanente, ne peuvent pas être considérées comme discriminatoires (voir CEDAW, Premier paragraphe de l’article 4 de la Convention (Mesures temporaires spéciales), Recommandation générale no 25, U.N. doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 2004, § 16). Autrement dit, non seulement les États peuvent adopter des mesures spéciales permanentes au motif de la protection de la maternité dans le contexte carcéral, mais ils le doivent, dès lors que la non-adaptation des conditions d’incarcération peut être constitutive d’une discrimination.
Puis, au regard des faits de l’espèce, le Comité insiste particulièrement sur l’« importante garantie » (§ 7.6) posée par la Règle 81 des Règles Nelson Mandela, selon laquelle : « 1. Dans une prison mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d’un membre du personnel de sexe féminin […] 2. Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section réservée aux femmes sans être accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin. 3. Seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la surveillance des détenues. […] » ([notre accentuation]). Par conséquent, la Biélorussie doit organiser, de manière permanente, la séparation des hommes et des femmes en prison, notamment en s’assurant que « les fouilles et la surveillance dont elles font l’objet soient assurées par du personnel de sexe féminin » (§ 8 al. b.iv).
Ainsi, le Comité pallie l’absence expresse de garantie de conditions de détention dignes dans le texte de la Convention. En effet, au moment de son élaboration, ce sujet a pu échapper aux rédacteurs ou être écarté par eux : l’impensé des femmes auteures de crimes, nourri par le constat empirique du peu de femmes incarcérées (malgré des augmentations, voir Règles de Bangkok, précitées, § 1) ou encore la séparation symbolique des lieux d’incarcération de la « société » au sens large, induisant une attention moindre au sort des prisonniers… Ce faisant, il reprend expressis verbis les terminologies, les dispositifs et les références des Règles Nelson Mandela et des Règles de Bangkok, y compris, le rattachement qu’elles opèrent à l’article 4 § 2 de la Convention, contribuant ainsi, prima facie, à la cohérence normative du droit international des droits humains (ci-après le « DIDH ») en la matière.
Toutefois, cette stratégie jurisprudentielle soulève plusieurs interrogations.
Sur le plan conceptuel, l’article 4 § 2 donne aux États parties la possibilité d’adopter des mesures spéciales permanentes pour protéger la maternité, terme indéfini dans le texte conventionnel. Le Comité interprète cet article comme reposant sur « [les] différences biologiques [entre les hommes et les femmes] » (CEDAW, Recommandation générale no 25, précitée, § 16 [notre accentuation]) – ce qui expliquerait leur caractère permanent. Dès lors, à l’instar des États réunis à l’Assemblée générale des Nations Unies, le Comité reprend leur lecture « biologisante/sexuée immuable » du fondement de ces deux corps de Règles. En effet, les Règles de Bangkok emploient les termes de « female offenders » en anglais, tandis que, dans les Règles Nelson Mandela, la Règle 81 précitée parle de « sexe féminin », corroborant ainsi la Règle 11 (spéc. a.), qui recommande une séparation des catégories de détenus fondée sur le sexe (terme utilisé en anglais également, voir contra la Règle 7 qui parle du respect dû à « l’identité de genre (gender) » dans la version anglaise, traduit par « sentiment d’appartenance à un sexe » dans la version française). Par conséquent, le Comité avalise implicitement l’équation suivante : « maternité = sexe féminin (ou femelle ?) = femme ». Autrement formulé, la protection spéciale en matière de détention est accordée aux détenues sur le fondement du « sexe biologique », attesté en raison du jeu de l’article 4 § 2 à travers le concept de maternité, compris comme la capacité (réelle ou supposée) à procréer de manière « femelle ».
Cette interprétation biologisante n’est pas étonnante. Elle résulte de la convergence de deux faits. D’abord, la Convention a été élaborée dans un contexte où les questions d’identité de genre étaient balbutiantes en droit international et appréciées à l’aune des seules catégories de « sexe » binaires « femmes » et « hommes », rigidement comprises et impensées (voir AGNU, Rapport de l’Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Pratiques d’exclusion, U.N. doc. A/76/152, 2021, spéc. §§ 13 et 14, où l’Expert indépendant souligne que « l’idée reçue » selon laquelle « la nature humaine devrait être classée, en fonction du sexe attribué à la naissance, selon un système binaire masculin/féminin » continue d’influencer les normes et l’interprétation du DIDH). Aussi, l’article 1er de la Convention définit-il la discrimination à l’égard des femmes comme étant fondée sur le sexe, sans préciser ce que cela recouvre. Ensuite, les deux corps de règles relatives aux conditions de détention sont adoptées par un organe intergouvernemental – l’Assemblée générale des Nations Unies -, au sein duquel la reconnaissance des enjeux et des droits en matière d’identité et de diversité de genre ainsi que d’intersexuation reste, encore aujourd’hui, limitée (voir V. Bellami et M. Petkova, « Contribuer au ‘forum global’ de protection des droits humains pour garantir les droits des MISSEG en France », in B. Moron-Puech & T. Saito (dir.), Droits humains des minorités sexuées, sexuelles et genrées – Regards franco-japonais, Paris, Société de Législation Comparée, 2024, spéc. p. 142), quand elle n’est pas « incohérente » (voir supra les problèmes terminologiques dans les différentes versions de la Règle 7 des Règles Nelson Mandela précitées). Toutefois, cette protection relative aux conditions de détention doit-elle seulement trouver sa raison d’être dans « la protection de la maternité », de surcroît quand la maternité est ainsi définie de manière étroite ?
Deuxièmement, quand bien même d’aucuns adhéreraient à ce fondement, la notion de « sexe biologique » et les moyens hypothétiques de sa preuve, sont eux-mêmes controversés dans les sciences et, par ricochet, dans l’ordre juridique, quand celui-ci entend s’y référer pour formuler des normes (ainsi que l’article 11 § 3 de la Convention et le § 16 de la Recommandation générale n° 25 précitée y invitent). Les affaires relatives à la détermination de la catégorie « féminine » dans les compétitions sportives en témoignent (par ex. CEDH, arrêt du 11 juillet 2023, Semenya c. Suisse req. no 10934/21).
Sur le plan de la cohérence du DIDH, premièrement, la « (re)biologisation » de la maternité paraît contradictoire avec le mouvement de sa reconnaissance comme « un fait social ». En témoigne, notamment, la récente jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, laquelle prend en compte les conséquences sociales des « grossesses forcées » (voir par ex. CCPR, Norma c. Équateur, constatations du 31 octobre 2024, communication no 3628/2019, U.N. doc. CCPR/C/142/D/3628/2019 ; voir également l’article 5 al. b. de la Convention par lequel « l’éducation familiale [doit faire comprendre] que la maternité est une fonction sociale »). De même, la revalorisation sous-jacente de « l’immutabilité et de l’essentialisation biologique », elles-mêmes contestables, de la notion de « femme », s’inscrit en faux vis-à-vis de la reconnaissance progressive, y compris par des organes intergouvernementaux comme le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, des droits en matière d’identité de genre (voir par ex. Conseil des droits de l’homme, Droits de l’homme, orientation sexuelle et identité de genre, Résolution no 17/19, U.N. doc. A/HRC/RES/17/19, 2011 ; Conseil des droits de l’homme, Droits de l’homme, orientation sexuelle et identité de genre, Résolution no 27/32, U.N. doc. A/HRC/RES/27/32, 2014 ; et Conseil des droits de l’homme, Protection contre la violence et la discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, Résolution no 32/2, U.N. doc. A/HRC/RES/32/2, 2016) et, plus récemment, d’intersexuation (voir Conseil des droits de l’homme, Lutte contre la discrimination, la violence et les pratiques préjudiciables à l’égard des personnes intersexes, Résolution no 55/14, U.N. doc., doc. A/HRC/RES/55/14, 2024).
Sur le plan de la cohérence interne de la pratique du Comité, la revalorisation d’une lecture « biologique sexuée binaire » de la protection contre la violence faite aux femmes paraît contradictoire. D’une part, celui-ci n’hésite pas à critiquer les constructions sociales stéréotypées des rôles de genre, notamment la perception des femmes comme « reproductrices » (voir CEDAW, María Elena Carbajal et autres c. Pérou, constatations du 4 octobre 2024, communication no 170/2021, doc. CEDAW/C/89/D/170/2021, et à cet égard V. Bellami, notre Chronique, no 23, 2026, pp. 54-58), contestant ainsi le primat du « déterminisme biologique » (Rapport de l’Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Pratiques d’exclusion, précité, § 16). D’autre part, le Comité admet une application ratione personae de la Convention inclusive de « toutes les femmes », y compris les femmes transgenres et les personnes intersexes, notamment dans ses recommandations générales (par ex. CEDAW, Les droits des femmes et des filles autochtones, Recommandation générale no 39, U.N. doc. CEDAW/C/GC/39, 2022, §§ 23 al. a. et 52 al. a.).
Or, précisément, sur le plan pragmatique, la mobilisation d’une approche « biologisante » et donc, in fine d’une définition « sexuée/biologique » de la catégorie « femme », pose des difficultés très concrètes (voir Rapport de l’Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Pratiques d’exclusion, précité, spéc. § 15), alors que se développent des législations internes se départant d’une conception « immuable » (la possibilité de modifier son état civil en attestant) – voire binaire (l’adjonction de la mention « X » ou « neutre » ou la suppression des catégories genre/sexe en témoignant) – du « sexe/genre » et reconnaissant l’autodétermination de genre des personnes comme un droit ; conformément aux évolutions du droit international des droits humains en la matière. Par exemple, s’agissant de la mise en œuvre de la Règle 81 des Règles Nelson Mandela, du côté des détenues et détenus, dans quels « quartiers » les personnes transgenres ou intersexes doivent-elles être incarcérées ? Du côté des gardiennes et gardiens de prison, dans quels « quartiers » ces personnes peuvent-elles travailler ?
Pour l’instant, il semble que les réponses à ces questions soient surtout recherchées sur le plan national (voir en ce sens, Ministère de la Justice, Direction de l’administration pénitentiaire, Référentiel national de prise en charge des personnes LGBT+ placées sous main de justice, 2024, spéc. pp. 9-12 : la séparation et le placement des personnes se font selon la mention de sexe à l’état civil, recommandant notamment un encellulement individuel ou « dans un quartier dédié à la prise en charge des personnes vulnérables en raison de leur identité de genre » ou un quartier d’isolement « en dernier recours »).
Sur le plan stratégique enfin, une potentielle « instrumentalisation » de ces constatations, visant à antagoniser, d’un côté, les « droits des femmes ‘biologiques’ (ou femmes ‘cisgenres’) » et, de l’autre, les droits des personnes LGBTQIA+, au mépris des principes d’indivisibilité et d’interdépendance des droits humains est à craindre. En effet, en avalisant la « justification » et le « critère » « biologique » de la séparation des femmes et des hommes en prison, le Comité donne indirectement du crédit aux « thèses » selon lesquelles les hommes ainsi que, par extension, les femmes transgenres, représentent « biologiquement », « par nature », « par essence » un danger pour les femmes (Rapport de l’Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Pratiques d’exclusion, précité, § 47 al. d.). De même, cela renforce indirectement le stéréotype contraire, selon lequel, par « nature », les femmes seraient « vulnérables » et « non violentes » (par ex. H. Charleswoth, « Are Women Peaceful ? Reflections on the Role of Women in Peace-Building », Feministe legal Studies, vol. 16, 2008, pp. 347-361). Ces « arguments » fondent les revendications relatives à la « préservation » d’« espaces non mixtes en termes de sexe (single-sex spaces) » au sens biologique, s’agissant des vestiaires, de l’accès aux sanitaires ou, comme ici, des lieux de détention (voir Conseil des droits de l’homme, Visite au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Rapport de l’Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, U.N. doc. A/HRC/56/49/Add.1, 2024).
S’agissant de ces derniers, si l’objectif des deux corps de Règles vise la protection des personnes incarcérées contre les violences qu’elles pourraient subir, le placement d’une femme transgenre dans un quartier d’hommes « par nature violents » ne l’expose-t-elle pas non plus à ces risques ? Plus avant, la surveillance des femmes détenues par des femmes protège-t-elle véritablement de la violence de l’institution carcérale ?
Ces arguments et ces revendications trouvent un écho au sein des Nations Unies, notamment auprès de l’actuelle titulaire du mandat de Rapporteuse spéciale sur les violences faites aux femmes, ses causes et ses conséquences (par ex. dans son rapport, à l’AGNU, La violence à l’égard des femmes et des filles dans le sport, U.N. doc. A/79/325, 2024, §§ 11, 12, 24, 27, 30-33, 68, 76, 84, 85 et 90). Or, parmi les porteuses et porteurs de ces revendications, des personnes et organisations « anti-droits » emploient le langage des droits humains à des fins d’exclusion et, in fine, de remise en cause des droits humains, tant nationaux qu’internationaux (Rapport de l’Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Pratiques d’exclusion, précité, § 7).
Aussi, dans ce contexte, le Comité ne devrait-il pas adopter systématiquement une approche inclusive et intersectionnelle des discriminations et des violences à l’égard des femmes (voir, en ce sens, son approche dans Rosanna Flamer-Caldera c. Sri Lanka, constatations du 21 février 2022, communication no 134/2018, U.N. doc. CEDAW/C/81/D/134/2018, et à cet égard V. Bellami, notre Chronique, no 21, 2023, pp. 77-81), y compris à propos d’enjeux présentés comme « sensibles » dans le débat public contemporain ?
Car, si le projet des « anti-droits » n’est, de toute évidence, pas protecteur des droits humains des personnes LGBTQIA+, qu’il combat explicitement au nom tantôt « de l’égalité femme/homme », tantôt au nom « de la ‘vérité biologique’, de la moralité, de la culture, des traditions, des convictions religieuses » (voir Rapport de l’Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Pratiques d’exclusion, précité, §§ 21-23 et 31-36) ou encore de « la puissance souveraine des États » (Ibid., §§ 26-30), il ne l’est pas davantage de ceux des « femmes ‘biologiques’ » qu’il prétend pourtant défendre (par ex. en contestant l’accès légal à l’interruption de grossesse, pour ces mêmes raisons, Ibid., § 9).