« Et notre droit même a, dit-on, des fictions légitimes sur lesquelles il fonde la vérité de sa justice » (Montaigne)
Dans le Monde du 24 avril 2024, l’historien Vincent Duclert, qui présida la commission chargée par le président Macron d’étudier le rôle de la France dans le génocide des Tutsis, évoquait les difficultés de l’action de la justice et la concurrence que lui font les historiens : « Il ne s’agit pas de magnifier le travail des historiens et de méconnaître la demande publique pour le procès pénal. Mais la justice ayant ses propres normes de fonctionnement, garantes de son sérieux et de son indépendance, il peut arriver que cette demande publique soit désavouée par des non-lieux ou des verdicts d’acquittement (…). Reste la connaissance, à la base de la reconnaissance, un jugement qui traverse les âges et qui, déjà, entre dans l’histoire. »
L’accès à la connaissance, c’est vrai, emprunte bien des chemins, dont certains sont parfois éloignés de la voie judiciaire. Dans le domaine des crimes de masse, les premiers à investiguer et à rapporter « ce qui s’est passé » sont généralement les journalistes ou les ONG, dont le professionnalisme dans la collecte des faits et des témoignages fait parfois l’admiration des enquêteurs judiciaires. Le terrain est aussi fréquemment investi par d’autres investigateurs aux méthodes plus universitaires : sociologues ou historiens apportent leur pierre à la compréhension des événements, à la reconstitution des enchaînements, à l’établissement des faits et parfois même des responsabilités. L’historien n’hésite plus à travailler en temps réel, sur le présent[1]. Enfin, de plus en plus souvent, les États mettent en place des mécanismes de justice transitionnelle, sur le mode des « commissions vérité et réconciliation », à la place ou à côté de la justice traditionnelle.
Et pourtant, la « vérité judiciaire » semble malgré tout conserver un statut privilégié. Les victimes du génocide des Tutsis, par exemple, savent généralement très bien qui furent leurs bourreaux : les tueurs ne se cachaient pas puisqu’ils obéissaient à des consignes officielles. Une très grande partie des crimes commis pendant ce génocide sont documentés depuis longtemps, et leurs auteurs identifiés comme tels par des enquêtes d’ONG ou des travaux d’historiens.
Cette vérité, cette connaissance, est bien là, présente dans les esprits, prête à entrer dans l’histoire – à tort ou à raison. Mais voilà, les veuves ou les enfants de victimes disparues dans les massacres ne s’en contentent pas. Cette vérité ne vaut pas, pour eux, la vérité judiciaire. Ils veulent des poursuites, un procès, un jugement. Pourquoi ?
Première réponse possible, trop évidente : pour la peine. Mais, accompagnant depuis vingt ans, comme avocat, des victimes de ce génocide, je sais que si la volonté de voir punir celui par qui l’on a souffert n’est certes pas absente, elle n’absorbe pas l’autre objectif, peut-être le véritable objectif, qui est de voir prononcer une parole qui tranche, qui ait l’autorité nécessaire pour départager définitivement le vrai du faux, désigner le coupable et désigner la victime en les nommant par leurs noms : coupable et victime – et empêcher définitivement le bourreau de se prétendre innocent.
Dans l’impunité, ce qui heurte est moins l’absence de peine que la persistance du récit des bourreaux, même notoirement identifiés, mais que l’indispensable présomption d’innocence autorise à se prétendre victimes d’une erreur, d’un malentendu ou d’une vengeance, d’entretenir le doute sur la parole de leurs accusateurs et de véhiculer des discours négationnistes.
Seule la justice peut répondre à cette attente par l’organisation d’un procès équitable, à même de lever la présomption d’innocence et de mettre fin à la concurrence des récits en énonçant, au nom de la collectivité, ce qui s’est passé, qui est la victime et qui est le bourreau, après que l’accusé a bénéficié de la plénitude des droits de la défense.
Hannah Arendt nous a enseigné que l’accord sur les vérités de fait est un préalable nécessaire au débat démocratique et donc à la vie politique elle-même[1]. Quand une société a traversé des divisions ou des évènements traumatiques, elle a besoin qu’une instance légitime nomme les choses, mette les mots sur ces évènements, élabore le récit des faits qui permettra de se détacher du passé et de préparer l’avenir.
Ce rôle est le plus souvent rempli, aujourd’hui, par le procès mais cela n’a pas toujours été le cas.
Au contraire, le pouvoir de véridiction, comme le nommait Michel Foucault, n’avait même historiquement aucun rapport avec une quelconque tentative d’établir ou de rétablir les faits. Dans toute une tradition la vérité devait être révélée, et non découverte. Le pouvoir d’énoncer une vérité assertorique, une vérité que, selon la définition de Marcel Détienne, « nul ne conteste, nul ne démontre »[2], était un pouvoir mystique, dévolu aux dieux, aux oracles ou aux prêtres, avant de devenir un pouvoir politique capté par les rois, « fontaines de justice » ; et l’on recourait traditionnellement aux épreuves pour départager les prétentions concurrentes (par exemple par le serment ou l’ordalie).
Même aujourd’hui, la justice n’excelle pas toujours à trouver la vérité, comme si elle était enfouie quelque part, attendant d’être déterrée par elle. La justice doit pourtant toujours trancher, même quand elle n’est pas sûre. Comme le dit l’un des personnages du film Anatomie d’une chute[3], quand on ne sait pas ce qu’il s’est passé, il y a un moment où il faut le décider.
La laïcisation de ce pouvoir de véridiction semble s’être produite une première fois lors du passage de la Grèce archaïque à la Grèce classique, autour du Vème siècle avant notre ère.
Dans Les Euménides[4], Eschyle met en scène le dialogue d’Athéna et du chœur pour l’organisation du procès d’Oreste, poursuivi[5] pour le meurtre de sa mère. « Les serments ne font pas triompher la justice », dit la déesse au Choryphée qui lui répond « Eh bien fais ton enquête et prononce un arrêt juste ». Enquête : le mot est lâché. La vérité d’un évènement peut se découvrir par l’usage de la raison, le recueil des indices, des témoignages et leur interprétation.
Mais la déesse Athéna ne se contente pas de cette substitution de l’enquête à l’épreuve du serment ; alors que le Chorypée veut encore l’en charger, elle lui répond que c’est désormais l’affaire des hommes : « Je vais choisir des juges du meurtre que je lierai par serment, et former un tribunal destiné à durer toujours. Et vous, faites appel aux témoignages, aux preuves qui, sous la foi du serment, aideront à la justice. Quand j’aurai choisi les meilleurs de mes citoyens, je reviendrai avec eux pour qu’ils tranchent cette affaire en connaissance de cause, sans manquer à leur serment ni à la justice. »
Désormais la justice cesse d’être l’affaire des dieux. Le serment n’est plus l’épreuve qu’il était, sanctionné par le châtiment divin qui frappe le parjure, mais l’engagement des juges et des témoins à faire de leur mieux pour être justes.
Une génération plus tard c’est Sophocle, comme Foucault l’a souvent raconté dans ses cours[6], qui met en scène dans Œdipe Roi[7] la première enquête criminelle de la littérature occidentale : Œdipe, roi de Thèbes, doit libérer sa ville de la peste et doit, pour cela, identifier l’assassin de Laïos, son prédécesseur. S’il commence par interroger Apollon et le devin Tiresias, leurs réponses ne le satisfont pas. Ce sont finalement les témoins oculaires, esclaves ou berger issus du petit peuple, qui lui dévoilent la vérité.
La « forme enquête », qui disparaîtra puis réapparaîtra au Moyen-Âge et dans laquelle Foucault n’hésitait pas à voir la matrice de toute démarche scientifique, reste à ce jour le moyen le plus rationnel d’approcher la réalité.
L’enquête judiciaire n’est pas forcément meilleure que les autres : le pouvoir de trancher, de mettre fin au débat, n’a jamais été lié à une qualité particulière de l’enquête. L’institution judiciaire dispose certes de moyens que d’autres formes d’enquêtes n’ont pas : même dans sa version la plus douce, elle peut contraindre un témoin à témoigner, perquisitionner pour récupérer des preuves, mettre un suspect en garde à vue pour le faire parler. Cela pouvait autrefois aller jusqu’à la torture.
Mais cela ne garantit en rien une meilleure qualité de la vérité ainsi produite : l’histoire est pleine de faux-aveux arrachés. A l’inverse, une preuve solide peut aussi être invalidée parce qu’elle n’a pas été recueillie dans les formes ou qu’elle a méconnu les droits de la défense.
L’approche judiciaire de la vérité présente un autre biais majeur : le procès ne pouvant être que celui d’une ou plusieurs personnes, le jugement ramène toujours l’explication causale des phénomènes à la seule question de la culpabilité, ou non, des accusés[8]. Il passe ainsi presque nécessairement à côté des explications sociales, politiques ou systémiques.
Ce biais rend l’approche policière ou pénale inadaptée aux situations où il est plus important de vraiment comprendre ce qui s’est passé que de trouver un coupable à punir. La médecine, les armées ou certaines industries (l’aéronautique ou le nucléaire par exemple) pratiquent un retour d’expérience systématique plus propice à la compréhension que la punition. Les enquêtes techniques du ministère des transports, qui interviennent après chaque catastrophe aéronautique, ferroviaire ou maritime par exemple[9], font plus pour la sécurité des transports que le procès pénal. Pour des raisons similaires, en matière de violations massives des droits humains ou du droit international humanitaire, les mécanismes d’enquêtes de l’ONU ou ceux des instances de justice transitionnelle, qui ne sont pas centrés sur la recherche de coupables mais sur la compréhension des mécanismes qui ont rendu certaines situations possibles, sont indispensables en complément du développement de la justice pénale internationale.
La justice ne dit donc pas mieux la vérité que d’autres mais sa vérité a ce poids particulier, presque mystique[10], qui fait de la parole du juge une parole performative : prononcée par la personne autorisée, suivant les rites convenus[11], la parole du juge modifie l’ordonnancement du réel : elle fait du coupable le coupable qu’il n’était pas aussi longtemps qu’il était présumé innocent ; elle autorise l’État à s’emparer de lui physiquement ; elle nomme « victime » la victime ; désormais, ce qui a été jugé sera la vérité officielle.
Le philosophe Giorgio Agamben y voit la fin même du droit : « Le but ultime du droit n’est pas de garantir la justice. Et encore moins la vérité. Il a pour seul but le jugement, indépendamment de la vérité ou de la justice. La preuve en est, irréfutable, que l’autorité de la chose jugée concerne aussi bien les sentences injustes. La production d’une res judicata – où la sentence tient lieu du vrai, du juste, et vaut comme vérité quand même elle est d’une injustice et d’une fausseté patentes – telle est la fin du droit.[12]»
La res judicata se substitue à l’évènement, prend sa place dans le récit collectif, elle fait passer le passé, dans un jeu entre le passé et l’avenir qui permet à la victime, désormais reconnue en tant que telle, de se détacher de l’évènement traumatique. C’est aussi ce jeu entre le passé et l’avenir qu’évoque le sort du criminel : condamné aux oubliettes, attaché à son crime, il va prendre dans le passé la place qu’y occupaient les victimes, désormais capables de s’en détacher par la grâce du jugement.
Pour atteindre cet objectif le procès s’ordonne selon une véritable liturgie. On a rappelé plus haut les conditions, selon Foucault, d’un discours performatif : tenu par la personne autorisée suivant les rites requis[13].
L’on ne saurait surestimer l’importance des rites[14]. Codifiés dans leur version laïque sous le nom de procédure, ils forment bien sûr un ensemble de garanties absolument indispensables pour les droits de la défense et la bonne conduite du procès. Mais cet ordonnancement donne aussi au procès sa vertu cathartique, héritée des tragédies classiques : unité de temps, unité de lieu, unité d’action caractérisent le procès criminel contemporain. Juges, jurés, accusé, victimes, témoins, avocats, public, sont enfermés dans un continuum spatio-temporel dont ils ne sortiront qu’une fois le verdict prononcé[15].
Il y a une forme particulière de magie qui préside à cette réunion de tous ceux qui « y étaient » pour revivre les évènements ensemble, pour rétablir la relation victime / bourreau en la transformant, puisque c’est ici désormais la victime-accusatrice qui tient l’auteur-accusé en respect. Dans ce théâtre, dont les ordonnateurs portent des costumes de cérémonie, noirs comme la nuit ou rouges comme le sang, les rôles principaux sont tenus par les protagonistes eux-mêmes, appelés à revivre les faits. Et parce que la divergence de leurs récits ne peut être tolérée, le pouvoir de trancher et d’énoncer ce qui s’est réellement passé est confié à celui qui justement « n’y était pas », le juge, le tiers, absent lors des évènements et qui pourtant devra clore les débats en expliquant à ceux qui « y étaient » ce qui sera désormais tenu pour vrai : la chose jugée, ce discours qui se substituera à tous les autres et fera désormais foi.
L’importance sociale ou anthropologique de la res judicata est telle qu’il est interdit de « jeter le discrédit» sur la décision rendue[16]. Mais cet interdit signale aussi la fragilité de la vérité judiciaire, qui pas plus qu’une autre ne se confond avec la réalité.
Comme on l’a vu, les vérités concurrentes ne sont que des discours en compétition pour produire le récit qui restera dans les mémoires. La res judicata dispose, dans cette compétition, d’arguments de poids liés à l’imperium du juge, au pouvoir de coercition qui s’attache à ses décisions, rendues au nom du souverain ou de la collectivité politique qui prévaut en un lieu donné et à une époque donnée. Mais l’histoire est remplie d’erreurs judiciaires : plus personne ne prête crédit aux jugements qui ont déclaré Socrate, Jésus ou le capitaine Dreyfus coupables des faits qui leur étaient reprochés.
Mais elle a la maîtrise du récit qui s’imposera aux contemporains, celui qui importe immédiatement aux communautés affectées. Cela lui donne une responsabilité particulière, qui justifie l’ensemble des normes par lesquelles le droit international définit ce qui fait qu’un procès est ou n’est pas équitable : sans respect des droits de la défense, la chose jugée perd toute légitimité.
La justice est, après tout, une institution politique, qui comme telle ne peut s’imposer que par la force ou par la confiance de ceux auxquels elle s’adresse. Les hommes rendent la justice à hauteur d’hommes, par des jugements dont la valeur reste relative dans le temps et dans l’espace : si, pour les communautés affectées et plus généralement pour les contemporains, le travail judiciaire est celui qui revêt la plus grande importance, sur le temps long, c’est toujours l’histoire qui a le dernier mot.
[1] H. Arendt, « Vérité et politique », The New Yorker, 25 février 1967, p. 49.
[2] M. Detienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, Éditions François Maspero, 1967, 164 pages.
[3] J. Triet, Anatomie d’une chute, Paris, Les Films Pelléas, 2023 [film].
[4] Eschyle, Les Euménides, env. 458 av. JC.
[5] Poursuivi au double sens du terme, et notamment au sens littéral par les Euménides, déesses de la vengeance.
[6] L’enquête d’Œdipe forme la matière de plusieurs leçons de Foucault : au Collège de France (leçon du 17 mars 1971 in Leçons sur la volonté de savoir, 1970-71) ; à l’université catholique de Rio de Janeiro (leçons du mois de mai 1973 sur La vérité et les formes juridiques, publiées dans Dits et écrits, tome 1, page 1406) ; à l’université de Louvain la Neuve (leçon du 28 avril1981 in Mal faire, dire vrai, fonction de l’aveu en justice).
[7] Sophocle, Œdipe Roi, env. 425 av. JC.
[8] Les sciences humaines ont largement démontré l’attirance pour les explications simples faisant de préférence reposer toutes les responsabilités sur un ou plusieurs individus au détriment des explications complexes. Voir P. Fauconnet et S. Lévy-Bruhl (ré-éditrice), La responsabilité : étude de sociologie (1920), Paris, Éditions PUF, 2023, 522 pages ; R. Girard, Le bouc-émissaire, Paris, Éditions Grasset, 1982, 298 pages ; également C. Morel, Les décisions absurdes III. L’enfer des règles et les pièges relationnels, Paris, Éditions Gallimard, 2018, 272 pages.
[9] Voir Code des transports, articles L. 1621-2 et L. 1621-3.
[10] Voir J. Derrida, Force de loi, le fondement mystique de l’autorité, Paris, Éditions Galilée, 1994, 145 pages.
[11] Foucault définissait le discours vrai comme « le discours prononcé par qui de droit et selon le rituel requis » (M. Foucault, L’ordre du discours, Paris, Éditions Gallimard, 1971, 81 pages).
[12] G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, Paris, Éditions Payot/Rivages, 1999, 233 pages. Cette analyse qu’Agamben développe dans plusieurs de ses ouvrages (voir aussi G. Agamben, Pilate et Jesus, Paris, Éditions Rivages, 2014, 102 pages, ou G. Agamben, Karman : Court traité sur l’action, la faute et le geste, Paris, Éditions Seuil, 2018, 144 pages) est empruntée au professeur de droit processuel italien Salvatore Satta, dont le texte court et lumineux Il mistero del processo (1949) a été traduit en français par Christophe Carraud (S. Satta et C. Carraud (traducteur), « Le mystère du procès (1949) », revue Conférence, vol. 34, printemps 2012).
[13] Voir M. Foucault, L’ordre du discours, op. cit.
[14] Voir aussi A. Garapon, L’âne portant des reliques, essai sur le rituel judiciaire, Paris, Éditions Bayard, 1985, 211 pages.
[15] C’est le cas pour les crimes relevant de la cour d’assises, dont les jurés doivent statuer « sans désemparer » mais cela ne l’est plus pour les délits ordinaires passibles des tribunaux correctionnels, qui peuvent mettre leurs jugements en délibéré.
[16] Code pénal, article 434-25.
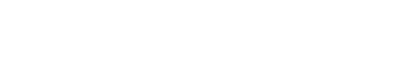

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
