La Convention relative aux droits personnes handicapées (entrée en vigueur le 3 mai 2008, ci-après, la « Convention ») reconnaît en son article 30 § 4 le droit des personnes sourdes et malentendantes « à la reconnaissance et au soutien [des] langue des signes et [de] la culture sourde ». De plus, celle-ci consacre un ensemble d’obligations à la charge des États parties aux fins de garantir l’effectivité de leur droit à l’éducation tel que consacré à l’article 24 § 1. En particulier, le § 3 b) de ce même article oblige les États à « facilit[er] l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes » et son § 4 à « [prendre] des mesures appropriées pour employer des enseignants […] qui ont une qualification en langue des signes [ainsi que] former les cadres et personnels éducatifs [à] l’utilisation des modes, moyens et formes de communication […] et des techniques […] pédagogiques adaptés […] ». Dans son Observation générale n° 4 sur Le droit à l’éducation inclusive, le Comité des droits des personnes handicapées (ci-après « le Comité ») précise que « [l]es élèves sourds et malentendants doivent pouvoir apprendre la langue des signes et des mesures doivent être prises [par les États] pour reconnaître et promouvoir l’identité linguistique de la communauté des sourds » (doc. CRPD/C/GC/4, 2016, § 35 b)). Ainsi, quelles mesures doivent concrètement prendre les États pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles ?
S’appuyant sur ces normes, la World Federation of the Deaf (la Fédération mondiale des sourds) revendique « le droit à l’éducation bilingue pour toutes et tous » (notre traduction, v. la page « Human Rights of the Deaf », sur : https://wfdeaf.org/our-work/human-rights-of-the-deaf/, consultée le 3 octobre 2023). La Fédération Nationale des Sourds de France plaide aussi pour le bilinguisme en langue des signes française (ci-après la « LSF ») dans l’enseignement de toutes les matières, par des professionnels ou grâce à des interprètes bilingues formés et qualifiés, en milieu ordinaire (Fédération Nationale des Sourds de France, « Prise de position – Éducation », septembre 2019, accessible en ligne sur https://www.fnsf.org/wp-content/uploads/2019/09/PRISE-DE-POSITION-EDUCATION.pdf, consulté le 3 octobre 2023). A cet égard, une inscription de la LSF dans la Constitution a pu être évoquée sur le modèle autrichien (v. par ex. la Question écrite au gouvernement n° 11155 du sénateur A. Fouché, publiée le 27 septembre 2019, sur : https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190611155.html, consultée le 16 octobre 2023). En effet, l’article 8 § 3 de la Loi constitutionnelle fédérale dispose que « [l]a langue des signes autrichienne [ci-après la « LSA »] est reconnue comme une langue à part entière [dans] les détails définis par la loi » [notre traduction] (disponible en intégralité sur : https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138, consulté le 3 octobre 2023). Cette reconnaissance ne signifie pas pour autant que le bilinguisme est une réalité dans les salles de classe. En 2013, le Comité déplorait que « […] la formation d’enseignants […] utilisant la [LSA] soit lacunaire […] les enfants sourds [en étant] considérablement pénalisés » (Observations finales sur le rapport initial de l’Autriche, adoptées par le Comité à sa dixième session (2-13 septembre 2013), 2013, doc. CRPD/C/AUT/CO/1, § 42).
C’est ce qu’estime également, en l’espèce, l’auteure de la communication, M. Köck, autrichienne et sourde, née en 1997 (§ 1), dont la première langue est la LSA (§ 2.1). Après avoir étudié tant en allemand qu’en LSA, à partir d’environ neuf ans, elle ne bénéficie plus que de l’interprétation de l’allemand vers la LSA. Toutefois, l’interprétation simultanée ne retranscrit pas fidèlement l’intégralité d’un propos – a fortiori quand les interprètes ne sont pas qualifiés – et l’empêche de prendre facilement des notes. Ainsi désavantagée, ses résultats chutent et elle redouble certaines années, parfois à sa demande (§ 2.1).
En 2014, agissant au nom de l’auteure, ses parents demandent au Ministère fédéral de l’éducation et des affaires féminines qu’elle puisse suivre ses cours en LSA. La Commission de l’école de commerce où elle étudie, à qui a été transmise la demande, n’y donne pas suite. Le recours des parents, alléguant le caractère discriminatoire de ce refus eu égard au régime applicable aux enfants ayant une langue maternelle autre que l’allemand, est rejeté par la Commission scolaire régionale (§ 2.2). En mars 2015, les parents font appel de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le « TAF »), se prévalant tant de l’article 8 de la Loi constitutionnelle fédérale précité que des dispositions de la Convention. Sans apprécier les arguments fondés sur cette dernière, le TAF confirme l’interprétation de la loi par la Commission scolaire régionale, selon laquelle ses dispositions « ne pouvaient être interprétés comme une autorisation de suivre un enseignement en [LSA] » (§ 2.3). En juin 2015, les parents sont déboutés par la Cour constitutionnelle au motif que le recours, ayant peu de chances d’aboutir, ne soulève pas de question constitutionnelle. En avril 2017, la Cour administrative suprême refuse de réexaminer la décision du TAF, soulignant, d’une part, l’absence d’un « point de droit d’importance essentielle » et, d’autre part, l’impossibilité d’ériger la LSA en langue d’enseignement, faute de fondement légal (§ 2.4).
Devant le Comité, l’auteure argue de nombreuses « violations continues » de plusieurs droits de la Convention (§ 3.1). Au stade de la recevabilité, si le Comité juge l’ensemble des faits et des griefs, recevables ratione temporis, y compris ceux antérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif (adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution A/RES/61/106 du 13 décembre 2006, entré en vigueur le 3 mai 2008, ci-après, le « Protocole facultatif ») pour l’État (§ 6.3), il en rejette toutefois un certain nombre, insuffisamment étayés au regard de l’article 2 alinéa e) de ce même Protocole.
Il en va du grief fondé sur la violation de l’article 5 de la Convention – consacrant l’égalité et la non-discrimination – en raison de la formulation de la Loi sur l’enseignement scolaire et la Loi constitutionnelle fédérale, l’auteure estimant qu’elles ne prendraient en compte in fine que des groupes autochtones/ethniques ou des personnes immigrées (§ 3.2). En effet, le Comité donne droit aux arguments de l’État (§ 6.6) : d’une part, le droit qui est reconnu aux minorités linguistiques autochtones « de faire leurs études dans leur langue maternelle [n’étant] pas absolu », car dépendant des régions et des groupes concernés ne peut servir de norme de référence (§ 4.3) ; d’autre part, l’application de la loi permet des distinctions entre les enfants immigrés et les enfants sourds, ces derniers bénéficiant de mesures de soutien spécifiques (§ 4.4).
Est rejeté également le second grief fondé sur l’article 5, lu conjointement avec les articles 12 §§ 3 et 4 – relatifs à « l’accompagnement [nécessaire] pour exercer [sa] capacité juridique » et aux « garanties appropriées et effectives » dans l’exercice de celle-ci – et 13 § 1 – sur l’accès et la participation effectives à la justice (§ 6.5). L’auteure affirme qu’en l’espèce, en violation de la loi nationale, les autorités ne lui auraient pas communiqué « des informations sur les procédures à engager pour faire valoir [ses] droits », alors qu’elle n’était pas représentée par un conseil (§ 3.4). En outre, elle argue notamment de l’absence d’effet direct des dispositions de la Convention au profit des particuliers en droit interne (§ 3.4). L’État répond qu’en sus des nombreux examens approfondis de la situation de l’auteure par les autorités compétentes pour en connaître, d’une part, « le droit d’être assisté par un conseil » n’est pas conféré par la Convention et, d’autre part, la Cour administrative suprême a déjà conclu à l’absence de violation du droit d’information de l’auteure (§ 4.8). Le Comité estime que l’auteure n’a pas expliqué comment ces éléments avaient porté atteinte à ses droits et rejette donc ces allégations (§ 6.5).
Cependant, le Comité déclare recevable sur le fond les griefs « concern[ant] les obstacles qu’elle a rencontrés au cours de sa scolarité, du fait que la [LSA] est sa première langue » (§ 6.4). Pour l’auteure, la LSA serait dans l’angle mort des politiques publiques, y compris celles visant à développer le multilinguisme (§ 3.2). En ce sens, elle rappelle les observations finales du Comité de 2013 précitées (§ 5.2, op. cit.). Plus précisément, l’absence de formation des enseignants ou encore de matériels pédagogiques adaptés en résultant constitue selon l’auteure une violation de l’article 24 précité sur le droit à l’éducation (§ 3.6). Tout comme l’absence d’un soutien approprié tout au long de sa scolarité, y compris pour le renforcement de sa maîtrise de la LSA, constitue une violation de l’article 30 § 4 précité sur la promotion de la langue des signes et de la culture sourde (§ 3.7). L’impossibilité de suivre un enseignement bilingue, compromettant ses débouchés professionnels, violerait également les droits que l’auteure tire de l’article 21 alinéas b) et e) sur la promotion et la facilitation de l’utilisation de la langue des signes, y compris dans les démarches officielles (§ 3.5). Au regard de l’article 7, l’État n’aurait pas pris en compte quand elle était enfant son intérêt supérieur, dès lors que les autorités administratives et judiciaires ne l’ont jamais consulté sur ses besoins et son opinion, malgré les dispositions internes constitutionnelles et législatives (§ 3.3). A contrario, arguant de sa marge de manœuvre en matière de droit à l’éducation telle qu’elle résulterait de l’article 4 § 2 de la Convention consacrant le principe de réalisation progressive, l’État estime que l’article 24 « n’instaure pas une obligation générale de faire sans délai de la langue des signes une langue d’enseignement » (§ 4.5). Il présente néanmoins un certain nombre de politiques qu’il a mis en place pour former des enseignants à la LSA ou des dispositifs « d’appui pédagogique individuel […] proposé[s] aux élèves ayant des besoins particuliers » (§ 4.6), dont l’auteure aurait bénéficié à la mesure de ses besoins, en coordination avec elle et toutes les personnes et institutions concernées, outre l’allocation d’éducation spéciale qu’elle a perçue entre 2012 et 2016 (§ 4.7).
Sur le fond, après avoir résumé les griefs soulevés par l’auteure de la communication au regard des principes d’égalité et de non-discrimination en matière d’accès à l’éducation (§ 7.2), le Comité récapitule les obligations étatiques découlant de la Convention eu égard à la scolarité des élèves sourds ou malentendants. En particulier, s’agissant de la langue des signes, le Comité cite le § 35 b) de son Observation générale n° 4 précitée (§ 7.3, op. cit.). Indépendamment de la réalisation progressive du droit à l’éducation, le Comité rappelle que « les États parties ont l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chaque élément [de ce droit], notamment la non-discrimination dans tous les aspects de l’éducation et les aménagements raisonnables visant à garantir que les personnes handicapées ne soient pas exclues de l’enseignement ». En ce sens, il s’inscrit pleinement dans l’approche établie par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui, dès 1991, ajoute que « [p]our qu’un État partie puisse invoquer le manque de ressources lorsqu’il ne s’acquitte même pas de ses obligations fondamentales minimum, il doit démontrer qu’aucun effort n’a été épargné pour utiliser toutes les ressources […] à sa disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations minimum » (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 3 – La nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), adoptée le 14 décembre 1990, U.N. doc. E/1991/23, § 10). Autrement dit, pour le Comité, ces aménagements raisonnables doivent être mis en œuvre quasiment en toute circonstance. Toutefois, il précise que ceci n’équivaut pas à « accorder plus ou moins de droits ou d’avantages qu’au reste de la population », mais plutôt à « prendre des mesures concrètes pour réduire les désavantages structurels », y compris grâce à « un traitement préférentiel approprié ». Ainsi, le Comité entreprend d’évaluer in concreto si l’Autriche a pris des mesures concrètes mettant en place des aménagements raisonnables au bénéfice de l’auteure (§ 7.4).
L’ensemble des mesures dont a bénéficié l’auteure de la communication – notamment l’allocation d’éducation spéciale perçue – lui ayant permis de « progresser dans le système scolaire », le Comité conclut que ces mesures « n’ont pas été inutiles, inappropriées ou inefficaces », et que dès lors, l’État s’est bien acquitté en l’espèce de son « obligation […] pour que l’auteure jouisse d’une égalité de fait et puisse exercer tous [ses] droits […] ». Il constate alors la non-violation de l’article 5, lu conjointement avec les articles 21 alinéas b et e), 24 et 30 § 4 (§ 7.5).
Enfin, pour constater l’absence de violation de l’article 5 lu conjointement avec l’article 7, le Comité s’appuie tant sur les observations de l’État selon lesquelles « les mesures prises en faveur de l’auteure ont été mises en place en coordination avec elle et ses parents et adaptées à ses besoins » que sur l’absence d’informations fournies par l’auteure pour démontrer que les autorités n’auraient pas tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins ou de son opinion (§ 7.6).
Toutefois, ces constatations, portant sur une situation individuelle passée, ne préjugent en rien de l’appréciation systémique par le Comité de la situation actuelle alarmante des personnes sourdes et malentendantes dans le système éducatif autrichien. En témoignent ses dernières observations finales adoptées à l’occasion de l’examen périodique de l’Autriche en août-septembre 2023, où, « gravement préoccupé », il dénonce la régression des politiques d’éducation inclusive, due en partie à une réforme du système éducatif amorcée en 2017 au profit des milieux éducatifs ségrégués, entraînant, entres autres, une absence de professionnels qualifiés et un manque d’aménagements raisonnables (doc. CRPD/C/AUT/CO/2-3, § 55). Face à la dégradation des conditions éducatives, sans préconiser formellement le bilinguisme, le Comité souligne toutefois la nécessité a minima de « reconnaître la LSA dans l’éducation et de la mettre en œuvre comme moyen de communication et comme matière à enseigner » [notre traduction] (Ibidem, § 56 g)).
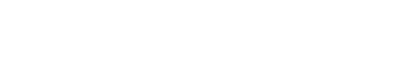

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
