Jean Rivero n’est plus et le droit des libertés fondamentales a perdu un maître exemplaire. Ses ouvrages bien connus de libertés publiques, réédités constamment depuis 1974, ont prolongé et amplifié l’enseignement qu’il dispensait à la Faculté de droit de Paris et qui était polycopié pour le bonheur de nombreux étudiants, professeurs et juristes en France et à l’étranger. On y retrouve, comme dans tous ses écrits, une profonde culture, le goût de la précision et du mot juste, la qualité de la réflexion mais aussi le souci de la clarté et d’une démarche toujours pédagogique. Car, outre la portée très ample de sa pensée, Jean Rivero restait surtout un Professeur. Nous avons eu la chance de faire partie de ses élèves en doctorat puis (avec Jacques Mourgeon, heureuse coïncidence…) d’être affecté, comme assistant, pour partie, à son service. Quelle leçon nous avons reçue en ayant un rapport privilégié avec un grand universitaire dont l’humanisme et la science s’ajoutaient à la rigueur juridique et à une honnêteté intellectuelle sans faille. Qu’on veuille bien nous pardonner d’utiliser ces qualificatifs, mais en rédigeant cette notice, tant de souvenirs affluent, que partagent sans aucun doute tous ceux qui ont bénéficié d’une telle rencontre avec Jean Rivero.
Sa conception des droits de l’homme rejoignait tout à fait celle de René Cassin, et il n’est pas inutile de rappeler le rôle de Jean Rivero dans la création de l’Association pour la fidélité à la pensée de René Cassin et le dynamisme dont il fit preuve au sein du Conseil d’administration ; il fut le maître d’œuvre de ce magnifique colloque – consacré à cet homme prestigieux, à son action et à sa pensée – qui fut organisé les 14 et 15 novembre 1980 au Centre National de la Recherche Scientifique. Il prit également une part prépondérante dans le déroulement du congrès du 11 octobre 1987 faisant suite aux cérémonies solennelles du transfert des cendres de René Cassin au Panthéon1. Au cours de cette dernière manifestation, Jean Rivero mit en évidence le parallélisme de la Déclaration universelle et de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sur le plan conceptuel. Et d’abord cette vérité élémentaire que l’on oublie quelquefois dans les couloirs onusiens ou de l’UNESCO, que les droits de l’homme sont d’abord des « droits », au sens plein que les juristes savent lui donner, c’est à dire qui confèrent à ceux qui en sont titulaires des possibilités d’action opposables aux autres et dont la méconnaissance appelle une sanction.
Cette première précision devait être donnée, car beaucoup de textes nationaux ou internationaux « formulent des aspirations qui, si généreuses qu’elles soient, ne peuvent trouver place dans l’ordre juridique, soit que leur objet reste vague, voire impossible – je pense au droit à la paix internationale, hélas ! -, soit que nul ne sache à qui les opposer, de telle sorte que l’éventualité d’une sanction relève à leur égard de l’utopie. Le risque est grand, dès lors que des textes officiels qualifient de « droits » ces aspirations et ces vœux, de les voir entraîner avec eux, dans la sphère des vœux et aspirations, les droits, les vrais, ce qui en excuserait d’avance toutes les violations ». Et ce risque est en effet plus actuel que jamais, face à l’inflation verbale qui affecte le concept, alimentée encore dernièrement à l’UNESCO par des pseudo-théories « modernes ». Il faut inlassablement répéter que les droits de l’homme, dans l’esprit de 1789 et de 1948, ne définissent pas une espérance lointaine, mais des droits au sens plein du terme.
Les titulaires des obligations, ce sont les collectivités, et singulièrement l’Etat sous la juridiction duquel se trouve l’individu, mais aussi les autres individus. René Cassin et Jean Rivero (et plus tard René-Jean Dupuy) ont beaucoup insisté sur cette dimension« horizontale » et non plus seulement verticale des droits de l’homme, c’est à dire des obligations des hommes les uns à l’égard des autres. Le Professeur Rivero s’en est expliqué dans l’Amicorum Discipulorumque Liber dédié à René Cassin2, et il est vrai que, pour que les droits de l’homme soient véritablement vécus, il est nécessaire de s’attacher à les faire respecter aussi dans les rapports entre personnes privées. A cet égard, Jean Rivero a bien dissipé l’ambiguïté éventuelle que pouvait contenir l’article 29 de la Déclaration universelle. Et, plus tard, dans le prolongement, René-Jean Dupuy pouvait s’écrier : « Si désormais l’humanité a des droits sur l’Etat, elle en a aussi sur l’homme. Elle attend de lui notamment qu’il la respecte dans les autres hommes, car toute violation de leurs droits méconnaît les siens »3.
La théorie est claire, et Jean Rivero a eu encore le mérite de s’opposer à ceux qui reprochaient à la Déclaration universelle comme à celle de 1789 leur silence sur les « devoirs » de l’homme. Cette notion lui paraissait (à juste raison, selon nous) à la fois erronée et dangereuse, en juxtaposant deux concepts très différents, car les droits de l’homme sont des droits et relèvent de l’ordre juridique ; les devoirs, eux, relèvent de l’éthique. Comme écrivait Jean Rivero : « Droits et devoirs, c’est un faux diptyque, car il réunit deux notions qui n’appartiennent pas au même domaine. Dès lors, le risque est double : les exigences d’éthique sont trop diverses et trop hautes pour se plier à la formulation juridique. Il suffit pour le vérifier de se reporter aux Constitutions qui ont tenté de consacrer les devoirs : le flou des mots, leur fadeur réduisant à un minimum incertain les appels de la conscience qui peuvent aller du plus banal conformisme moral jusqu’au sacrifice de soi ». Le danger est tout aussi grand pour le concept de droits :
« Les devoirs peuvent les entraîner hors de la sphère qui commande leur efficacité et les réduire à une aspiration ou à la formation d’un lointain idéal laissé à l’appréciation des consciences ». Enfin, comme le précise encore l’éminent maître : « Dans l’ordre juridique, ce n’est pas le devoir qui correspond au droit, c’est l’obligation, et le droit reconnu à l’un engendre, pour les autres, l’obligation de le respecter ». C’est pourquoi l’énoncé des devoirs, dans l’une ou l’autre Déclaration, s’il eût été dangereux, était de surcroît inutile.
Ces droits, c’est l’homme qui en est titulaire, c’est à dire évidemment l’être humain, homme ou femme (et de cette façon, Jean Rivero était dès lors étonné et inquiet que l’on s’attache à énoncer des déclarations ou des conventions propres aux seuls droits de la femme), sans aucune exclusion. Il a toujours condamné fermement au nom de la dignité de la personne humaine toute discrimination d’où qu’elle vienne : « le racisme, l’odieux racisme qui alimente l’Holocauste et qui, hélas, n’a pas dit son dernier mot ».
Rien dans l’échelle des valeurs ne se situe au-dessus du principe de dignité de la personne humaine. On évoque souvent aujourd’hui – déclarait-il – les droits des peuples, les droits des collectivités. « Le risque, c’est de les mettre en parallèle avec les droits de l’homme, voire au-dessus d’eux, et de perdre de vue que ces droits n’ont pas d’autre assise que les droits de ceux qui composent le groupe. La finalité du groupe social quel qu’il soit, c’est le service de l’homme… S’écarter de cette hiérarchisation, c’est ouvrir la voie à tous les asservissements ». On le voit, la transcendance de l’homme, le caractère absolu de ses droits sont au cœur de cette conception (qui admet toutefois, naturellement, à l’instar de la Convention européenne des droits de l’homme, que les libertés puissent faire l’objet de limitations si ces dernières sont précisément prévues par la loi et sont strictement nécessaires, dans une société démocratique, à la poursuite d’un objectif légitime, intérêt public qualifié ou droits d’autrui).
Il faut revenir sur cette dernière idée : les droits des groupes n’existent que parce que ce sont des moyens nécessaires à la satisfaction des droits de l’homme. C’est leur fonction et en même temps leur limite. C’est pourquoi le Groupe n’a pas le pouvoir de porter une atteinte substantielle aux droits de la personne humaine ou d’en ajourner l’exercice au nom d’un intérêt dit supérieur, de caractère politique, économique ou pseudo-religieux qualifié – sans doute indûment – de droit (collectif) de l’homme. « Sur les droits des collectivités, la fumée des fours crématoires projette son ombre. Les droits des collectivités sont, pour les droits de l’homme, la plus grave des menaces, car leur reconnaissance risque de donner le sceau de la justice à la domination du plus fort sur le plus faible ». Cette citation, extraite du rapport introductif général du professeur Jean Rivero, présenté au colloque de Strasbourg du 14 mars 1979, met d’emblée l’accent sur l’un des risques les plus graves de conflit entre les droits individuels et les droits collectifs4. L’ensemble de ce texte mérite d’être étudié et médité, tant les réflexions sont nombreuses et terriblement d’actualité.
Ainsi, dans certains pays du Tiers Monde, on a souvent voulu différer l’exercice des droits culturels (libres), civils et politiques notamment, jusqu’à l’avènement du développement. Là encore, la libération économique de la collectivité précède et conditionne l’exercice des droits de l’homme. En fait, bien des gouvernements font de cette thèse un alibi pour ne pas respecter les droits fondamentaux. Sur un plan purement logique, on comprend mal pourquoi les ressortissants des pays les plus pauvres seraient « en plus » privés du droit à la liberté, à la justice, ou à celui de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. On a d’ailleurs remarqué, en ce sens, que dans plusieurs pays ayant maintenu un tel régime sur la base de cet alibi, les droits de l’homme n’ont toujours pas été observés après le « décollage économique ». Le Président Keba M’Baye l’a signalé précisément dans plusieurs de ses cours à l’Institut Cassin de Strasbourg.
Que l’on soit clair : le droit au développement met à l’épreuve la solidarité de la communauté internationale, et correspond à ce niveau à « un devoir social impérieux ». On n’est pas hostile, bien au contraire, à ce qu’il soit qualifié de droit collectif de l’homme, pour que sa finalité proprement humaine ne soit pas ignorée, mais il n’autorise aucune violation des droits de l’Homme-individu. C’est pourquoi, dans la Déclaration de Vienne de 1993, § 10, il est nettement spécifié : « l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’homme internationalement reconnus. »
Sur un autre plan, Jean Rivero fut un administrativiste et un constitutionnaliste de grand talent ; on en aura déjà une idée en parcourant les « Pages de Doctrine » heureusement publiées par la LGDJ en 1980, et le « Précis » de droit administratif constamment réédité, merveille de clarté et d’intelligence. Jean Waline, dans l’allocution prononcée lors de la messe célébrée le 4 juillet 2001 en l’église Saint-Etienne-du-Mont (Paris) a évoqué avec émotion l’Homme d’une exceptionnelle densité et d’une qualité humaine rare que connaissent tous les juristes de notre génération, et en particulier les agrégatifs de droit public qui lui doivent tout. Jean Waline a su célébrer ce double talent de juriste et d’écrivain que l’on retrouve dans maintes études, et en tout premier lieu dans cette géniale et si fine chronique « Le Huron au Palais Royal, ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir »5. Que de sagesse et d’enseignements pour bien des juridictions en dehors même du Conseil d’Etat – dans les phrases du Huron. « Nous autres, bons sauvages, nous sommes des esprits simples : nous pensons que la justice est faite pour le justiciable et que sa valeur se mesure en termes de vie quotidienne. Ce n’est pas le développement du droit qui nous intéresse, c’est la protection efficace qu’en tire le particulier ».
Comme l’a constaté le Doyen Georges Vedel ce même mercredi 4 juillet 2001 : « Le besoin d’indépendance l’avait sans doute fait se détourner de tout autre métier qu’universitaire. Jean Rivero avait son franc parler et avait su, dans des chroniques devenues célèbres, reprocher au juge administratif de préférer parfois l’esthétique judiciaire au souci du justiciable… » et il ajoutait : « Le domaine des droits de l’homme lui fut de plus en plus cher avec l’âge ». Ce dernier souci n’était pas étranger à son Huron lorsqu’il déclara : « Je reviendrai, dit-il, lorsque l’avenir aura répondu à votre confiance et que le citoyen trouvera dans le recours les satisfactions effectives auxquelles nous autres, modestes Hurons, attachons un prix sans doute excessif. »
Dans ce contexte, Jean Rivero, dans la dernière édition du Dalloz, saluait cette très belle réforme relative au référé-suspension et au référé-liberté. C’est un pas important pour la protection des requérants, car est notablement assoupli l’octroi du sursis à exécution, et surtout parce que la protection des droits fondamentaux est sauvegardée dans l’urgence. Voilà une donnée franchement positive. Quant à l’amélioration des autres droits effectifs du justiciable, il faut faire encore confiance à l’avenir…
Jean Rivero aura marqué son temps. Il a en effet marqué de sa foi, de sa générosité, de sa tolérance, mais aussi de sa rigueur juridique, la théorie des libertés. Nul doute qu’en toute simplicité, il aura suscité et suscitera encore bien des disciples.
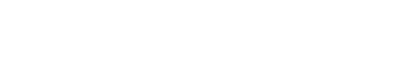

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
