À la demande du représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l’Office des Nations Unies à Genève – demande appuyée par 26 États membres, le Conseil des droits de l’homme a tenu une session extraordinaire sur la République démocratique du Congo en février dernier[1], « afin d’examiner la situation alarmante des droits de l’homme dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu[2] ». Il a réagi en adoptant une résolution par consensus dans laquelle il « condamne avec la plus grande fermeté toutes les violations persistantes des droits de l’homme et atteintes à ces droits, et les violations du droit international humanitaire et du droit international des réfugiés commises[3] » dans ces deux provinces. Il a également accordé une grande importance à l’établissement des faits constitutifs desdites violations. Il a ainsi affirmé « qu’il est impératif de recueillir, de préserver et d’analyser des éléments de preuve de ces violations pour garantir que les responsables de crimes répondent de leurs actes devant la justice pénale internationale, et que la gravité de la situation impose d’agir rapidement et de manière rigoureuse pour s’assurer que les victimes soient reconnues et soutenues[4] ». En conséquence, il a décidé de mettre en place une enquête sur deux temps.
Pour réagir à l’urgence de la situation, il a demandé, dans un premier temps, au Haut-Commissariat des droits de l’homme d’instituer une mission d’établissement des faits. Cette mission devait « [e]nquêter et établir les faits, les circonstances et les origines fondamentales de toutes les allégations de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits et de violations du droit international humanitaire […] en cours dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu[5] ». Dans un second temps, il prévoyait la création d’« une commission d’enquête indépendante, composée de trois experts ayant des compétences en droit international des droits de l’homme et en droit international humanitaire, qui seront nommés dès que possible par le Président du Conseil des droits de l’homme, pour poursuivre les travaux entrepris par la mission d’établissement des faits du Haut-Commissaire après la présentation du rapport complet de ce dernier, avec le même mandat[6] ».
Cet exemple récent démontre à la fois la vitalité de la technique de l’enquête mais également son adaptation au contexte dans lequel elle est déployée.
Depuis sa codification dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, l’enquête a évolué. Elle s’est adaptée aux besoins de la communauté internationale[7]. D’une technique de règlement pacifique des différends, n’ayant pour objet que de « faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait[8] » et requérant le consentement des deux parties, elle est devenue un instrument d’information pour les organisations internationales, grâce à son institutionnalisation en leur sein. Ainsi, la Déclaration concernant les activités d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1991 l’a définie comme : « Toute activité destinée à acquérir une connaissance détaillée des aspects pertinents de tout différend ou de toute situation dont les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies ont besoin pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales. »[9]
La pratique au sein des Nations Unies constitue un exemple topique de l’importance de ce mécanisme comme outil d’information des organisations internationales[10]. Si seul le Conseil de Sécurité tire sa compétence pour « enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend […] » sur la Charte des Nations Unies et plus particulièrement son article 34[11], l’Assemblée générale[12], le Secrétaire général[13] et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme[14] ont également pu recourir à ce mécanisme en s’appuyant sur la théorie des compétences implicites. La pratique se poursuit même si dorénavant la plupart des commissions ou missions d’enquête sont instituées par le Conseil des droits de l’homme, à la suite de l’expérience de sa prédécesseur la Commission des droits de l’homme[15].
Progressivement, le mandat des commissions d’enquête s’est étendu. À leur champ de compétence visant initialement le droit international des droits de l’homme s’est d’abord ajouté le droit international humanitaire[16]. Leur mandat s’est ensuite encore élargi en suivant notamment le développement du droit international pénal et l’émergence de la justice pénale internationale. Par conséquent, les mandats des missions d’enquête peuvent comprendre la recherche des crimes de droit international voire de leurs auteurs. Un mouvement de pénalisation des enquêtes s’est donc dessiné[17].
Dans ce contexte, l’enquête est devenue un outil tourné vers la recherche de la vérité. Elle œuvre ainsi à la réalisation du droit à la vérité ou du droit de savoir[18]. Les organisations internationales de protection des droits de l’homme l’utilisent notamment pour répondre aux situations de violations massives et/ou systématiques des droits humains[19], conformément aux Principes Joinet[20]. L’enquête constitue donc une des techniques de la justice transitionnelle en contribuant dans un premier temps au droit de savoir et éventuellement au droit à la justice et au droit à la réparation selon les procédures disponibles.
Depuis quelques années, s’opère un nouveau changement. Le développement des nouvelles technologies renforce l’efficacité des enquêtes en droit international. Les enquêteurs accèdent en effet à une quantité importante de preuves facilitant l’établissement des faits (I). Néanmoins, si leur utilisation est favorable à la réalisation du droit à la vérité, elle s’accompagne également de nombreux défis au regard de ce même droit (II).
I. Le renforcement des enquêtes
L’accroissement des mandats des commissions d’enquête ajouté au recours aux nouvelles technologies ont abouti à un renforcement des enquêtes grâce à une diversification des preuves démontrant la commission des violations et même de leurs causes profondes. Les enquêteurs sont dorénavant en possession d’un volume important de preuves (A). Le traitement de ces preuves conduit à une professionnalisation des équipes d’enquête, améliorant indéniablement la qualité des enquêtes (B).
A. La diversification et la technicisation des preuves
1. Le renforcement de la technicité des enquêtes
Le contenu des mandats des commissions d’enquête s’est diversifié. Alors qu’elles avaient vocation originellement à enquêter sur des violations de droits de l’homme, leurs compétences ont été étendues au constat de violations du droit humanitaire en raison des liens intrinsèques unissant ces deux branches du droit[21]. Il leur a ensuite été demandé explicitement ou implicitement d’intégrer le droit international pénal dans leur source de droits. Autrement dit, les commissions d’enquête s’intéressent depuis aux faits constitutifs de crimes internationaux afin d’une part inciter à la saisine de la justice pénale internationale et d’autre part en faciliter le déroulement en coopérant avec ses représentants[22]. Sont donc apparues aux côtés de commissions d’enquête plus traditionnelles se contentant d’établir l’existence de violations de droit de l’homme et de droit humanitaire, des commissions d’enquête appartenant à la catégorie des mécanismes d’accountability chargées de démontrer l’existence de crimes et de déterminer les responsables[23].
Plus récemment, les mandats des commissions d’enquête ont encore évolué dans le but de renforcer leur complémentarité avec d’autres acteurs et notamment les acteurs de la justice pénale. Une nouvelle fonction leur a été confiée répondant aux principes du droit à la vérité : celle de « préserver » les preuves recueillies en plus de leur fonction initiale d’établir les faits en collectant lesdites preuves, comme le montre le mandat confié au Haut-Commissariat sur la situation au Bélarus[24].
Si certains éléments se retrouvent dorénavant dans tous les mandats telle que la fonction de préservation des preuves[25], chaque mandat reste unique quant au corpus de règles de droit mobilisées[26], à la temporalité de la commission des faits recherchés[27], à la zone géographique concernée, etc. Certains mandats comprennent même une approche genrée[28]. D’autres demandent aux enquêteurs de mettre l’accent sur les violations subies par les enfants[29]. Certains mandats imposent aux enquêteurs de rechercher au-delà de la commission de violations des droits humains leurs « causes profondes »[30] ou « structurelles »[31].
Les objectifs de plus en plus précis et divers assignés aux commissions d’enquête couplés aux liens qui se développent entre elles et la justice pénale ont alors conduit les enquêteurs à un effort plus conséquent dans le recueil des preuves afin que celles-ci puissent démontrer de manière convaincante les éléments recherchés. D’ailleurs, nous assistons à un glissement du langage au sein des Nations Unies. Le terme « information » était privilégié pour différencier la qualité de la preuve recueillie par les commissions d’enquête selon une méthode « droits de l’homme » des preuves de nature pénale[32]. Les derniers mandats se réfèrent à la notion de preuve[33], confirmant le renforcement des enquêtes réalisées sous l’égide des Nations Unies.
2. Une diversification des modes de preuve
Si les mandats sont de plus en plus exigeants, les enquêteurs rencontrent encore trop souvent des difficultés pour réaliser leur enquête sur le territoire de l’État concerné. Ce dernier peut, d’une part, refuser l’accès à son territoire, marquant ainsi son hostilité à la procédure d’enquête. D’autre part, lorsqu’il l’autorise, les conditions de sécurité sur place peuvent entraver l’enquête. Il peut également être difficile pour les enquêteurs de rechercher les faits constitutifs de violation compte tenu de l’étendue du territoire de l’État à parcourir dans un temps limité[34]. Le mandat des commissions d’enquête est en effet court, même lorsqu’il fait l’objet d’un renouvellement. Le développement des nouvelles technologies est apparu comme un remède.
Les enquêteurs sont dorénavant en mesure d’accéder à d’autres preuves quand ils ne peuvent pas se rendre physiquement sur place. Par exemple, grâce au développement des smartphones et des réseaux sociaux, les individus témoins, victimes ou participant à la commission des violations transmettent des informations qui peuvent ensuite être utilisées par les enquêteurs[35]. La diffusion de ces informations et leur partage est accentué par l’avènement de puissantes plateformes du numérique. Ces dernières fournissent un forum de médias sociaux. Elles y diffusent des contenus[36]. En somme, elles ont créé un nouvel espace d’expression humaine, devenu le terrain des enquêteurs pour recueillir des preuves en open source. Ce partage d’informations peut également être augmenté grâce à l’action d’organisations non gouvernementales. Elles mettent en place des plateformes digitales pour permettre aux victimes et témoins d’apporter leur témoignage à travers leurs photos, vidéos, (etc.) plus facilement[37].
Les techniques de télédétection se sont également améliorées. Enfin, les drones peuvent être déployés dans les zones où les enquêteurs ne peuvent se rendre pour capturer des images. Loin de détrôner les preuves dites traditionnelles – dont le témoignage reste dominant dans tous les types de procédures d’enquête[38] –, ces nouvelles preuves s’y ajoutent, créant un mouvement de diversification des preuves.
En outre, les nouvelles technologies accroissent l’accès aux preuves traditionnelles, car elles permettent que celles-ci soient transmises aux enquêteurs soit directement comme dans le cas du recueil de témoignages à distance[39], soit indirectement. Les réseaux sociaux permettent en effet aux enquêteurs d’accéder à des preuves de nature disparate telles que des photos, des vidéos, des documents écrits, du texte, etc.
De sorte que les enquêteurs mobilisent de plus en plus une quantité importante de preuves très diverses parmi lesquelles figurent des preuves marquées par une grande technicité.
B. Une professionnalisation des équipes d’enquêtes
Le traitement des preuves recueillies en open source a, d’une part, incité les enquêteurs à renforcer leur méthodologie pour en assurer l’authenticité et l’intégrité (1), et d’autre part, aboutit à une spécialisation de services d’enquête pour les guider dans l’accomplissement de ces opérations (2).
1. Un renforcement de la méthodologie d’enquête
La nature volatile des informations récoltées lors d’une enquête en open source, lesquelles peuvent disparaître à tout moment en raison d’un retrait par son auteur, de la modération effectuée par la plateforme ou encore d’un blocage d’accès opéré par l’État visé, oblige l’enquêteur à recueillir ces informations en respectant les exigences probatoires de sa procédure par anticipation s’il souhaite ensuite pouvoir les présenter en tant que preuve. Cette collecte d’informations en anticipant une éventuelle future qualification en preuve impose aux enquêteurs de suivre une méthodologie plus rigoureuse, même si cette tendance n’est pas encore uniformisée. En effet, l’usage au sein des commissions d’enquête des Nations Unies est marqué par une diversité des pratiques en raison du mode de leur institution, de la courte durée de leur mandat et de l’indépendance dont bénéficient leurs commissaires. Si le Haut-Commissariat des Nations Unies avait procédé à une première harmonisation de leurs pratiques en élaborant un guide à leur intention[40], son actualisation datant de 2015 ne permet pas de leur donner d’indications précises sur les principes méthodologiques entourant l’enquête en open source. Un protocole dédié à l’enquête en open source – dit Protocole de Berkeley[41] – a toutefois été adopté. Il sert de guide aux différents enquêteurs, en énonçant plusieurs principes méthodologiques – exactitude, minimisation de la conservation des données, conservation et sécurité dès la conception.
Plusieurs commissions et missions d’enquête commencent à évoquer qu’elles s’astreignent à vérifier l’authenticité, la véracité et la crédibilité des informations recueillies « through best practices of current open-source analytical methods »[42], révélant un renforcement de leur méthodologie. Elles s’obligent également à « vérifi[er] au moyen de références croisées à partir d’un ensemble large et varié de sources fiables »[43] les informations utilisées. Elles transposent ainsi le principe de corroboration des preuves – principe directeur fondamental énoncé dans le guide adopté par le Haut-Commissariat[44] – aux informations recueillies en open source. Ce principe directeur continue de garantir la qualité de leurs enquêtes quel que soit l’environnement dans lequel elles sont réalisées : physique ou numérique.
2. Une spécialisation des enquêteurs
La collecte d’informations en open source en suivant une méthodologie rigoureuse dans le but d’anticiper une éventuelle utilisation en tant que preuve oblige l’enquêteur à se spécialiser. Celui-ci doit en effet disposer des compétences technologiques nécessaires pour réaliser son enquête en open source. Il doit notamment être en mesure de vérifier l’authentification du contenu, et pour cela analyser sa géolocalisation et sa chronolocalisation, extraire les métadonnées nécessaires, etc. Plus généralement, il doit veiller à ce que les éléments soient recueillis « de manière scientifique conformément aux normes internationales relatives à la préservation des contenus en ligne et aux règles d’admissibilité des preuves numériques »[45]. La technicité des enquêtes en source ouverte a alors conduit au développement de services spécialisés au sein des organes d’enquêtes.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies a ainsi mis en place un service d’appui aux enquêtes le 1er janvier 2020[46]. Ses débuts ont certes été entravés par le contexte de la pandémie mais il s’est ensuite développé. Ses activités d’appui aux commissions et missions d’enquête des Nations Unies sont diverses, allant de la préparation des grandes lignes du budget à l’évaluation et la présélection de candidats aptes à siéger en tant qu’experts indépendants ou commissaires. Un service consacré aux enquêtes en open source – le Digital Investigation Support Cell (DISC) – a également été ajouté en son sein en septembre 2022[47]. Plus précisément, « [t]he unit aims to support the IBs and OHCHR field presences in applying new technologies [in] the areas of digital forensics, blockchain investigation, eDiscovery, open-source investigations, and digital evidence handling »[48]. Sa composition est la suivante : « Information Management Officer (P4) – Information Management Officer (P3) – Open-Source Investigator (P3) – Archivist (G5) » (Fonctionnaire chargé de l’information (P4), Fonctionnaire chargé de l’information (P3), Enquêteur en sources ouvertes (P3), Archiviste (G5) [traduction libre])[49]. Un service similaire a été créé au sein du Bureau de la Cour pénale internationale dans les années 2010 au sein de la Division des enquêtes. Cette unité d’enquête « handles scientific matters relating to digital evidence collected via computers, for example, data that can be found on the internet or on social networks […] »[50]. Elle s’est progressivement développée et devrait encore évoluer, car le Procureur a annoncé dans son dernier plan stratégique qu’il « entend révolutionner le recours aux outils technologiques dans son travail afin de renforcer sa capacité de s’appuyer sur des éléments numériques, documentaires, vidéo et audio »[51].
Cette surspécialisation des équipes d’enquête entraîne un coût conséquent en termes de recrutement et de formation d’un personnel hautement qualifié dans un domaine mouvant. En effet, les techniques évoluant constamment, les équipes de recherche doivent être vigilantes à poursuivre leur propre formation. Or, la possibilité de bénéficier d’un personnel aussi spécialisé requiert des ressources importantes, lesquelles peuvent faire défaut aux enquêteurs, comme le montre l’actuelle crise budgétaire que connaît les Nations Unies. Celle-ci non seulement freine le recrutement de nouveau membre du personnel, mais surtout oblige les différents organes à licencier des personnels hautement qualifiés[52]. En effet, les différents organes onusiens, dont les activités dépendent du budget ordinaire des Nations Unies, sont directement affectés par cette crise et n’ont d’autres solutions que de réduire leur personnel. Dans son dernier rapport d’activité, le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie (IIIM) indique : « The Mechanism is operating in an increasingly challenging financial environment, with the current programme budget insufficient to meet the resourcing required to maintain the scope and nature of its work across its structural investigation and respond to the growing demand for its services from competent jurisdictions[53]. »
Le coût plus important des enquêtes n’est pas le seul défi soulevé par le recours aux nouvelles technologies.
II. Les défis soulevés au regard du droit à la vérité
Si le recours aux nouvelles technologies renforce l’efficacité des enquêtes, il comporte deux défis principaux au regard du droit à la vérité : la conservation des preuves recueillies (A) et l’accès à ces preuves (B).
A. La conservation des preuves recueillies
La préservation de ces données pose un certain nombre de difficultés liées à leur nature. Elles peuvent en effet être très facilement altérées, détruites ou retouchées, soit sciemment, soit à la suite de leur récupération initiale, de leur conservation, de leur manipulation ou d’un stockage inapproprié[54]. De même, les preuves issues des réseaux sociaux sont très volatiles. Elles peuvent être supprimées en quelques secondes, soit par leurs auteurs, souvent parce qu’ils sont conscients des risques qu’ils peuvent encourir, notamment dans des contextes de tension démocratique[55] ; soit parce que les entreprises qui hébergent ces données à travers des réseaux comme YouTube ou Meta mettent en place des politiques d’utilisation conduisant à la suppression de preuves sur Internet en cas de non-respect de la législation et/ou de leurs conditions d’utilisation[56].
1. La captation des preuves
La volatilité des données en ligne pose la question de leur recueil et conservation par les enquêteurs, et ce d’autant plus qu’imposer une obligation de conservation des données supprimées à la charge des plateformes du numérique se heurterait à d’autres droits tels que le droit au respect de la vie privée qui lui-même fonde différents droits dérivés : le droit à disposer de ses propres informations, le droit à la rectification et le droit à l’opposition, à l’effacement, au déréférencement ou à l’oubli.
L’« établissement d’urgence » de missions d’enquête, comme le montre l’exemple de la République démocratique du Congo[57], représente un moyen de préserver les preuves disponibles en déployant rapidement une équipe capable de les sauvegarder. Le partage d’informations en grand volume sur Internet a également justifié l’apparition d’un nouveau type de mécanisme d’enquête. Alors qu’en 2011, à la suite des printemps arabes, l’État syrien avait fermé ses frontières pour cacher la répression de sa population, celle-ci a réagi en inondant les réseaux sociaux de vidéos et de photos pour dénoncer la répression qu’elle subissait. Pourtant, malgré la quantité importante de preuves, aucune procédure juridictionnelle n’était alors possible en raison du blocage du Conseil de sécurité. L’Assemblée générale des Nations Unies a alors imaginé un mécanisme d’un nouveau genre : le Mécanisme International, Impartial et Indépendant (MIII). Elle l’a chargée de recueillir et conserver les preuves que la population syrienne partageait sur les réseaux sociaux et en dehors dans l’attente d’éventuelles procédures juridictionnelles[58]. Ce mécanisme a été conçu comme un facilitateur de justice. Son mandat comporte ainsi deux volets : une fonction de collecte et de conservation des preuves et une fonction d’assistance à la justice pénale en préparant des procédures[59]. Le pari de l’Assemblée générale a fonctionné, car le MIII a déjà participé au succès de plusieurs procès dont l’un s’est tenu en France en 2024[60]. Ce modèle a ensuite été repris par le Conseil des droits de l’homme dans la situation au Myanmar. Il a ainsi créé le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM)[61].
Le rôle de la société civile est également essentiel pour décuplée les capacités de recueil des enquêteurs. Celle-ci peut enregistrer les informations mises en lignes et les transmettre ensuite aux enquêteurs. Certaines organisations non gouvernementales ont même vu le jour uniquement pour recueillir et conserver les preuves. C’est le cas de Syrian Archive[62] qui a ensuite inspiré d’autres projets tels que Ukrainian archive[63].
2. La conservation des preuves pendant l’enquête et au-delà
Une fois recueillies, les preuves doivent ensuite être conservées pendant la procédure d’enquête et au-delà. Cette tâche s’avère plus difficile compte tenu de leur nombre important et de leur format numérique, requérant des moyens techniques et coûteux. Cet impératif a conduit à une évolution du mandat des commissions d’enquête. Il intégre dorénavant un nouvel objectif : celui de la conservation des preuves. Le Conseil des droits de l’homme a déjà précisé dans le mandat confié au Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur la situation au Sri Lanka « qu’il importe de préserver et d’analyser les éléments de preuve relatifs aux violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits, et aux infractions connexes, commises à Sri Lanka, en vue de progresser sur la voie de l’établissement des responsabilités »[64]. Par conséquence, il a « décid[é] de renforcer à cet égard les capacités du Haut-Commissariat à collecter, regrouper, analyser et préserver les éléments d’information et de preuve, et à élaborer des stratégies dans la perspective de futures procédures d’établissement des responsabilités en cas de violations flagrantes des droits de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire à Sri Lanka, à défendre les victimes et les survivants, et à appuyer les procédures judiciaires et autres pertinentes, y compris dans les États Membres, auprès de la juridiction compétente »[65].
La conservation des preuves exige des capacités technologiques particulières. Par exemple, pour garantir l’absence de modification des données numériques, très facilement altérables, et une éventuelle utilisation dans de futures procédures judiciaires, il a été nécessaire de trouver de nouveaux moyens de sécurisation de la chaîne de la preuve. Le recours à la fonction « hash », laquelle assigne à chaque donnée numérique une suite binaire qui lui est propre, permet d’y parvenir[66]. En attribuant à chaque donnée un « hash » unique, l’enquêteur lui confère une empreinte numérique unique. Celle-ci garantit que le contenu de la donnée n’a pas été modifié et donc que la chaîne de la preuve a été respectée. D’ailleurs pour éviter toute altération, les enquêteurs ne travaillent jamais sur la « golden copy » mais plutôt sur des copies faites à partir d’elle. Le recours à la fonction « hash » requiert néanmoins des capacités technologiques coûteuses. Plus largement, la conservation des preuves issues des réseaux sociaux suppose des capacités de stockage très importantes comprenant une fonction d’indexation des données pour en faciliter la consultation et l’analyse.
Plus largement, la conservation des preuves se pose également sur une échelle plus longue. Elle doit être possible sur une durée indéterminée afin de conserver une mémoire historique commune[67] et « se prémunir contre le développement d’arguments révisionnistes et négationnistes[68] ». Ici, encore se pose la question des moyens techniques pour réaliser une telle opération sur le long terme tout en veillant à ce que le format dans lequel les données sont préservées soit encore lisible dans les années à venir.
B. L’accès aux preuves devenues des archives
Au regard du droit à la vérité, un second impératif s’impose : la conservation des preuves doit s’accompagner d’une possibilité d’y accéder pendant la période de l’enquête elle-même voire du procès s’il a lieu et même au-delà[69].
1. L’accès aux preuves pendant le temps de l’enquête
L’accès des preuves pendant le temps contemporain de l’enquête oblige à concilier les droits des victimes avec les droits de la défense et les principes directeurs de l’enquête tels que le secret de l’enquête. Si les différentes missions d’enquête collaborent avec les juridictions pénales, il n’est pas certain qu’elles acceptent de le faire avec les équipes de la défense. La demande de communication d’un élément d’information peut certes être présentée auprès du Haut-Commissariat des droits de l’homme. Mais celui-ci ne pourra l’accepter que si cette demande ne porte pas atteinte à un principe essentiel : celui de ne pas risquer de blesser un individu : do no harm. Ce n’est qu’à cette condition que la pièce pourra être communiquée. En outre, dans le cas d’un témoignage, il faudrait en plus obtenir l’accord du témoin. En effet, le consentement qu’il a émis est limité. Il ne vaut qu’au regard de la procédure d’enquête réalisée au sein des Nations Unies[70].
De même, si les mécanismes indépendants remplissent une fonction de facilitateur de justice en vertu de leur mandat[71], ils ne coopèrent qu’avec les juridictions nationales. Leur mandat leur impose en effet un rôle de facilitateur de justice uniquement à l’égard des juridictions. Plus précisément, il leur est demandé de « constituer des dossiers en vue de faciliter et de diligenter des procédures pénales équitables, indépendantes et conformes aux normes du droit international devant des cours ou tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux, qui ont ou auront compétence pour connaître de ces crimes conformément au droit international[72] ». En conséquence, ces mécanismes transmettent aux juridictions des éléments de preuve pour les aider à bâtir leurs dossiers[73]. Le rôle d’intermédiaire joué par les juridictions n’empêche pas en théorie une personne d’obtenir un élément de preuve mais à la condition que sa demande soit transmise aux Mécanismes indépendants par l’intermédiaire d’un juge – ce cas de figure est encore théorique car aucune demande en ce sens n’a été adressée aux Mécanismes.
2. L’accès aux preuves au-delà de l’enquête
L’accès aux données conservées doit également être possible dans un second temps au-delà de la période de l’enquête et même après le procès quand il a lieu. Dans ce cas, l’objectif poursuivi porte sur le devoir de mémoire lié aux crimes de droit international. L’information collectée change alors de statut. De preuve, elle devient une archive.
L’accès aux archives soulève d’autres enjeux. Il est par exemple nécessaire de concilier le droit à la vérité au droit à la sécurité et à la vie privée des personnes concernées. Un accès pourrait tout de même être organisé de manière limitée. Il serait possible par exemple d’accorder l’accès à l’archive en fonction d’une classification des documents au regard de la sensibilité des informations qu’ils contiennent ou de créer des versions expurgées et anonymisées des archives – pratique adoptée par le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux Pénaux[74].
* * *
L’enquête est progressivement devenue un outil essentiel à l’exercice du droit à la vérité au sein des organisations internationales en permettant d’établir les faits constitutifs de violations massives et/ou systématique des droits humains. Le développement des nouvelles technologies et des techniques d’enquête en open source en a renforcé l’efficacité. Cependant, l’utilisation de ces « nouvelles preuves » nécessite de concilier plusieurs droits. Le droit à la vérité peut ainsi se heurter aux droits de la défense ainsi qu’au droit au respect de la vie privée des personnes concernées par ces preuves que ce soit au moment du recueil ou de la conservation de la preuve. Les mécanismes d’enquête tentent d’y répondre en employant une méthodologie de plus en plus rigoureuse et en s’appuyant sur des services spécialisés qui permettent d’harmoniser les pratiques. Ce mouvement risque toutefois d’être ralenti par les difficultés budgétaires au sein des Nations Unies.
[1] Sur la notion de la procédure de session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme, voir notamment M. Tabbal, Les sessions extraordinaires du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Paris, Éditions Institut Universitaire Varenne, Collection des Thèses, n° 164, 2018, 726 pages. L’auteur souligne le nombre important de commissions d’enquête créées lors des sessions extraordinaires du Conseil des droits de l’homme (spéc. pp. 337-380 et pp. 526-540). L’enquête apparaît ainsi comme un remède aux situations de violations systématiques des droits de l’homme.
[2] Conseil des droits de l’homme, Lettre datée du 3 février 2025, adressée au Président du Conseil des droits de l’homme par le Représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, 5 février 2025, Nations Unies, doc. A/HRC/S-37/1.
[3] Conseil des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme dans l’est de la République démocratique du Congo, résolution adoptée le 7 février 2025, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/S-37/1, § 1.
[4] Ibid. Nous souhaitons rappeler que la situation en République Démocratique du Congo a déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes : l’Équipe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï, mandatée par le Conseil des droits de l’homme (Assistance technique et renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme en République démocratique du Congo, résolution adoptée le 7 octobre 2020, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/45/34), dont le mandat a été renouvelé en 2021 par consensus (Assistance technique et renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme en République démocratique du Congo, résolution adoptée le 11 octobre 2021, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/48/20) et en 2023 également par consensus (Assistance technique et renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme en République démocratique du Congo, résolution adoptée le 12 octobre 2023, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/54/34). Le Conseil des droits de l’homme avait préalablement institué une mission d’enquête sous le même nom en 2017 (Assistance technique à la République démocratique du Congo et établissement des responsabilités concernant les événements dans les régions du Kasaï, résolution adoptée le 23 juin 2017, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/35/33) et en 2018 (Assistance technique à la République démocratique du Congo et établissement des responsabilités concernant les événements dans la région du Kasaï, résolution adoptée le 6 juillet 2018, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/38/20) – toutes les deux ont également été adoptées par consensus.
[5] Conseil des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme dans l’est de la République démocratique du Congo, résolution adoptée le 7 février 2025, précité, § 17.
[6] Ibid., § 18.
[7] Pour plus de détails sur l’histoire de la technique d’enquête, voir T. Ben Salah, L’enquête internationale dans le règlement des conflits, Règles juridiques applicables, Paris, LGDJ, Collection Bibliothèque de droit international, vol. 79, 1976, 269 pages, spéc. p. 15 et seq.
[8] Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, adoptée par la Conférence internationale de la Paix à La Haye le 29 juillet 1899, article 9 et Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux adoptée par la Conférence internationale de la Paix à La Haye le 18 octobre 1907, article 9.
[9] Assemblée générale, Déclaration concernant les activités d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales, résolution adoptée le 9 décembre 1991, Nations Unies, doc. A/RES/46/59. Voir également A. Berg, « The 1991 Declaration on Fact-finding by the United Nations », European Journal of International Law, vol. 4(1), 1993, pp. 107-114.
[10] Nous souhaitons préciser que nous nous référerons dans la suite du propos aux enquêtes sous la dénomination de « commissions d’enquête ». Cette dénomination est utilisée dans cette étude de manière générique. Elle englobe les différentes appellations des commissions d’enquête : groupe d’Experts, missions d’enquête, etc.
[11] La liste des commissions d’enquête établies par le Conseil de sécurité est disponible au lien suivant : https://main.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/commissions-and-investigative-bodies. À noter que le Conseil de sécurité ne se fonde que très rarement sur l’article 34 de la Charte des Nations Unies lorsqu’il décide de la création d’une commission d’enquête. Plus récemment, le Conseil de sécurité a développé la pratique de demander au Secrétaire général de créer une commission d’enquête.
[12] L’Assemblée générale a créé des commissions d’enquête pour se tenir informée, par exemple en 1973, elle a créé la commission d’enquête sur les massacres signalés au Mozambique (Création de la Commission d’enquête sur les massacres signalés au Mozambique, résolution adoptée le 12 décembre 1973, Nations Unies, doc. 3114 (XXVIII)). Plus récemment, elle a créé le Mécanisme international, impartial et indépendant sur la Syrie en 2016 (Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables, résolution adoptée le 21 décembre 2016, Nations Unies, doc. A/RES/71/248). La liste des commissions d’enquête est disponible sur le site du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.
[13] Le Secrétaire général en a également créé plusieurs, par exemple en 2018 la commission d’enquête sur le Mali (à cet égard, voir Conseil de sécurité, Letter dated 19 January 2018 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, 23 janvier 2018, Nations Unies, doc. S/2018/57), en 2010 le groupe d’Experts sur le Sri Lanka (Secrétaire général, Secretary-General Names Panel of Experts to Advise on Accountability for Possible Rights Violations during Sri Lanka Conflict, 22 juin 2010, Nations Unies, doc. SG/SM/12967) ou encore en 2009 la Commission internationale d’enquête sur la Guinée (Secrétaire général, International commission of Inquiry on Guinea, 28 octobre 2009, Nations Unies, doc. S/2009/556). La liste des commissions d’enquête est disponible sur le site du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.
[14] Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a aussi créé de nombreuses commissions d’enquête telles que la mission au Bangladesh pour interviewer les Rohingyas qui étaient entrés au Bangladesh depuis le nord de l’État de Rakhine (Myanmar) à la suite des événements du 9 octobre 2016. La liste des commissions d’enquête est disponible sur le site du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.
[15] La Commission des droits de l’homme avait institué six commissions d’enquête. En 2025, le Conseil des droits de l’homme en a déjà créé 42 commissions d’enquête. La liste est disponible aux liens suivants : https://www.ohchr.org/fr/hr-bodies/hrc/ffm-drc/index et https://libraryresources.unog.ch/c.php?g=462695&p=3162812 ; Sur la pratique du Conseil des droits de l’homme, voir l’étude de M. Tabbal, Les sessions extraordinaires du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, op. cit., p. 338 et seq. ; voir également en ce sens I. Lassée, Les missions d’établissement des faits des Nations Unies sur les violations graves du droit international humanitaire ou massives des droits de l’homme, Paris, Éditions Institut Universitaire Varenne, LGDJ, Collection des Thèses, 2017, 654 pages, spéc. pp. 38-42 et pp. 49-56.
[16] Pour plus de détails sur l’extension du mandat des commissions d’enquête, voir la thèse d’I. Lassée, Les missions d’établissement des faits des Nations Unies sur les violations graves du droit international humanitaire ou massives des droits de l’homme, op cit., p. 597.
[17] Voir en ce sens l’ouvrage dirigé par O. de Frouville et P. Sturma (dir.), Vers la pénalisation des droits de l’homme ?, Paris, Éditions A. Pedone, 2022, 454 pages, notamment la contribution de P. Sturma, « L’influence de la criminalisation de l’établissement des faits sur la preuve recherchée par les missions d’enquête », pp. 393-406.
[18] Sur la définition du droit à la vérité, voir la contribution de Mme M. Eudes dans le présent dossier.
[19] Pour la pratique des Nations Unies, voir notamment M. Bergsmo (dir.), Quality control in Fact-Finding, Florence, Éditions Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2013, 478 pages ; M.C. Bassiouni et C. Abraham (dir.), Siracusa Guidelines for International, Regional and National Fact-Finding Bodies, Cambridge/Antwerp/Portland, Éditions Intersentia, 2013, 178 pages ; R. Grace et C. Bruderlein (dir.), Practitioner’s handbook on monitoring, reporting, and fact-finding, Investigating international law violations, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 334 pages ; Tabbal, Les sessions extraordinaires du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, op. cit, spéc. pp. 337-380 et pp. 526-540 ; I. Lassée, Les missions d’établissement des faits des Nations Unies sur les violations graves du droit international humanitaire ou massives des droits de l’homme, op. cit.
[20] Pour plus de détails sur les Principes Joinet, voir la contribution de Mme M. Eudes dans le présent dossier.
[21] Voir en ce sens L. Trigeaud, « L’influence des principes généraux de la procédure pénale sur les méthodes de travail des commissions d’enquêtes internationales », in O. de Frouville et P. Sturma (dir.), Vers la pénalisation du droit international des droits de l’homme ?, op cit., p. 372 et seq.
[22] Pour plus de détails, voir S. Jamal, « L’influence de la criminalisation de l’établissement des faits sur la preuve recherchée par les missions d’enquête », in O. de Frouville et P. Sturma (dir.), Vers la pénalisation du droit international des droits de l’homme ?, op cit., p. 393 et seq.
[23] C. Stahn et D. Jacobs, « The interaction between Human Rights Fact-Finding and International Criminal Proceedings : Toward a (New) Typology », in P. Alston et S. Knuckey (dir.), The transformation of human rights fact-finding, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 255–280, spéc. p. 259.
[24] Conseil des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme au Bélarus à la veille et au lendemain de l’élection présidentielle de 2020, résolution adoptée le 24 mars 2021, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/46/20, § 13 (a). Voir également dans le même sens le mandat de la commission d’enquête sur le territoire palestinien-Israël (Conseil des droits de l’homme, Veiller au respect du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, résolution du 27 mai 2021, Nations Unies, doc. A/HRC/S-30/L.1, § 2 b) ou le mandat de la mission indépendante d’établissement des faits en Lybie (Conseil des droits de l’homme, Assistance technique et renforcement des capacités aux fins de l’amélioration de la situation des droits de l’homme en Libye, résolution du 22 juin 2020, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/43/39, § 43 a) et plus récemment la commission d’enquête sur l’Ukraine (Conseil des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme en Ukraine à la suite de l’agression russe, résolution adoptée le 4 mars 2022, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/49/1).
[25] Voir en ce sens les derniers mandats : Conseil des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme dans l’est de la République démocratique du Congo, résolution adoptée le 7 février 2025, précité, § 17 b ou Conseil des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme en Ukraine à la suite de l’agression russe, résolution adoptée le 4 mars 2022, précité, § 11 b.
[26] Par exemple le mandat de la mission d’enquête internationale indépendante sur la République islamique d’Iran ne mentionne que la recherche des violations de droits de l’homme : « Mener une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de violations des droits de l’homme commises en République islamique d’Iran, en particulier contre des femmes et des enfants, dans le contexte des manifestations qui ont débuté le 16 septembre 2022 » (Conseil des droits de l’homme, Détérioration de la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants, résolution du 24 novembre 2022, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/S-35/1, § 7 a).
[27] Par exemple le mandat du groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua remonte aux « violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises au Nicaragua depuis avril 2018 » (Conseil des droits de l’homme, Promotion et protection des droits de l’homme au Nicaragua, résolution du 31 mars 2022, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/49/3), alors que le mandat de la mission d’enquête internationale indépendante sur la République islamique d’Iran est plus limité puisqu’il concerne « les allégations de violations des droits de l’homme commises en République islamique d’Iran, en particulier contre des femmes et des enfants, dans le contexte des manifestations qui ont débuté le 16 septembre 2022 » (Conseil des droits de l’homme, Détérioration de la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants, résolution du 24 novembre 2022, précité, § 7 a).
[28] Voir par exemple le mandat de la commission d’enquête sur l’Ukraine : Conseil des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme en Ukraine à la suite de l’agression russe, résolution adoptée le 4 mars 2022, précité, § 11 b ou le mandat du groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua : Conseil des droits de l’homme, Promotion et protection des droits de l’homme au Nicaragua, résolution du 31 mars 2022, précité, § 14 a.
[29] Voir par exemple Conseil des droits de l’homme, Détérioration de la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants, résolution du 24 novembre 2022, précité, § 7 a.
[30] Voir par exemple Conseil des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme en Ukraine à la suite de l’agression russe, résolution adoptée le 4 mars 2022, précité, § 11 a.
[31] Voir par exemple le mandat du groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua : Conseil des droits de l’homme, Promotion et protection des droits de l’homme au Nicaragua, résolution du 31 mars 2022, précité, § 14 a.
[32] Voir en ce sens Organisation des Nations Unies, Commissions d’enquête et missions d’établissement des faits sur le droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire international. Orientations et pratiques, New York et Genève, Nations Unies, doc. HR/PUB/14/7, 2015, 152 pages.
[33] Voir par exemple Conseil des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme en Ukraine à la suite de l’agression russe, résolution adoptée le 4 mars 2022, précité, § 11 b ou Conseil des droits de l’homme, Promotion et protection des droits de l’homme au Nicaragua, résolution du 31 mars 2022, précité, § 14 b.
[34] Voir par exemple Conseil des droits de l’homme, La situation au Kasaï, rapport de l’Équipe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï, 3 juillet, Nations Unies, doc. A/HRC/38/31, § 9.
[35] Nous nous appuyons sur les observations que nous avons réalisées dans le cadre d’une recherche sur la participation des individus à l’enquête en droit international à travers les réseaux sociaux financée par l’IERDJ (S. Jamal et M. Obidzinski (dir.), La participation des individus à l’enquête en droit international à travers les réseaux sociaux, Paris, Éditions IERDJ, Collection Rapports de recherche, n° 21.53, mai 2025, 212 pages).
[36] V. Ndior et E. Netter, États et réseaux sociaux, Contrôler le discours en ligne, Paris, LGDJ, 1ère éd., 2024, 266 pages, spéc. p. 169.
[37] Voir par exemple l’initiative de Syrian Archive au lien suivant : https://syrianarchive.org/en/investigations.
[38] Voir par exemple Assemblée générale, Rapport de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, 11 septembre 2024, Nations Unies, doc. A/79/232, § 3 ou Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête sur l’Ukraine, 11 mars 2025, Nations Unies, doc. A/HRC/58/67, § 3.
[39] Voir par exemple Assemblée générale, Rapport de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, précité, § 3.
[40] Organisation des Nations Unies, Commissions d’enquête et missions d’établissement des faits sur le droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire international. Orientations et pratiques, précité.
[41] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et Human Rights Center de la faculté de droit de l’Université de Californie, Protocole de Berkeley sur l’utilisation de sources ouvertes numériques dans les enquêtes, Guide pratique pour l’utilisation efficace des informations issues de sources ouvertes numériques dans les enquêtes sur les violations du droit pénal international, du droit international des droits humains et du droit international humanitaire, New York et Genève, Nations Unies, doc. HR/PUB/20/2, 3 janvier 2022.
[42] Conseil des droits de l’homme, Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014, Detailed findings of the Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen, 29 septembre 2020, Nations Unies, doc. A/HCR45/CRP.7, § 17 : « grâce aux meilleures pratiques des méthodes analytiques open source actuelle » [traduction libre].
[43] Assemblée générale, Rapport de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, précité, § 3.
[44] Organisation des Nations Unies, Commissions d’enquête et missions d’établissement des faits sur le droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire international. Orientations et pratiques, précité, p. 66.
[45] Assemblée générale, Rapport de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, précité, § 3.
[46] Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Évaluation du projet visant à renforcer la capacité du HCDH à soutenir les organismes d’enquête, rapport d’évaluation du juillet 2023, p. 5.
[47] Ibid., p. 20.
[48] Ibid., : « L’unité vise à soutenir les bureaux internationaux et les présences sur le terrain du Haut-Commissariat dans l’application des nouvelles technologies dans les domaines de la criminalistique numérique, des enquêtes sur la blockchain, de la découverte électronique, des enquêtes open source et du traitement des preuves numériques » [traduction libre].
[49] Ibid.
[50] Éric Baccard, ancien directeur de cette unité, explique le fonctionnement de cette unité aux juges (CPI, Chambre de première instance I, Situation en République de Côte d’Ivoire, affaire le Procureur c. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé, comptes-rendus d’audience du 11 octobre 2017, doc. ICC–02/11–01/15, pp. 4-5). Cette unité « s’occupe des questions scientifiques relatives aux preuves numériques collectées via des ordinateurs, par exemple des données qui peuvent être trouvées sur Internet ou sur les réseaux sociaux » [traduction libre].
[51] Voir l’objectif n° 3 dans CPI, Plan stratégique du Bureau du procureur 2023-2025, 2023, disponible sur le site internet de la CPI, p. 14.
[52] Hosung Ahn, « Clock’s Ticking: What Does International Law Have to Do with the UN’s Liquidity Crisis? », European Journal of International Law, 30 mai 2024, disponible sur le site internet de EJIL:Talk!
[53] Assemblée générale, Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables, rapport du MIII, 14 février 2024, Nations Unies, doc. A/78/772, pp. 5-6 : « Le Mécanisme opère dans un environnement financier de plus en plus difficile, le budget actuel du programme étant insuffisant pour fournir les ressources nécessaires au maintien de la portée et de la nature de ses travaux dans le cadre de son enquête structurelle et pour répondre à la demande croissante de ses services de la part des juridictions compétentes [traduction libre]. » Voir également, dans le même sens, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête sur l’Ukraine, 11 mars 2025, précité, § 3.
[54] E. Scott, « Open Source Investigations for Human Rights. Current and Future Challenges », in S. Dubberley, A. Koenig et D. Murray (dir.), Digital Witness: Using Open-Source Information for Human Rights Investigation, Documentation, and Accountability, Oxford, Oxford University Press, 2019, pp. 87-104.
[55]Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des medias, Social media: social threads or threats to human rights?, rapport du Rapporteur José Cepeda, Conseil de l’Europe, doc. 14184, 19 mars 2019, 21 pages.
[56] Voir en ce sens, META, Corporate Human Rights Policy, disponible sur https://about.fb.com// (dernière consultation le 8 septembre 2024). Voir C. Botero Marino, « Le conseil de surveillance de META: le regard du praticien », in S. Jamal et J. Tous (dir.), Réseaux sociaux et droits de l’homme : quel(s) droit(s) pour quelle protection ?, Paris, Éditions A. Pedone, 2024, pp. 25-46. Voir aussi N. Hernandez et W. Carazo Mendez, « L’émergence d’un nouveau garant privé de la liberté d’expression ? le cas du conseil de surveillance de Facebook », in S. Jamal et J. Tous (dir.), Réseaux sociaux et droits de l’homme : quel(s) droit(s) pour quelle protection ?, précité, pp. 73-102, spé. p. 77.
[57] Voir supra. Introduction.
[58] Assemblée générale, Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables, résolution adoptée le 21 décembre 2016, précité.
[59] Pour plus de détails, voir S. Jamal, « Mécanismes d’enquête indépendants : Une nouvelle forme d’enquête » in D. Rebut, J. Fernandez et O. de Frouville (dir.), Permanence et renouveau de la justice pénale internationale – Septièmes journées de la justice pénale internationale, Paris, Éditions A. Pedone, 2023, pp. 157-174.
[60] Human Rights Watch, « Des responsables syriens condamnés pour crimes contre l’humanité en France », 27 mai 2024, disponible en ligne.
[61] Conseil des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme des musulmans rohingyas et d’autres minorités du Myanmar, résolution adoptée le 25 septembre 2018, Nations Unies, doc. A/HRC/39/L.22. Nous pouvons également inclure dans cette catégorie l’équipe d’enquête des Nations Unies chargée de promouvoir la responsabilité pour les crimes commis par Daech/EIIL (UNITAD). Celle-ci a été instituée par le Secrétaire général à la demande du Conseil de sécurité, après une demande du gouvernement irakien de recevoir l’assistance de la communauté internationale pour poursuivre et juger les membres de Daesh qui ont commis des crimes internationaux. Cette mission d’enquête assure ainsi une fonction d’aide à l’enquête.
[62] Pour plus de détails, voir leur site internet au lien suivant : https://syrianarchive.org/.
[63] Pour plus de détails, voir leur site internet au lien suivant : https://ukrainianarchive.org/en/.
[64] Conseil des droits de l’homme, Favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités et promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka, résolution adoptée le 23 mars 2021, Nations Unies, doc. A/HRC/46/L.1/Rev.1, § 6.
[65] Ibid.
[66] Voir H. Shaimaa et J. G. Ghazwh, « Digital Signature Based on Hash Functions », International Journal of Advancement In Engineering Technology, Management and Applied Science, vol. 4(1), 2017, pp. 88-99. Voir également Sénat (France), Comprendre les blockchains : fonctionnement et enjeux de ces nouvelles technologies, rapport n° 584 déposé le 20 juin 2018, 209 pages.
[67] Commission des droits de l’homme, Promotion et protection des droits de l’homme, Impunité, rapport de l’experte indépendante chargée de mettre à jour l’Ensemble de principes pour la lutte contre l’impunité, Mme Diane Orentlicher, adopté le 8 février 2005, Nations Unies, doc. E/CN.4/2005/102, et l’additif Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, adopté le 8 février 2005, Nations Unies, doc. E/CN.4/2005/102/Add.1.
[68] Ibid. Voir également D. Groome, « The Right to the Truth in the Fight Against Impunity », Berkeley Journal of International Law, vol. 29(1), 2011, pp. 175-199, spec. p. 181.
[69] Nous souhaitons remercier Mme W. Carazo-Mendès, membre de l’équipe de recherche sur la participation des individus à l’enquête en droit international à travers les réseaux sociaux pour son concours dans nos recherches.
[70] Nous nous fondons sur les entretiens réalisés dans le cadre d’une recherche sur la participation des individus à l’enquête en droit international à travers les réseaux sociaux financée par l’IERDJ (S. Jamal et M. Obidzinski (dir.), La participation des individus à l’enquête en droit international à travers les réseaux sociaux, précité). Pour plus de détails, voir la contribution de Mme P. Canavaggio dans le présent dossier.
[71] Cette expression est tirée du 5ème rapport du MIII et reprise ensuite dans chacun des rapports suivants (Assemblée générale, Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables, rapport du MIII, 13 février 2020, Nations Unies, doc. A/74/699, p. 14, § 50).
[72] Assemblée générale, Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables, résolution adoptée le 21 décembre 2016, précité, § 4 ; Voir également dans le même sens Conseil des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme des musulmans rohingyas et d’autres minorités du Myanmar, résolution adoptée le 25 septembre 2018, Nations Unies, doc. A/HRC/39/L.22, § 22.
[73] Voir par exemple IIIM Syria, Report on 2024 results, Genève, Nations Unies, doc. IIIM/2024/5/iPub, 2025, 17 pages, spéc. p. 6.
[74] Secrétaire général, Tribunaux pénaux internationaux : classification, maniement et consultation des documents et informations sensibles, circulaire du 20 juillet 2012, Nations Unies, doc. ST/SGB/2012/3. Voir également Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, Politique d’accès aux documents conservés par le mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, politique révisée du 4 janvier 2019, Nations Unies, doc. MICT/17/Rev.1.
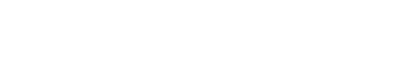

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
