Sans revenir en détail sur la carrière et l’œuvre de Louis Joinet[1], il convient de souligner que la richesse de la première explique la diversité et la portée de la seconde. En effet, la formation de magistrat de l’intéressé, ainsi que son expérience de terrain en France ou lors de missions internationales, que ce soit pour la Fédération internationale pour les droits humains ou pour la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies[2], lui ont certes procuré des idées, et la possibilité de les mettre en œuvre, mais également une vision pragmatique des problèmes. L’efficacité de cette démarche est notamment illustrée par la postérité des Principes Joinet, du nom du rapport qu’il fit adopter par la même Sous-Commission onusienne en 1997, au terme de 6 ans de réflexion[3]. Alors que, formellement, il ne s’agit que d’un simple texte de soft law, ce document a considérablement influencé les travaux onusiens ultérieurs sur le thème de la lutte contre l’impunité. Ce sont finalement toutes les réflexions doctrinales, voire les pratiques de certains États, qui s’en inspirent aujourd’hui[4]. Le modèle proposé par Louis Joinet a toutefois été mis à jour en 2005 par l’experte indépendante Diane Orentlicher dont il faut souligner l’hommage appuyé qu’elle a rendu à la qualité et à la pertinence des Principes de 1997[5]. Ces derniers sont en effet uniquement complétés « à la lumière des faits nouveaux récents intervenus dans le droit international et la pratique »[6]. Il s’est donc agi de refléter, grâce à la reformulation de divers principes, certaines bonnes pratiques étatiques ainsi que des solutions dégagées par la jurisprudence, internationale et nationale, sans remettre en cause, donc, la logique d’ensemble qui avait été proposée par Louis Joinet.
Intitulé Ensemble des principes pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, le rapport de 1997 évoque ainsi quatre piliers, désormais bien connus, de la justice transitionnelle[7]. Cette dernière désigne, selon les mots du Secrétaire général des Nations Unies Koffi Annan, « l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation […][8] ». Louis Joinet évoque alors quatre piliers permettant de fonder cette lutte contre l’impunité, devenue une priorité affichée de la communauté internationale à partir des années 1990[9] : il s’agit du droit de savoir, du droit à la justice, du droit à la réparation et des garanties de non-répétition des violations[10]. La lecture des 42 Principes Joinet et de l’introduction qui les précède est limpide et accessible, y compris pour des non-juristes. De plus, la présentation en quatre piliers est un choix qui s’est révélé être aussi pédagogue que convaincant : tout lecteur peut immédiatement en saisir le sens général. Plus substantiellement, il est notable que les victimes soient placées au cœur du dispositif, avec un texte débutant par l’énoncé d’un droit de savoir. Celui-ci est toujours réclamé par les victimes, leurs proches et les défenseurs des droits humains confrontés à des régimes autoritaires puis à une chape de plomb posée sur les crimes du passé, silence souvent renforcé par l’adoption de lois d’amnistie.
Si les quatre piliers de la justice transitionnelle sont tout à fait complémentaires, la présente contribution ne porte que sur le premier, le droit de savoir. Il convient de l’étudier à la lumière du contenu et de la postérité des propositions formulées par Louis Joinet dès 1997. À cet égard, peuvent être envisagées d’abord, les implications, individuelles et collectives, de ce droit de savoir (I) ; ensuite, la diversité des moyens visant à assurer son effectivité (II).
I. Du droit de savoir des victimes individuelles au droit à la vérité au profit de la collectivité
La première revendication des victimes d’exactions et de leurs proches est de savoir comment se sont déroulés les événements, ce que sont devenus leurs proches disparus, les modalités de commission des crimes et l’identité de leurs auteurs. Ce premier aspect, individuel, est assez aisé à comprendre (A) mais le second, touchant plus largement l’ensemble de la communauté affectée, est plus complexe à appréhender (B)[11].
A. Un volet individuel immédiatement saisissable
Le droit de savoir des victimes et de leurs proches a connu plusieurs consécrations. Inscrit dès 1977 dans le droit international humanitaire comme le droit des familles de connaître le sort de leurs proches disparus pendant un conflit armé[12], il a ensuite été au cœur de la Déclaration de 1992 puis de la Convention internationale de 2006 sur les disparitions forcées[13]. On le retrouve également dans diverses décisions des organes de protection des droits humains consacrées à ce fléau, qu’il s’agisse de mécanismes onusiens ou des juridictions régionales[14]. Il en résulte notamment, de manière très concrète, le droit des individus de connaître la vérité sur les circonstances d’une disparition, le déroulement et les résultats de l’enquête diligentée à ce sujet ainsi que le sort de la personne disparue. Tout ceci implique que les autorités nationales mettent en œuvre leurs obligations positives, à commencer par celle d’enquêter sérieusement et avec diligence sur les allégations portées contre elles.
Affirmer pour autant qu’il existerait aujourd’hui un droit à la vérité qui pourrait être mobilisé par tous et en toute circonstance est excessif. En effet, aucune convention généraliste, à vocation universelle ou régionale, ne garantit explicitement un tel droit. Au-delà de plusieurs textes purement déclaratoires du Conseil des droits de l’homme ou de l’Assemblée générale des Nations Unies[15], de jurisprudences très circonstanciées des cours régionales[16] ou encore des travaux du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition[17], il est prématuré de parler de la cristallisation d’une norme coutumière internationale autour du droit à la vérité. En 1997 comme en 2005, les Principes Joinet n’évoquent d’ailleurs l’existence du droit de savoir que dans les cas de décès ou de disparition forcée[18]. Ils soulignent également le fait que « le droit à la vérité peut être défini différemment dans certains systèmes juridiques, comme le droit de savoir, le droit d’être informé ou la liberté d’information ». La notion n’est donc pas si consensuelle que ce que l’on aurait pu l’imaginer.
Ce constat, s’il peut décevoir, est somme toute compréhensible au regard du caractère équivoque de la notion même de vérité. Quelle serait la vérité requise par le droit international (une vérité factuelle, historique, socialement située) ? Qui seraient les bénéficiaires de cette norme (les victimes directes, indirectes, les témoins ?) et leurs débiteurs (les États, tous les auteurs d’exactions) ? La vérité énoncée dans un rapport d’enquête indépendant serait-elle prise en compte ? Ou seule la vérité judiciaire (avec toutes les limites qu’elle comporte) serait-elle considérée comme pertinente ? Outre le débat classique sur l’écart entre vérité historique et vérité judiciaire, il convient d’évoquer le décalage entre celle issue d’un procès tenu dans la tradition romano-germanique (autour d’une vérité substantielle notamment dégagée de la phase de l’instruction) et celle résultant d’un procès dans le système anglosaxon (avec une vérité portant surtout sur la crédibilité accordée aux témoins par le jury)[19].
Par ailleurs, les Principes Joinet de 1997 sont visionnaires en ce qu’ils envisagent les victimes comme des sujets de droit à part entière[20]. À l’époque en effet, elles sont peu prises en compte dans le déroulement des procédures internationales, que ce soit au plan judiciaire ou autre. On sait qu’elles deviendront ensuite des acteurs de la répression pénale internationale des crimes les plus graves et même les bénéficiaires d’une éventuelle réparation financière. Il suffit ici de renvoyer aux avancées réalisées dans le cadre de la Cour pénale internationale, des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et des Chambres africaines extraordinaires[21]. Si elles connaissent certes des limites, ces évolutions témoignent tout de même d’une prise en compte des victimes qui est désormais récurrente dans toutes les réflexions sur les réponses à apporter aux crimes du passé.
B. Un volet collectif difficile à identifier
Outre le droit de savoir au bénéfice des victimes, le Rapport Joinet évoque aussi « un droit collectif qui trouve son origine dans l’histoire pour éviter qu’à l’avenir les violations ne se reproduisent. Il a pour contrepartie, à la charge de l’État, le ‘devoir de mémoire’ afin de se prémunir contre ces détournements de l’histoire qui ont pour nom révisionnisme et négationnisme; en effet, la connaissance, par un peuple, de l’histoire de son oppression appartient à son patrimoine et comme telle doit être préservée. Telles sont les finalités principales du droit de savoir en tant que droit collectif »[22]. Le contenu et la portée de cette logique, caractérisée par son bon sens et sa légitimité, méritent toutefois d’être précisés.
Ainsi, le Principe 1 affirme-t-il que « chaque peuple a le droit inaliénable de connaître la vérité sur les événements passés ». Cette affirmation, si forte soit-elle, ne peut être que symbolique pour deux raisons : la première tient à la difficulté récurrente des systèmes juridiques à appréhender la notion de peuple ; la seconde porte sur l’impossibilité de garantir l’existence et la justiciabilité de ce droit de savoir au profit d’un peuple tout entier.
Le principe 2 évoque quant à lui un « devoir de mémoire » à la charge de l’État, mais sans en identifier les contours ni le contenu. Il est vrai que cette idée est assez nouvelle à l’époque. En France et dans la plupart des États, les lois dites mémorielles ne sont pas encore à l’ordre du jour en 1997[23]. Depuis lors, cette logique s’est beaucoup affirmée et précisée, en particulier grâce au rapport de Fabián Salvioli présenté en 2020 sur les processus de mémorialisation dans le contexte des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire, processus parfois assimilé à un cinquième pilier de la justice transitionnelle[24]. La formule « devoir de mémoire » utilisée en 1997 est toutefois floue et la version révisée des Principes Joinet en 2005 permet de préciser ce qui est véritablement attendu des autorités nationales. Le texte évoque ainsi leur « devoir de conserver les archives et les autres éléments de preuve se rapportant aux violations des droits de l’homme et du droit humanitaire et de contribuer à faire connaître ces violations »[25]. Le devoir de mémoire au profit de la collectivité touchée par des exactions implique donc des actions positives, lesquelles peuvent être abordées parallèlement aux moyens de mise en œuvre du droit individuel de savoir des victimes.
II. La diversité des moyens visant à garantir l’effectivité du droit à la vérité
Dès 1997, Louis Joinet proposait des pistes concrètes pour rendre opérationnel le droit de savoir ou droit à la vérité. Son rapport souligne ainsi que « Lorsque les institutions judiciaires sont défaillantes, priorité doit être donnée, dans un premier temps, aux mesures tendant d’une part à la création de commissions non judiciaires d’enquête, d’autre part à la préservation et à l’accès aux archives concernées »[26]. Ces deux aspects méritent d’être étudiés successivement, tout en soulignant que la révision du texte en 2005 a permis de mettre l’accent sur la possible concomitance des procédures judiciaires et non judiciaires (A), ainsi que la nécessité, quelle que soit la solution choisie, de toujours préserver les archives pertinentes (B)[27].
A. La mise en place de commissions d’enquête ou de « commissions vérité »
En 1997, les Principes Joinet 5 à 12 détaillent le rôle et les caractéristiques attendues de commissions non judicaires d’enquête à mettre en place après des violations massives ou systématiques des droits humains. Un établissement objectif, complet et public des faits est attendu de ces organes, qui doivent présenter des gages d’indépendance et d’impartialité pour être considérés comme pleinement légitimes. De plus, certaines garanties de protection des victimes et témoins, ainsi que des personnes mises en cause, sont également envisagées[28]. Ces diverses qualités institutionnelles et procédurales sont précisées dans le texte révisé de 2005.
Ce dernier commence d’ailleurs par utiliser une terminologie plus large : au-delà des commissions d’enquête, il évoque en effet des « commissions vérité »[29] afin de refléter une pratique qui s’est beaucoup développée depuis 1997. Ces « organes officiels, temporaires et non judiciaires chargés d’établir les faits, […] enquêtent sur un ensemble d’atteintes aux droits de l’homme ou au droit humanitaire généralement commis au cours d’un certain nombre d’années »[30]. Ils fonctionnent autour du principe central de la participation des victimes et même de l’ensemble des citoyens, y compris les anciens bourreaux, au processus d’établissement des faits[31]. Cette méthode impliquant la prise en compte des témoignages de toutes les parties prenantes vise ainsi un deuxième objectif, à savoir la facilitation de la réconciliation nationale.
Aussi utiles qu’elles soient dans l’établissement des faits, ces commissions ne peuvent jamais avoir pour vocation de remplacer le travail des juges[32]. Le nouveau Principe 7 énonce ainsi que « le mandat des commissions doit être clairement défini et doit respecter le principe selon lequel les commissions n’ont pas vocation à se substituer à la justice, tant civile ou administrative que pénale. Ainsi, seuls les tribunaux pénaux sont compétents pour établir la responsabilité individuelle pénale en vue de se prononcer, le cas échéant, sur la culpabilité puis sur la peine ». Les logiques judiciaire et non judiciaire sont donc conçues comme complémentaires et non interchangeables. Certains gouvernements ont malheureusement pu détourner ou instrumentaliser le processus, en mettant en place des commissions (parfois sans moyens véritables ou composées de membres non indépendants et impartiaux) au lieu et place de poursuites pénales qui auraient pu mener à la condamnation des anciens bourreaux[33]. Dans ce type de situation, il est probable que l’absence de sanction pénale aboutisse à plus ou moins long terme à la répétition des exactions du passé. Du reste, même lorsque des commissions de qualité effectuent correctement leur travail, le résultat de leurs travaux ne sera jamais aussi satisfaisant, en termes de lutte contre l’impunité, que cette solution judiciaire[34].
En tout état de cause, les divers organes mis en place pour faire face aux crimes du passé doivent être pensés en concertation avec les populations concernées. L’objectif ici n’est pas d’imposer un modèle type, mais bien de consulter les victimes et l’ensemble de la société sur la solution idoine et l’institution la plus adaptée pour établir les faits au mieux et pour faciliter une réconciliation nationale. Concrètement, il s’agit en particulier d’éviter l’importation de modèles étrangers au profit de solutions réfléchies au plan national, ce qui suppose par exemple de mener des consultations publiques[35].
La réussite du travail des commissions suppose également de prendre en compte la situation et la voix des femmes et des membres de groupes minoritaires[36]. Cela signifie qu’une certaine vigilance doit s’imposer vis-à-vis de ces catégories souvent surreprésentées parmi les victimes sans pour autant que les crimes spécifiques qu’elles ont subis (qu’il s’agisse de violences sexuelles ou de discriminations systémiques par exemple) soient suffisamment connus et pris en compte[37].
B. La préservation et l’accès aux archives permettant d’établir les violations
La notion d’archives renvoie à un corpus souvent disparate et éclaté, particulièrement à la suite d’un conflit armé ou d’une période de dictature. Elle renvoie à l’ensemble des documents, quel que soit leur support, qui sont produits par des personnes morales ou physiques dans l’exercice de leur activité[38]. Les archives sont donc très diverses, pouvant être publiques ou privées, créées puis gérées par des acteurs multiples. Une typologie éloquente distingue entre les « archives de la terreur », désignant notamment les fichiers policiers et autres documents rassemblés par les services de renseignement d’un Etat, et les « archives de la douleur » patiemment réunies et conservées par des commissions d’enquête, mais également par des associations informelles ou des ONG afin de documenter des cas de violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire[39].
La conservation des archives puis leur accessibilité au plus grand nombre garantissent l’effectivité du droit à la vérité, en permettant de savoir ce qui s’est passé durant les heures les plus sombres de l’histoire d’un État. Louis Joinet insistait beaucoup sur cet élément dans son rapport de 1997. Ainsi, les Principes 13 à 17 énumèrent de manière pragmatique des mesures de protection des archives, les conditions de leur accessibilité et de leur éventuelle communication aux commissions d’enquête et aux tribunaux ou encore le soin particulier à accorder aux archives à caractère nominatif. Là encore, en tenant compte des expériences passées, mais également des pratiques des archivistes professionnels, la version révisée des Principes en 2005 permet de préciser certaines de ces garanties[40]. De plus, depuis lors, le sujet a notamment été mis en avant par l’Assemblée générale dans sa résolution de 2013 sur le droit à la vérité[41]. Il en découle une incitation aux États à « conserver les archives et les autres éléments de preuve concernant les violations flagrantes des droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire de façon à concourir à faire connaître ces violations, et à faire en sorte que les allégations donnent lieu à une enquête et que les victimes puissent exercer leur droit à un recours effectif conformément au droit international[42] ».
Finalement, quelle que soit l’utilisation, judiciaire ou non, qui sera faite des archives en question, leur importance est bien soulignée par Monseigneur Desmond Tutu, artisan de la justice transitionnelle en Afrique du sud, selon qui « les archives sont cruciales pour nous permettre de rendre des comptes. Elles sont un rempart puissant contre les violations des droits de l’homme. Nous devons nous rappeler notre passé pour faire en sorte qu’il ne se répète pas[43] ».
* * *
En guise de conclusion, il convient de souligner que Louis Joinet était un visionnaire : les grandes idées formulées en 1997 sont toujours d’actualité aujourd’hui, elles ont même été confirmées dans la pratique des divers acteurs de la justice transitionnelle ainsi que dans les décisions des organes de protection des droits de l’homme. Les Principes Joinet restent pertinents en 2025 et à l’égard de toute situation de transition à venir, que ce soit après la fin d’un conflit armé ou le passage d’un régime autoritaire à un régime démocratique et respectueux de l’État de droit.
Louis Joinet avait souligné dans l’un de ses articles qu’il ne fallait pas faire de la justice transitionnelle pour la justice transitionnelle, que ce n’était pas un objectif en soi mais bien un processus. Et dans ce dernier, les quatre piliers précédemment évoqués sont un repère très clair, une sorte de boussole à suivre. Le rapport de 1997 souligne d’ailleurs qu’il ne s’agit pas « de normes juridiques stricto sensu mais de principes directeurs »[44]. Une fois de plus se retrouve ici le souci d’une approche pragmatique : un modèle est proposé, mais il n’est pas trop rigide, afin de pouvoir être adapté aux spécificités de chaque situation nationale. C’est ce qui fait sa grande force.
[1] Sur ce point, voir l’hommage rédigé par E. Decaux, « In memoriam Louis Joinet (1934-2019) », Droits fondamentaux, n° 18, 2020 et celui de F. Hourquebie, J. Gillet et D. Salas, « En hommage à Louis Joinet, pèlerin de la justice transitionnelle », Les Cahiers de la Justice, vol. 3(3), 2015, pp. 315-318. Voir aussi l’entretien mené par O. de Frouville, Droits fondamentaux, n° 1, 2001.
[2] Cette Sous-Commission, ensuite désignée « Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme », est une ancêtre des organes et procédures aujourd’hui présents au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.
[3] Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme civils et politiques, rapport final révisé du 2 octobre 1997, établi par Louis Joinet en application de la décision 1996/119 de la Sous-Commission, Nations Unies, doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1. Louis Joinet tenait à ce que ses travaux soient accessibles au plus grand nombre, ce qui l’a conduit à publier le petit ouvrage Lutter contre l’impunité. Dix questions pour comprendre et pour agir, Paris, Éditions La Découverte, 2002, 142 pages.
[4] Très logiquement, ces travaux ont été menés parallèlement à ceux ayant abouti aux « Principes van Boven » (du nom du Rapporteur spécial de la Sous-Commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités) : Assemblée générale, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, résolution 60/147 du 16 décembre 2005, Nations Unies, doc. A/RES/60/147.
[5] Voir Commission des droits de l’homme, Promotion et protection des droits de l’homme, Impunité, rapport de l’experte indépendante chargée de mettre à jour l’Ensemble de principes pour la lutte contre l’impunité, Mme Diane Orentlicher, adopté le 8 février 2005, Nations Unies, doc. E/CN.4/2005/102, et l’additif Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, adopté le 8 février 2005, Nations Unies, doc. E/CN.4/2005/102/Add.1.
[6] Commission des droits de l’homme, Promotion et protection des droits de l’homme, Impunité, précité, § 2.
[7] Voir notre étude « Justice transitionnelle », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet (dir.), Droit international pénal, Paris, Éditions Pedone, 2012, pp. 593-601.
[8] K. Annan, Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, rapport du Secrétaire général du 23 août 2004, Nations Unies, doc. S/2004/616, § 8.
[9] Dans le cadre onusien, voir les divers documents du Secrétaire général, de la Commission des droits de l’homme puis du Conseil des droits de l’homme ou encore de l’Assemblée générale, des années 1990 jusqu’à aujourd’hui.
[10] Voir Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme civils et politiques, précité, § 16. Le texte énonce ainsi : « a) Le droit de savoir de la victime; b) Le droit de la victime à la justice; et c) Le droit à réparation de la victime. À ces droits s’ajoutent, à titre préventif, une série de mesures destinées à garantir le non-renouvellement des violations. »
[11] Sur les différentes dimensions du droit à la vérité, voir notamment O. de Frouville, « Le droit de l’Homme à la vérité en droit international. À propos de quelques ”considérations inactuelles” », in O. Guerrier (dir.), La vérité, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2013, pp. 129-151.
[12] Voir Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978, Nations Unies, doc. 17512, article 32 (évoquant le « droit qu’ont les familles de connaître le sort de leurs membres » dans le cadre d’un conflit armé international) et J. M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Recueil de Droit international humanitaire coutumier, Bruxelles, Éditions Bruylant, 2006, vol. I, 879 pages, règle 117 (qui étend cette logique à tous les types de conflits armés). Voir aussi Protocole I, précité, article 33, énonçant que les parties à un conflit armé doivent, dès que les circonstances le permettent, rechercher les personnes dont la disparition a été signalée.
[13] Assemblée générale, Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, résolution du 18 décembre 1992, Nations Unies, doc. A/RES/47/133 et Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 61/177 du 20 décembre 2006, entrée en vigueur le 23 décembre 2010, article 24 § 2 : « Toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue. » Au-delà des normes internationales, des dispositions similaires existent sur le continent latino-américain.
[14] Sont notamment visées ici diverses décisions du Comité onusien contre les disparitions forcées, du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires ou celles des Cours européenne et américaine des droits de l’homme.
[15] Voir par exemple Assemblée générale, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, résolution du 16 décembre 2005, Nations Unies, doc. A/RES/60/147 et Assemblée générale, Droit à la vérité, résolution du 18 décembre 2013, Nations Unies, doc. A/RES/68/165.
[16] À défaut de l’énoncé d’un droit à la vérité dans leurs traités constitutifs, les cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme se sont notamment fondées sur le droit à la vie ou sur l’interdiction des mauvais traitements, explicitement prévus par lesdits textes, pour déduire une obligation positive à la charge des États parties d’enquêter au sujet de toute allégation de disparition forcée, de mauvais traitement ou de décès d’un individu qui était sous la garde des forces de l’ordre.
[17] Le mandat et les rapports de cet organe peuvent être consultés sur la page internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
[18] Voir Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme civils et politiques, précité, principe 3 et Assemblée générale, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, précité, principe 4.
[19] Voir P. Naftali, La construction du « droit à la vérité » en droit international, Bruxelles, Éditions Bruylant, 2017, 576 pages et J. Hubrecht, « Sorties de conflit : toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ? », Esprit, vol. 1, 2019, pp. 149 -160.
[20] Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme civils et politiques, précité, principe 18 : « Si l’initiative des poursuites relève en premier lieu des missions de l’État, des règles complémentaires de procédure doivent être prises pour permettre à toute victime d’en prendre elle-même l’initiative, individuellement ou collectivement, en cas de carence des pouvoirs publics, notamment en se constituant partie civile. Cette faculté devrait être étendue aux organisations non gouvernementales justifiant d’une action reconnue en faveur de la défense des victimes concernées. »
[21] Les victimes sont en effet des participants à part entière de la procédure devant la première et des parties civiles devant les autres juridictions.
[22] Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme civils et politiques, précité, § 17.
[23] À l’exception de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (dite « loi Gayssot ») qui crée le délit de négationnisme du génocide des juifs. Voir toutefois la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, celle du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité et celle du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
[24] Assemblée générale, Les processus de mémorialisation dans le contexte des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire : le cinquième pilier de la justice transitionnelle, rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, résolution du 9 juillet 2020, Nations Unies, doc. A/HRC/45/45.
[25] Commission des droits de l’homme, additif Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, précité, principe 3.
[26] Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme civils et politiques, précité, principe 4.
[27] Commission des droits de l’homme, additif Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, précité, principe 5.
[28] Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme civils et politiques, précité, §§ 19-24.
[29] Le rapport évoque plus précisément des « commissions de la vérité ». La formule « commissions vérité et réconciliation » est également souvent utilisée par les praticiens et la doctrine consacrée à la justice transitionnelle.
[30] Commission des droits de l’homme, additif Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, précité, p. 6. Le mandat et les conditions d’exercice de ces commissions sont présentés dans les principes 6 à 13.
[31] T. Savage, « Les commissions ”vérité et réconciliation” : une nouvelle approche de la vérité », Les Cahiers de la Justice, vol. 2(2), 2018, pp. 323-340.
[32] Voir. S. Lefranc, « Les commissions de vérité : une alternative au droit ? », Droit et cultures, vol. 56, 2008, pp. 129-145.
[33] Pour des illustrations de commissions vérité, voir S. Lefranc, Comment sortir de la violence ? Enjeux et limites de la justice transitionnelle, Paris, Éditions CNRS, 2022, 478 pages.
[34] Plus largement, sur les critères de composition et de fonctionnement des commissions vérité, ainsi que leur articulation avec les mécanismes judicaires, voir notamment Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit. Les commissions de vérité, New York et Genève, Nations Unies, 2006, 46 pages.
[35] Ibid, p. 7.
[36] Commission des droits de l’homme, additif Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, précité, principe 8 selon lequel : « d) Les commissions d’enquête peuvent être compétentes pour connaître de toutes les formes de violation des droits de l’homme et du droit humanitaire; leurs investigations devraient porter en priorité sur celles qui constituent des crimes graves selon le droit international, notamment et particulièrement sur les violations des droits fondamentaux des femmes et d’autres groupes vulnérables ». Le texte prévoit aussi une juste représentation de ces catégories de personnes dans la composition des commissions ou la participation des personnes amenées à témoigner.
[37] Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit. Les commissions de vérité, précité, pp. 10 et 23.
[38] Selon le site internet du Conseil international des archives : « Produit documentaire dérivé de l’activité humaine, les archives sont conservées en raison de leur valeur dans la durée. Elles témoignent de la vie et des gestes quotidiens de personnes et d’organisations, et permettent ainsi d’éclairer les événements du passé. À l’instar de l’être humain, il n’existe pas d’archive type. Les archives se présentent sous des formes et des formats bien différents (écrit, photographique, audiovisuel, numérique ou analogique…). Elles sont détenues aussi bien par des organisations, publiques ou privées, que par des personnes physiques à travers le monde, et les bâtiments où elles sont conservées portent également souvent le nom d’archives. »
[39] Pour une présentation d’ensemble, voir. J. Boel, P. Canavaggio et A. Gonzalez Quintana (dir.), Archives et droits humains, Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2023, 420 pages.
[40]Commission des droits de l’homme, additif Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, précité, principes 14 à 18.
[41] Assemblée générale, Droit à la vérité, précité.
[42] Ibid., §§ 5 et 10, sur d’autres recommandations de l’Assemblée générale (assistance technique, échange d’information et diffusion des bonnes pratiques en matière de conservation et de gestion des archives ; mise en place de politiques nationales des archives ayant trait aux droits de l’homme).
[43] Archevêque D. Tutu, « Liberation, Reconciliation and the Importane of the Record », Actes de la XXXVIIème Conférence internationale de la Table ronde des Archives (CITRA), Le Cap, Afrique du Sud, 21-25 octobre 2003, Comma, vol. 2, 2004, pp. 53-55.
[44] Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme civils et politiques, précité, § 49.
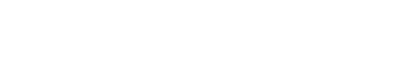

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
