Merci tout d’abord à Emmanuel Decaux et aux organisateurs de cette journée de me donner l’occasion de présenter le point de vue de l’archiviste sur cette question essentielle de la contribution des archives au droit à la vérité, qui est souvent méconnue ou tout au moins sous-estimée.
Le Conseil international des archives (ICA) a été créé à l’initiative de l’UNESCO en juin 1948, l’année même de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il a pour mission de promouvoir dans le monde la préservation des archives et leur accès, l’un n’allant pas sans l’autre. Il consiste en un réseau de 1 680 membres, institutionnels, associatifs et individuels, provenant de 151 pays, répartis en branches régionales et en sections professionnelles thématiques. La Section Archives et droits humains (ICA/SAHR) est la plus récente et la plus nombreuse, puisqu’elle compte à ce jour 344 membres dans 79 pays. Nous travaillons sur cette problématique depuis 2003 et nous avons reçu le soutien de Louis Joinet dès le début de nos activités.
On connaît la triple fonction des archives, administrative, citoyenne et patrimoniale : elles sont d’abord nécessaires à la bonne marche de l’administration et doivent lui permettre de rendre des comptes, et elles constituent dans un second temps un patrimoine culturel et des sources pour les historiens. Les expériences de justice transitionnelle dans le monde ces dernières décennies montrent que les archives peuvent aussi être décisives dans la lutte contre l’impunité.
Louis Joinet a énoncé dans son rapport de 1997 un ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité[1]. Ces principes, dits Principes Joinet, sont fondés sur les trois droits qu’ont les victimes : le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à réparations. À ces droits, le rapport ajoute, à titre préventif, une série de mesures destinées à garantir le non-renouvellement des violations.
Le droit de savoir n’est pas seulement un droit individuel mais c’est un droit collectif. Il implique le droit inaliénable à la vérité qui est affirmé par le principe 1 : « Chaque peuple a le droit inaliénable de connaître la vérité sur les événements passés ». Le deuxième principe résulte du premier : c’est le devoir de mémoire qui incombe à l’État et « la connaissance par un peuple de l’histoire de son oppression appartient à son patrimoine et, comme telle, doit être préservée par des mesures appropriées ». De ces deux principes, Louis Joinet fait découler la nécessité de préserver les archives et il consacre cinq de ces quarante-deux principes à leur préservation et à leur accès[2] qui est l’une des conditions de l’établissement de la vérité et de la justice[3].
I. L’importance des archives pour le droit à la vérité est de plus en plus reconnue à l’ONU
Depuis vingt ans, à partir de 2005, la Commission puis le Conseil des droits de l’homme ont souligné à plusieurs reprises dans leurs résolutions l’importance des archives en 2005[4], en 2006 et en 2012. Le Haut-Commissariat a réalisé à sa demande trois études sur le droit à leur vérité qui mentionnent leur contribution à ce droit. Le rapport de 2009 décrit notamment les meilleures pratiques pour la mise en œuvre effective du droit à la vérité et près de la moitié du rapport est consacré aux pratiques en matière d’archives concernant les violations flagrantes des droits de l’homme[5]. Il préconise le renforcement du système national d’archives comme étape fondamentale d’un processus de transition. Le rapport insiste aussi sur la nécessité cruciale de doter le pays de lois sur l’accès à ces archives. Il décrit les différents usages des archives dans les processus de justice transitionnelle, tant pour les poursuites et le droit à la justice que pour la recherche de la vérité et le droit de savoir. Il détaille le type de documents utiles et insiste sur la nécessité de préserver les dossiers des institutions de justice transitionnelle, internationales ou nationales, qui sont essentiels pour la nation et son histoire. Un volume consacré aux archives a été publié par le Haut-Commissariat en 2015 dans la série d’Instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un conflit[6].
En 2012 le juriste colombien Pablo de Greiff a été désigné par le Conseil comme rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, et tous ses rapports annuels font expressément référence aux archives, comme condition de l’exercice des droits des victimes à la vérité et du devoir de mémoire de l’État. Celui de 2015 s’intéresse notamment à celles des commissions vérité, dont il considère qu’elles constituent un rempart efficace contre le révisionnisme et le déni. Et d’année en année ses recommandations se font plus précises, en particulier pour engager les pouvoirs publics à mettre en place des politiques nationales d’archives, à doter les Archives nationales de moyens suffisants et à faire adopter des législations modernes sur les archives, l’accès à l’information et la protection des données personnelles[7]. À partir de 2017 l’accent est mis sur la prévention, l’accès à des archives bien conservées et protégées constituant un « outil pédagogique de lutte contre le négationnisme et le révisionnisme, crucial tant pour l’enseignement de l’histoire que pour la réforme institutionnelle[8] ».
Les rapports de son successeur Fabián Salvioli font de la mémorialisation ou travail de mémoire, le cinquième pilier de la justice transitionnelle, travail qui implique aussi la conservation des documents. Et, en décembre 2024, le nouveau rapporteur Bernard Duhaine a lancé un appel à contributions pour son prochain rapport qui portera exclusivement sur la documentation des violations graves des droits de l’homme dans le cadre des processus de justice transitionnelle. Nous y avons bien entendu répondu.
II. De quelles archives s’agit-il concrètement ?
A. D’abord, des documents produits par les institutions de l’État qui sont des archives publiques : principalement les archives des services de police et de sécurité héritées des anciens régimes autoritaires.
La prise de conscience de leur importance pour documenter les violations des droits de l’homme s’est faite dans les années 1990, avec la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS et de ses satellites. Ces événements se sont traduits par l’apparition des masses d’archives énormes produites par les services de police et de sécurité de ces régimes répressifs : les 110 kilomètres linéaires (kml) d’archives de la Stasi, représentant le fichage de millions de personnes, en sont l’exemple le plus emblématique mais il est loin d’être le seul cas. Un groupe d’experts a alors été chargé par l’UNESCO et l’ICA de faire un rapport sur ces archives qui posaient aux responsables des Archives nationales de nouveaux défis en termes de préservation et d’accès. Certains s’interrogeaient en effet sur l’opportunité de conserver des documents souvent basés sur de fausses dénonciations. Le rapport publié en 1997 a souligné en fait l’effet boomerang de ces documents qui, d’instruments de la répression, devenaient les preuves permettant, à la fois aux victimes et aux sociétés, de connaître la vérité sur leur histoire, d’obtenir justice et de demander réparations[9]. Sans qu’il y ait eu concertation avec Louis Joinet, les recommandations du rapport de l’ICA et des praticiens des archives rejoignaient les préconisations du magistrat.
Pour d’évidentes raisons, les archives des services de police sont souvent l’objet d’éliminations quand les responsables de ces services disposent de temps pour effacer les traces de leurs abus. Il est aussi arrivé que les nouveaux gouvernements fassent détruire les dossiers après la phase d’épuration, sous prétexte d’en finir avec le passé ou parce qu’ils contiennent des informations mensongères susceptibles d’être réutilisées. En détruisant à jamais ces archives, on rend encore plus difficile la rédaction de l’histoire de cette période, qui devient entièrement dépendante de témoignages individuels qui peuvent être subjectifs. Ce sont donc les victimes et les générations futures qui sont finalement lésées.
Qualifiées d’archives de la terreur en Amérique latine, ces archives sont souvent éliminées ou cachées par leurs responsables mais elles peuvent réapparaître comme celles du Plan Condor[10] au Paraguay en 1992, ou celles de la police d’Hissène Habré au Tchad découvertes par un membre de Human Rights Watch en 2001, ou les 5 km de dossiers de la police nationale du Guatemala retrouvés dans un entrepôt abandonné en 2005. Dans ces trois cas elles ont servi de preuves judiciaires et ont permis de poursuivre et condamner les auteurs des crimes commis. C’est en partie sur la base des documents du Plan Condor que le juge espagnol Baltasar Garzón a fait arrêter à Londres Augusto Pinochet en 1998. Au Guatemala ces archives ont été ensuite utilisées dans le procès contre le dictateur, Rios Montt, en 2013. Au Tchad elles ont servi en 2016 à prouver l’implication directe d’Hissène Habré dans les crimes commis lors du procès mené contre lui par les Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises.
Au Cambodge, les documents de la tristement célèbre prison S21 de Tuol Sleng ont été déterminants pour les procès menés par les Chambres extraordinaires auprès des tribunaux cambodgiens contre les auteurs du génocide. Ils ont permis de documenter la chaîne de commandement et la répartition des responsabilités. Les témoignages des victimes étaient essentiels mais ils pouvaient être mis en question car le procès a commencé en 2006, soit 31 ans après les faits, et la mémoire humaine est faillible. Grâce aux documents les faits objectifs ont pu être établis.
Outre cet usage judiciaire, ces archives peuvent aussi faire l’objet d’un usage politique : ce sont ces documents qui ont servi en Europe centrale et orientale dans le cas des procédures de lustration ou vetting qui consistent à vérifier les antécédents des fonctionnaires de l’ancien régime pour exclure de la fonction publique les membres ou collaborateurs des services de renseignement et des partis communistes précédemment au pouvoir. C’est l’usage le plus complexe et le plus controversé car il peut être instrumentalisé politiquement et il a donné lieu à des dérives dans certains pays.
D’autres archives publiques comme celles des prisons, des hôpitaux, des cimetières peuvent contribuer à l’établissement de la vérité. Tous ces documents permettent aussi la réhabilitation des victimes, leur indemnisation et éventuellement la restitution de leurs biens.
Autre catégorie d’archives qui méritent d’être conservées, celle des institutions temporaires de la justice transitionnelle, commissions vérité, juridictions et mécanismes d’enquête, dont la situation est particulièrement préoccupante. Dans de nombreux cas, les documents qu’elles ont rassemblés et les dossiers qu’elles ont produits et analysés ne sont pas accessibles après leur fermeture à la fin de leur mandat et parfois le seul document disponible est le rapport final. Ils sont pourtant d’une importance vitale pour permettre aux populations concernées, aux chercheurs et au public en général de mener des analyses supplémentaires et de comprendre ce qui s’est passé. Même après que les auditions sont terminées et que le mécanisme a achevé ses travaux, ils restent intéressants pour d’autres usages que les enquêtes, usages réparatoires, mémoriels et éducatifs par exemple. La Section est en train de dresser une cartographie des 137 commissions vérité et autres mécanismes de documentation et d’enquête mis en place par les Nations Unies, les gouvernements ou les communautés qu’elle a identifiés, afin de les localiser et de les protéger. Seuls 78 d’entre eux, soit 40%, ont remis leurs archives à des services compétents et 41 fonds seulement sont accessibles au public, soit 31 % des cas. C’est donc dès la mise en place de ces mécanismes qu’il faudrait prendre des dispositions pour leur sauvegarde.
Nous essayons également en collaboration avec la fondation suisse swisspeace de sensibiliser l’ONU à l’importance, pour les victimes et les sociétés, de préserver et de rendre accessibles les dossiers des six tribunaux pénaux internationaux temporaires créés au cours des 30 dernières années : les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, les Chambres extraordinaires au sein de la Cour pour le Cambodge, le Tribunal spécial pour le Liban et les Chambres spécialisées pour le Kosovo. Les archives qu’ils ont constituées sont essentielles à la compréhension des conflits et à l’histoire de la justice internationale. Parallèlement, de nouveaux organismes chargés de recueillir des preuves, comme le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie ont été créés ces dernières années et la préservation à long terme de leur production documentaire doit être assurée.
B. Ensuite il s’agit d’archives privées, comme celles des organisations de la société civile, principalement les organisations de défense des droits humains
Des milliers d’ONG dans le monde créent et/ou détiennent des dossiers permettant de documenter les violations des droits humains. Les documents prouvant l’existence des disparus et les témoignages recueillis par les familles et les associations de défense des victimes sont précieux et vulnérables.
Quand les archives des services de police ont disparu, celles des organisations de défense des droits de l’homme constituent des sources alternatives précieuses. Les associations de soutien aux victimes ont souvent commencé à rassembler informations et témoignages destinés à prouver ultérieurement les abus subis. Ces documents sont particulièrement menacés, parce que la conservation à long terme n’est pas une priorité pour leurs membres qui travaillent souvent dans la clandestinité. Ils sont exposés au risque d’une disparition involontaire, par manque de moyens ou simplement par négligence, ces organisations étant portées par vocation davantage sur l’action immédiate.
En Amérique latine, on les désigne sous le terme d’archives de la douleur. En Argentine ou au Chili, où les dossiers de la police ont généralement disparu ou sont inaccessibles, ce sont ces documents qui ont tenu lieu de preuves alternatives et complémentaires. Celles du Vicariat de la solidarité au Chili, une organisation catholique chilienne, ont servi de base à la Commission nationale Vérité et Réconciliation, la Commission Rettig, pour établir la vérité sur le sort des centaines de Chiliens exécutés ou disparus pendant la dictature, et celles de Memoria Abierta en Argentine continuent à perpétuer la mémoire des disparus.
À l’exception des plus grandes ONG, la plupart n’ont pas mis en place de procédures garantissant la conservation et l’accès à long terme de leurs archives, faute de moyens humains et financiers, et elles risquent souvent de disparaître. C’est pourquoi la première initiative du groupe de travail, qui a précédé la Section, a été de publier en 2004 un guide pratique pour permettre aux ONG de gérer leurs dossiers facilement et à moindre coût[11]. Ce manuel a été publié par l’UNESCO et l’ICA, et le Haut-Commissariat y a fait référence dans l’étude de 2006 sur le droit à la vérité[12]. Compte tenu des évolutions technologiques et sociétales survenues depuis, une nouvelle version actualisée est absolument nécessaire.
Pour améliorer la préservation et le traitement de ces archives, dès leur création dans les organisations disposant de peu de moyens, nous avons également contribué au développement d’un logiciel libre, normalisé et multilingue. Baptisé AtoM (Access to Memory), il permet de décrire les fonds d’archives et d’en faciliter la mise en ligne.
D’autres archives privées peuvent constituer des preuves comme les archives des entreprises, notamment multinationales
Dans de multiples cas les entreprises multinationales ont joué un rôle dans les violations massives des droits humains. Leurs archives pourraient aider à les documenter et à permettre aux victimes d’exercer leur droit à la vérité. Les Principes directeurs des Nation Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, dits « Principes Ruggie » du nom de leur rapporteur, ne mentionnent pas les archives[13]. Pourtant le rôle des archivistes dans les entreprises est essentiel pour la bonne gestion de leurs production documentaire, pour prévenir les abus et réparer les torts causés aux victimes. Nous nous efforçons de sensibiliser le monde des affaires à la question depuis quelques années et nous avons de nouveau soulevé ce point lors du XIIIe Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme, qui s’est tenu à Genève en novembre 2024.
III. Les défis auxquels tous ces documents sont confrontés sont nombreux.
Le premier défi est la préservation. Les tentatives de réécrire l’histoire existent plus que jamais et à l’ère du tout numérique, de la post-vérité et des fausses informations, il est nécessaire de disposer de preuves fiables des violations des droits humains et d’en assurer la conservation à long terme.
Les archives doivent d’abord faire face à des menaces d’ordre technique : de plus en plus des ONG interviennent proactivement pour collecter à chaud les données documentant les crimes et stocker des contenus multimédias qui risqueraient d’être retirés d’Internet. C’est le cas par exemple en Ukraine ou au Myanmar. La préservation et l’accès aux données numériques et multimédias est un défi majeur. Dans un environnement numérique, la préservation à long terme doit être prise en compte dès la création des systèmes d’information. Pour garantir leur authenticité et leur fiabilité, il faut assurer l’intégrité des données. Cela implique le maintien de la chaîne de traçabilité de toutes les opérations les affectant. La préservation du contexte dans lequel les documents ont été créés et conservés est essentielle à leur compréhension. Cela demande des connaissances techniques et des ressources humaines et logistiques très coûteuses.
Les pressions politiques, la guerre ou les désastres naturels constituent d’autres menaces et un nombre croissant d’institutions cherchent à mettre leurs archives en lieu sûr. L’ICA a développé en partenariat avec le Département fédéral des affaires étrangères, les Archives fédérales suisses, la fondation swisspeace et l’UNESCO un programme de Safe Havens/refuges de sécurité pour les abriter temporairement. Des Principes directeurs concernant l’hébergement en lieu sûr des archives en péril ont ainsi été élaborés pour encadrer les conditions de leur déplacement conformément aux normes internationales[14]. Ce programme soutient treize cas en Amérique latine, Asie, Afrique et au Moyen Orient et six ont trouvé des institutions hôtes. Une copie numérique des archives de la police du Guatemala a ainsi été déposée en Suisse, parce qu’elles étaient exposées aux revirements politiques du gouvernement. De même, en 2023, la Commission vérité colombienne a décidé d’envoyer une copie de ses archives en Suisse et des associations du Salvador en ont fait autant.
L’accès constitue un autre enjeu. En période de transition et dans le cadre de la réforme des institutions, un arsenal de trois lois doit être mis en place, conformément aux recommandations du rapporteur spécial des Nations Unies[15] : loi sur les archives, loi sur l’accès des citoyens à l’information et loi sur la protection des données personnelles. L’objectif est de trouver un équilibre entre l’accès du public aux archives et la protection de la vie privée et de la dignité des survivants.
L’ICA a adopté des Principes d’accès aux archives pour promouvoir de façon proactive l’accès dans le respect des limites imposées par la protection des intérêts de l’État et celle de la vie privée[16]. Ils recommandent de faciliter l’accès des documents aux victimes même s’ils ne sont pas communicables au public. Nous avons aussi élaboré Principes relatifs au rôle des archivistes et des gestionnaires de documents pour la défense des droits de l’homme, qui font référence constante aux principes Joinet.[17] L’objectif est d’aider les archivistes à résoudre les problèmes complexes, juridiques et pratiques, auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils traitent ce type de documents : ils sont en effet souvent isolés et peuvent être contraints d’éliminer les documents compromettants ou de ne pas les signaler dans leurs instruments de recherche.
Compte tenu de la grande variété de sources archivistiques qui peuvent servir à établir la vérité et des défis existants, le besoin de collaboration interdisciplinaire est absolument nécessaire : avec les informaticiens pour traiter des questions complexes liées aux méthodes d’archivage mais aussi avec les juristes, bien sûr.
L’utilité des archives est cruciale dans les pays qui sortent d’une dictature ou d’un conflit armé mais elle ne se limite pas à l’établissement de la vérité dans le cadre de la justice transitionnelle. Leur préservation est indispensable à long terme pour les historiens et les générations futures, en espérant que leur relecture des événements passés favorisera la paix et la réconciliation sociale.
[1] Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme civils et politiques, rapport final révisé du 2 octobre 1997, établi par Louis Joinet en application de la décision 1996/119 de la Sous-Commission, Nations Unies, doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.
[2] Ibid., principe 13 (Mesures de préservation des archives), principe 14 (Mesures facilitant l’accès aux archives), principe 15 (Coopération des services d’archives avec les tribunaux et les commissions non judiciaires d’enquête), principe 16 (Mesures spécifiques concernant les archives à caractère nominatif) et principe 17 (Mesures spécifiques relatives aux processus de rétablissement de la démocratie et/ou de la paix ou de transition vers celles-ci).
[3] Ces principes ont été confirmés en 2005 par Diane Orentlicher, l’experte indépendante chargée de les mettre à jour, et ceux qui concernent les archives sont numérotés de 14 à 18 dans son rapport. À cet égard, voir Commission des droits de l’homme, Promotion et protection des droits de l’homme, Impunité, rapport de l’experte indépendante chargée de mettre à jour l’Ensemble de principes pour la lutte contre l’impunité, Mme Diane Orentlicher, adopté le 8 février 2005, Nations Unies, doc. E/CN.4/2005/102, et l’additif Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, adopté le 8 février 2005, Nations Unies, doc. E/CN.4/2005/102/Add.1.
[4] En 2005, la Commission des droits de l’homme préconise pour la première fois la conservation des archives pour « contribuer à faire connaître les violations flagrantes des droits de l’homme, enquêter sur les allégations et offrir aux victimes l’accès à un recours utile conformément au droit international » (additif Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, précité, principe 3).
[5] Conseil des droits de l’homme, Le droit à la vérité, rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme adopté le 21 août 2009, Nations Unies, doc. A/HRC/12/19, §§ 4 à 31.
[6] Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit. Les archives, New York et Genève, Nations Unies, 2015, 58 pages.
[7] Conseil des droits de l’homme, Étude conjointe sur la contribution de la justice de transition à la prévention des violations flagrantes des droits de l’homme, des atteintes patentes à ces droits et des violations graves du droit international humanitaire, y compris du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité, et à la prévention de leur répétition, rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, M. Pablo de Greiff, adopté le 6 juin 2018, Nations Unies, doc. A/HRC/30/42.
[8] Conseil des droits de l’homme, Promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, M. Fabián Salvioli, adopté le 12 octobre 2017, Nations Unies, doc. A/72/523, § 80.
[9] Voir A. González Quintana, Politiques Archivistiques pour la défense des Droits de l’Homme, Paris, Conseil International des Archives (ICA), 2009, 327 pages, qui est une version mise à jour du rapport de 1997 pour l’UNESCO et l’ICA sur les archives des services de sécurité d’État des anciens régimes répressifs. L’ouvrage comprend 13 recommandations toujours d’actualité adressées aux pouvoirs publics sur la préservation et l’accès aux archives afin de garantir les droits individuels et collectifs des citoyens et des sociétés.
[10] Plan de coopération répressive entre les services secrets de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay.
[11] A. Le Goff, Les archives des ONG, une mémoire à partager, Paris, Conseil International des Archives (ICA), 2004, 32 pages. Ce Guide pratique en 60 questions, écrit à l’intention des responsables et des bénévoles des ONG, donne des conseils élémentaires sur le traitement des documents.
[12] Commission des droits de l’homme, Promotion et protection des droits de l’homme, étude sur le droit à la vérité, rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, adopté le 8 février 2006, Nations Unies, doc. E/CN.4/2006/91, § 52.
[13] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, New York et Genève, Nations Unies, 2011, 49 pages.
[14] Conseil International des Archives (ICA), Principes directeurs concernant l’hébergement en lieu sûr des archives en péril, janvier 2021, 8 pages.
[15] Voir Conseil des droits de l’homme, Étude conjointe sur la contribution de la justice de transition à la prévention des violations flagrantes des droits de l’homme, des atteintes patentes à ces droits et des violations graves du droit international humanitaire, y compris du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité, et à la prévention de leur répétition, précité.
[16] Conseil International des Archives (ICA), Principes relatifs à l’accès aux archives, 24 août 2012, 16 pages. Les principes mettent l’accent sur le rôle essentiel que joue l’accès aux archives dans la connaissance de la vérité, la réclamation d’indemnisations, et la défense contre les accusations de violation des droits de l’homme. Les principes indiquent que chaque personne a le droit de savoir si son nom apparaît dans les archives de l’État et de contester la validité de l’information en soumettant une déclaration. Les personnes désirant consulter des archives pour des raisons concernant les droits de l’homme ont accès aux archives intéressant ces recherches, même si elles ne sont pas communicables au grand public.
[17] Conseil International des Archives (ICA), Principes relatifs au rôle des archivistes et des gestionnaires de documents pour la défense des droits de l’homme, septembre 2006, 21 pages.
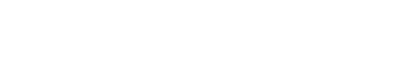

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
