Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Chers amis,
Je ne saurais trop remercier et féliciter le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et l’Association française des Nations unies pour cette initiative. Je voudrais vous transmettre à cet égard les remerciements et la reconnaissance de tous les membres du Comité sur les disparitions forcées, depuis le Palais Wilson, à Genève, où se tient en ce moment notre 28ème session, raison pour laquelle je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd’hui.
En ce jour, je pense aussi à Louis Joinet qui nous a quitté en 2019 et qui, comme vous le savez, a joué un rôle majeur dans la reconnaissance en droit international du droit à la vérité. Récemment encore, le 8 décembre 2024, lors de la chute du régime de Bachar Al Assad en Syrie, j’ai repensé à un de ses fameux aphorismes qui m’accompagnent et me guident : « Quand la roue de l’Histoire finit par tourner, l’opinion internationale découvre avec stupeur que ces prétendus ‘mensonges’ [à propos des allégations de violations des droits de l’homme] étaient bien en deçà de la vérité ! »
À la lumière de ce constat, il semble particulièrement opportun, cette année, de célébrer et de donner un écho spécial à ce 24 mars, proclamé Journée pour le droit à la vérité en mémoire de Monseigneur Óscar Arnulfo Romero, assassiné le 24 mars 1980 pour avoir dénoncé les violations des droits humains au Salvador.
En effet, il faut bien reconnaître que nous faisons face aujourd’hui à une attaque sans précédent contre la vérité en général, contre le droit à la vérité en particulier, mais aussi contre toutes celles et tous ceux qui osent dire la vérité face aux puissants.
Dire la vérité aux puissants, c’est la parrhèsia de Diogène : Alexandre le Grand est curieux de rencontrer ce philosophe-chien assis dans son amphore, entouré de ses camarades chiens avec qui il partage ses repas. Alexandre est l’homme le plus puissant et le plus redouté du monde, il interpelle Diogène : « Que puis-je faire pour toi ? » Et Diogène de répliquer : « Ôtes toi de mon soleil ! » Ce qui n’était pas seulement une insolence, mais une manière de dire au plus grand roi : tu n’es pas un soleil, tu n’es qu’un humain comme les autres, le vrai soleil se trouve derrière toi et tu en ignores la vraie puissance, qui est une puissance de vie, de chaleur et de réconfort.
Combien de courage il faut pour être Diogène : c’est le courage de la vérité, le courage des défenseurs des droits humains, des familles de disparus, de toutes celles et tous ceux qui se tiennent devant les puissants au risque de leur vie. C’est aussi le courage, on l’oublie trop souvent, d’Alexandre qui aurait très bien pu, en un claquement doigt, faire exécuter l’insolent, mais qui au contraire confie à ses généraux amusés : « Si je n’étais pas Alexandre, j’aurais voulu être Diogène. »[1]
Malheureusement, ils sont rares les Alexandre… Toutes les dictatures détestent la vérité. Récemment, on a vu par exemple le régime de Vladimir Poutine réécrire les livres d’Histoire pour réhabiliter le soviétisme et exalter le nationalisme russe. Toutes les vieilles techniques de la propagande et de l’intoxication sont remises au goût du jour, en profitant à fond des moyens offerts par les nouvelles technologies.
Mais aujourd’hui la remise en cause de la vérité se produit au cœur même de nos démocraties. Elle est le fait d’entrepreneurs de haine qui, par l’effet combiné de leur populisme et d’une trop grande passivité du reste de la classe politique, finissent par accéder au pouvoir.
Dans ce contexte, les droits humains font face à une rhétorique particulièrement vicieuse, amplifiée par un désordre informationnel qu’il nous faut absolument surmonter.
De nouveaux idéologues utilisent l’art du retournement d’argument que pratiquaient déjà les mouvements totalitaires dans les années 1930.
Ils nous expliquent que les faits scientifiques relèvent d’une théorie du complot, et qu’au contraire leur propagande mensongère, fondée sur des faits « alternatifs », est véridique.
Ils affirment que défendre les minorités contre la persécution est une forme d’intolérance et qu’au contraire leurs discours de haine relèvent de la liberté d’expression.
Ils accusent les juges d’être contre le peuple, et l’État de droit d’être contre la démocratie.
Toutes celles et ceux qui ont travaillé aux côtés des familles de disparus ne sont que trop familiers de cette rhétorique trompeuse. Nous n’oublions pas qu’en Argentine, les militaires traitaient les mères de disparus de « folles ».
Mais les mères ont continué de brandir les portraits des disparus sur la Place de Mai et nous savons depuis longtemps que la Raison était de leur côté, que les fous c’étaient ceux qui étaient capables d’enlever et de torturer 30 000 de leurs concitoyens au nom d’une soi-disant « sécurité nationale ».
Partout dans le monde aujourd’hui, nous voyons le retour de cette folie, et avec elle celle de la disparition forcée, de la torture et des exécutions pour mettre au pas la société et faire taire toute dissidence.
C’est dans ce contexte pour le moins sombre que s’est tenu le Premier Congrès mondial sur les disparitions forcées, qui est plus qu’une lueur d’espoir : c’est avant tout une extraordinaire démonstration de force et de résilience du mouvement mondial pour les droits humains et contre les disparitions forcées.
L’objectif fondamental du Congrès mondial était de rassembler, pour la première fois, tous les acteurs engagés dans la lutte contre les disparitions forcées : les États, qu’ils aient ratifié ou pas la Convention des Nations Unies, les associations de familles de disparus et de survivants, les organisations internationales, les ONG internationales, les médias, les universitaires, etc…
Jamais auparavant il n’y avait eu une telle occasion pour tous ceux qui partagent les mêmes préoccupations et objectifs d’échanger leurs expériences, de coordonner leurs actions et d’élaborer des stratégies communes.
Grâce aux co-organisateurs du Congrès, et à l’engagement total de tous les partenaires, le défi a été pleinement relevé. Les résultats du Congrès ont en effet dépassé nos attentes initiales. Les chiffres sont parlants : 620 participants en présence et 1392 participants en ligne, venus de 118 pays, 301 organisations de la société civile, dont 82 organisations dirigées par des victimes, 76 délégations d’États présentes… lorsque le CEDI, le Comité, le Groupe de travail et les États parrains ont pris cette initiative en 2022, nous n’aurions jamais imaginé une telle participation et un tel impact.
Ce qui ne transparaît pas dans les chiffres, c’est la force des témoignages et l’engagement des acteurs, mais aussi les engagements (les fameux pledges).
Car le Congrès n’est pas une fin en soi : c’est déjà une réussite, mais c’est avant tout un processus en cours et qui doit se poursuivre au-delà du mois de janvier.
Le rapport du Congrès est maintenant en ligne et j’invite tous les participants à cette conférence à aller le consulter sur le site de CEDI. Il reprend les engagements clés de tous les acteurs et résume l’apport des différents ateliers.
Il est maintenant d’une importance majeure que tous les partenaires s’organisent pour donner une suite à ces engagements, y compris une accélération significative du rythme des ratifications de la Convention sur les disparitions forcées pour atteindre la quasi-universalité dans un temps raisonnable.
On parle beaucoup de réarmement en ce moment. Et c’est évidemment très important. Comme dit l’adage : « Si tu veux la paix, prépare la guerre. » Mais parallèlement à ce réarmement, et de manière indissociable, il faut aussi réhumaniser : la sécurité ne peut pas tenir à elle seule lieu de politique.
Toute politique sécuritaire qui prétend se passer de la dimension humaine ne peut aboutir qu’à plus d’insécurité. La guerre appelle la guerre. Le réarmement, c’est aussi la course aux armements. C’est ce qu’exprimait l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, lorsqu’il affirmait l’interdépendance des trois piliers de l’ONU : pas de développement sans paix, pas de paix sans développement et ni l’un ni l’autre sans les droits humains…
Malheureusement, les États semblent perdre cette évidence de vue.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Chers amis,
Il y a aussi deux autres dimensions structurantes du débat sur le droit à la vérité qu’il faut évoquer, en ce jour du 24 mars.
La première, c’est la manière dont nous concevons le droit à la vérité et la justice transitionnelle. Jusqu’ici, nous avons surtout envisagé le droit à la vérité et la justice transitionnelle d’une part dans un cadre national et d’autre part en vue de réconcilier les humains entre eux.
Mais à vrai dire cette approche est insuffisante alors que la planète se meurt et que l’éventualité d’un nouveau conflit mondial ne relève plus de la dystopie.
Aujourd’hui la question de la justice transitionnelle ne peut plus se poser uniquement dans les sociétés nationales, elle renvoie aussi à la réconciliation entre les peuples et entre leurs mémoires conflictuelles, à la question centrale et universelle, dans toutes les sociétés, des inégalités fondées sur le genre, mais aussi à la réconciliation entre l’Humanité et son écosystème. Il est donc nécessaire de réfléchir aujourd’hui à un processus de justice transitionnelle globale, qui pourrait s’inscrire dans un multilatéralisme rénové.
La deuxième dimension structurante, c’est évidemment celle de la révolution des technologies de l’information et, combinée à celle-ci, celle de l’intelligence artificielle. Nous faisons face à un chaos informationnel et à des bulles informationnelles qui ne font qu’accentuer les divisions et préparer les conflits de demain. La question de l’information au XXIème siècle est indissociable de la question de la croyance en une vérité qui puisse, en raison, être universellement partagée. En fonction de la manière dont on conçoit l’intelligence artificielle et dont on la gouverne par des règles de droit, l’idée même de vérité sera ou non frappée d’obsolescence.
Des IA nationalisées ou par zones d’influence, ça ne veut pas dire uniquement le renforcement d’un relativisme qui existe déjà : cela signifie que les vérités alternatives viendront se loger au principe même de nos processus cognitifs et par conséquent normatifs. C’est donc l’assurance d’une décomposition du monde commun fondé sur l’idée de vérité.
En cette journée du 24 mars, je terminerai en rendant hommage à toutes les victimes du déni de vérité et à toutes celles et tous ceux qui, comme Diogène, comme Alexandre, ont le courage de la vérité. Pour la plupart d’entre nous, citoyens ordinaires et peu courageux, nous qui, comme le disait Foucault, partageons toutes et tous cette condition d’être des gouvernés, ils sont le témoignage vivant qu’il est encore possible de croire en l’Humanité.
Je vous remercie de votre attention.
[1] Voir aussi M. Foucault, Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II, Paris, Éditions du Seuil/Gallimard, 2009, 368 pages, spéc. p. 14 : « La parrêsia est donc, en deux mots, le courage de la vérité chez celui qui parle et prend le risque de dire, en dépit de tout, toute la vérité qu’il pense, mais c’est aussi le courage de l’interlocuteur qui accepte de recevoir comme vraie la vérité blessante qu’il entend. »
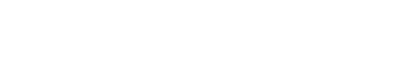

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
