Messieurs les Ambassadeurs,
Madame la députée,
Monsieur le Président de la Fondation René Cassin,
Monsieur le directeur général de Reporters sans frontières,
Monsieur le Président de la coalition française pour la cour pénale internationale,
Mesdames et Messieurs experts et universitaires,
Mesdames et Messieurs défenseurs des droits,
Mesdames et Messieurs en vos qualités respectives,
Je vous souhaite la bienvenue au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à l’occasion de la Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l’homme et pour la dignité des victimes. J’ai l’honneur d’introduire cet évènement organisé conjointement par le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et l’Association française pour les Nations unies.
* * *
J’étais, il y a quelques jours encore, au Parc de la Mémoire à Buenos Aires. À travers les témoignages des survivants et des descendants des victimes de disparitions forcées, j’ai pu mesurer l’ampleur d’une douleur toujours vive – une plaie toujours ouverte, faute de pouvoir accomplir un véritable travail de deuil.
En cette journée du 24 mars, nous honorons la mémoire d’un homme dont le courage et l’engagement demeurent une source d’inspiration à travers l’Amérique latine et le monde : Monseigneur Óscar Romero, archevêque de San Salvador. Figure de résistance face à l’oppression, il s’est dressé avec force contre les assassinats, les actes de torture et les exactions perpétrées par la dictature militaire salvadorienne. Il a dénoncé sans relâche la violence d’État et l’injustice sociale qui maintenaient dans la peur et la pauvreté les paysans de son diocèse.
Le 23 mars 1980, dans la basilique du Sacré-Cœur de San Salvador, il a lancé un appel aux soldats, les exhortant à la désobéissance et les enjoignant à ne plus être les instruments de la répression.
Le lendemain, il y a 45 ans jour pour jour, il est assassiné d’un coup de fusil en pleine messe.
Aujourd’hui, en sa mémoire, je tiens à rendre hommage aux victimes des violations des droits de l’Homme, celles dont les noms sont connus et celles dont l’histoire demeure dans l’ombre.
J’exprime mon soutien et ma solidarité aux victimes de disparitions forcées et à leurs familles, aux victimes d’exécutions sommaires, à celles et ceux que l’on a tenté de réduire au silence et dont l’existence a été marquée par la violence et l’injustice.
Mais je veux aussi saluer celles et ceux qui, chaque jour, œuvrent pour la vérité, comme beaucoup d’entre vous dans cette salle :
Les défenseurs des droits humains, qui luttent pour un monde plus juste, parfois au péril de leur sécurité.
Les journalistes et reporteurs, qui enquêtent et documentent les exactions et les violences.
Les professeurs, qui enseignent aux nouvelles générations l’importance de la mémoire et du respect des droits fondamentaux.
Les magistrats et avocats, qui portent la vérité devant la justice et combattent l’impunité.
Je salue votre courage et votre engagement en tant qu’Ambassadrice pour les droits de l’homme, mais aussi en tant qu’ancienne magistrate.
Ma longue expérience dans la magistrature me permet de mesurer pleinement à quel point la quête de vérité est un combat exigeant et difficile. Partout dans le monde, elle se heurte à des obstacles politiques, juridiques et culturels, dressés par ceux qui cherchent à la déformer ou à l’étouffer.
Mais j’ai aussi appris que la vérité constitue une nécessité absolue : elle est le socle de la justice, la condition de la dignité et un lien indéfectible entre les peuples et leur histoire.
Le droit à la vérité n’est pas un privilège, il est un droit inaliénable des victimes de violations flagrantes des droits de l’Homme et de leurs proches. Mais il ne concerne pas uniquement celles et ceux qui ont été brisés par la violence et l’oubli, il concerne l’ensemble de nos sociétés.
Les familles des victimes des disparitions forcées, qui portent en elles la douleur de l’incertitude, ont été parmi les premières à revendiquer ce droit, ouvrant la voie à des combats qui sont encore les nôtres aujourd’hui.
C’est pourquoi la France et l’Argentine se sont engagées dans la lutte contre les disparitions forcées. À leur initiative, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 20 décembre 2006, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, entrée en vigueur en 2010.
Ce texte fondamental affirme dans son préambule le « droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue ». Il rappelle également la responsabilité de l’État dans la recherche des disparus, leur localisation et leur libération, et, en cas de décès, dans la restitution de leurs restes dans la dignité.
Depuis son adoption, la France œuvre activement pour la ratification universelle et la mise en œuvre effective de cette Convention, qui a bénéficié en 2024 de cinq nouvelles ratifications : Afrique du Sud, Bangladesh, Côte d’Ivoire, Pologne et Thaïlande.
Un tournant majeur a également été franchi cette année avec la tenue du premier Congrès mondial sur les disparitions forcées, à Genève, les 15 et 16 janvier, sous l’impulsion d’Emmanuel Decaux, d’Olivier de Frouville et de Claire Callejon. Cet événement, coparrainé par la France, l’Argentine, le Maroc et le Samoa, a souligné la nécessité de renforcer les cadres juridiques et institutionnels pour lutter sans relâche contre l’impunité, d’optimiser les mécanismes de recherche des disparus et de soutenir les processus de mémoire et de réparation.
Lors de ce congrès, la France a pris une série d’engagements forts, l’un d’eux est celui qui nous réunit aujourd’hui puisqu’il s’agit d’organiser chaque année un événement à l’occasion de la Journée internationale pour le droit à la vérité.
Nous le savons, le combat pour la vérité n’appartient pas au passé. Il fait face aujourd’hui à de nouveaux défis. Si les nouvelles technologies sont un outil précieux pour documenter et exposer les violations des droits humains, elles sont aussi devenues un terrain de prolifération de la désinformation, du négationnisme et du complotisme.
Face à cette menace, j’espère que cette journée nous invitera à une réflexion sur la responsabilité et les moyens d’action des États et des membres de la société civile pour ne pas laisser l’histoire être réécrite par ceux qui veulent effacer leurs crimes. La vérité ne peut être un acquis figé ; elle doit être un engagement vivant, un effort constant pour identifier, reconnaître et réparer les injustices passées et présentes. Elle doit être un rempart aux attaques constantes contre la démocratie et l’État de droit.
C’est pourquoi je tiens à remercier chaleureusement tous nos intervenants et intervenantes, qui partageront avec nous leurs réflexions et leurs expériences sur les défis du droit à la vérité.
Avant de céder la parole à Monsieur l’Ambassadeur, je souhaiterais rappeler, en dernier lieu, ces mots de Monseigneur Óscar Romero, qui résonnent encore aujourd’hui avec une force singulière : « La paix n’est pas le produit de la terreur ou de la peur. La paix n’est pas le silence des cimetières. La paix n’est pas le résultat silencieux d’une répression violente. La paix est la contribution généreuse et tranquille de tous au bien de tous. La paix est dynamisme. La paix est générosité. C’est un droit et c’est un devoir. »
Je vous remercie.
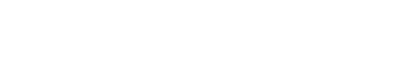

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
