L’Association française pour les Nations Unies (AFNU) et le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ont organisé le 24 mars 2025, au Quai d’Orsay, une conférence marquant la Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l’homme et pour la dignité des victimes[1].
Cette initiative s’inscrit dans le sillage du premier Congrès mondial sur les disparitions forcées qui s’est tenu le 15 et 16 janvier 2025 à Genève, avec le soutien du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies et des autorités de la Confédération helvétique, en tant que pays-hôte – ce qui a grandement facilité l’accès des représentants de la société civile au Congrès – ainsi qu’un important engagement politique de la diplomatie française, que ce soit à Paris avec l’ambassadrice Béatrice Le Frapper du Hellen, la directrice des Nations Unies et des organisations internationales (NUOI) du ministère ou avec l’ambassadeur Jérôme Bonnafont, le représentant permanent de la France à Genève.
Le Congrès mondial a créé une dynamique « multi-acteurs » en vue d’une ratification universelle de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en réunissant des Etats et des ONG venues de tous les continents ainsi que des experts onusiens et des représentants d’organisations régionales. C’est dans ce cadre, que les divers participants ont présenté des engagements volontaires (pledges)[2].
Parmi les engagements assumés au nom de la France, figure notamment « la communication, grâce aux outils numériques, afin de toucher le public le plus large possible ; par exemple à l’occasion de la Journée internationale sur la vérité et de la Journée consacrée aux victimes de disparition forcée ». C’est tout le sens ce cette première réflexion publique sur le droit à la vérité dont il convenait de garder la trace, à défaut d’une diffusion en direct. En ce sens, le CRDH s’honore de publier dans la revue Droits fondamentaux, un dossier reprenant l’essentiel des contributions présentées le 24 mars.
La problématique du « droit à la vérité » dans sa relation avec la reconnaissance de « la dignité des victimes » qui est au cœur de la convention de 2006 est vertigineuse, dans un contexte international où la notion même de vérité est remise en cause, en pratique, avec les fake-news, comme en théorie, avec les « vérités alternatives ». Dans une première table ronde, nous avons mis l’accent sur les composantes du droit à la vérité, à partir des « Principes Joinet », mais aussi sur les risques de « déni de la vérité » qui sont inhérents à la définition même du crime de disparition forcée, allant de la désinformation au négationnisme. Une troisième intervention, avec le témoignage de Taher Hijazi, lauréat de « l’initiative Marianne » et fondateur de l’ONG Justice Paths qui portait sur la situation en Syrie depuis l’attaque chimique de 2013 dans la Ghouta, n’a pu être transcrite[3].
Une seconde table ronde est consacrée à l’autre facette de la question, avec les différentes modalités du devoir de vérité, qu’il s’agisse de la préservation de la mémoire historique, à travers l’accès aux archives, de l’établissement des faits (fact-finding) avec l’utilisation des nouvelles technologies au service des enquêtes internationales et enfin de la dimension judiciaire, avec la recherche des preuves pénales visant une « vérité judiciaire ».
La séance ouverte par Isabelle Rome, ambassadrice pour les droits de l’homme, qui avait été une protagoniste du Congrès mondial, tout comme Olivier de Frouville, président du Comité des disparitions forcées[4], a été conclue par François Vandeville, au nom de la direction générale de la mondialisation. Il faut souhaiter que cette synergie perdure, afin de mettre en œuvre l’ensemble des engagements volontaires souscrits par la diplomatie française[5].
[1] Cette journée internationale a été instituée par une résolution de l’Assemblée générale adoptée le 21 décembre 2010, afin de marquer la date de l’anniversaire de l’assassinat de Mgr Óscar Romero survenu le 24 mars 1980 à San Salvador (Assemblée générale, Désignation du 24 mars comme Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l’homme et pour la dignité des victimes, résolution adoptée le 21 décembre 2010, Nations Unies, doc. A/RES/65/196).
[2] Pour la présentation et le bilan du Congrès, voir le site dédié : www.cedi193.org.
[3] Mais on trouvera les interventions de M. T. Hijazi sur internet, notamment le message enregistré à l’occasion de la journée du 24 mars sur le compte Instagram de la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à Genève.
[4] Le message d’ouverture enregistré par Olivier de Frouville est aussi disponible sur le compte Youtube de l’AFNU.
[5] À ce titre, en tant que président de l’Initiative pour la Convention sur les disparitions forcées (CEDI) qui a été le maître d’œuvre du Congrès, je tiens à remercier la petite équipe qui s’est mobilisée autour de Claire Callejon, avec enthousiasme, disponibilité et efficacité, pour déplacer les montagnes.
ANNEXE : ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LA FRANCE
Premièrement, la France renforcera son action diplomatique en faveur de l’universalisation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en ciblant les efforts, au niveau régional, sur les pays membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas ratifiée. Durant l’été 2024, la France, avec l’Argentine a lancé une nouvelle campagne de démarches bilatérales conjointes auprès de 125 pays ; cinq nouveaux pays sont devenus États parties en 2024. La France poursuivra sa mobilisation dans les années à venir avec l’Argentine et ses partenaires.
Deuxièmement, l’exigence de justice est au cœur du combat contre les disparitions forcées. Lutter contre les disparitions forcées, c’est lutter contre l’impunité du temps qui passe, nous disait Louis Joinet. Dans cet esprit, la France soutiendra les mécanismes régionaux et internationaux en la matière. La place des victimes au sein de ces mécanismes est fondamentale, c’est la raison pour laquelle la France soutiendra la création et le renforcement réseaux de solidarité dirigés par les victimes.
Troisièmement, pour que justice soit rendue de manière systématique et efficace, la formation au traitement judiciaire des disparitions forcées est essentielle ; celle des acteurs de la chaîne pénale et celle des représentants du secteur des médias. La France s’engage à mettre la formation au centre de ses programmes de coopération bilatérale en la matière avec des pays clés : sur la question du traitement judiciaire des disparitions forcées, auprès des acteurs de la chaîne pénale (officiers de police judiciaire, juges, avocats, agents pénitentiaires et directeurs de prison, magistrats), mais aussi auprès de représentants du secteur des médias (presse, radio, télévision, blogueur) sur la définition de la disparition forcée, les obligations juridiques des États et les conséquences multiples pour les familles de disparitions forcées.
Quatrièmement, notre engagement ne doit pas se limiter aux acteurs de la lutte contre les disparitions forcées. La sensibilisation de la société entière est un élément de la prise de conscience collective. Dans cet objectif, la France s’engage à mobiliser son réseau diplomatique et consulaire partout dans le monde pour organiser des événements mémoriels, artistiques, culturels et de coopération technique sur ce sujet.
Cinquièmement, cette sensibilisation passe par la communication, grâce aux outils numériques, afin de toucher le public le plus large possible ; par exemple à l’occasion de la Journée internationale sur la vérité et de la Journée consacrée aux victimes de disparition forcée.
Sixièmement, pour que le combat contre les disparitions forcées se poursuive, un travail doit être fait auprès de la jeunesse. La France s’engage, conformément à l’article 24 de la Convention, à soutenir la création d’un réseau mondial de la jeunesse contre les disparitions forcées, de façon à ce que les organisations de jeunes puissent prendre part à cette cause et fassent entendre leur voix. Au-delà du respect de ces engagements et de leur concrétisation, la France met tout en œuvre pour mettre fin à ce crime en tout lieu, et apporter une réponse aux victimes et à leurs proches. Leur quête de justice et de vérité est la nôtre.
Sources : www.cedi193.org
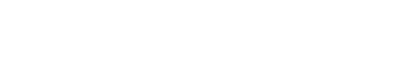

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
