L’auteure de la communication, de nationalité sri lankaise (§ 1), est une femme lesbienne ayant une expression de genre considérée comme « masculine » par les autorités (§ 2.1), militante pour les droits des personnes LGBTQIA+ (ndlr. sigle retenu par l’auteure de la note, en l’absence d’une terminologie fixe en droit international des droits humains) à Sri Lanka depuis 1999 (§ 2.4). En témoigne son poste actuel de directrice d’Equal Ground, une association qu’elle a fondé en 2004 (§ 2.5). En 1995, l’article 365 A du Code pénal sri lankais incriminant « les actes de grossière indécence », d’abord utilisé pour incriminer les relations sexuelles consentantes entre « personnes de sexe masculin », a été amendé en 1995 pour incriminer tout rapport consentant entre personnes du même sexe/genre (§ 2.3). Or, l’auteure ne l’apprend qu’en 1997 (idem), alors que le contrôle de constitutionnalité a posteriori d’une loi promulguée est impossible. En outre, en 2016, la Cour suprême a considéré que cette réforme était valide (§§ 2.8 et 6.2, voir également Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, « Observations finales concernant le huitième rapport périodique de Sri Lanka », 66ème session, 9 mars 2017, U.N. doc. CEDAW/C/LKA/CO/8, § 10 b)). Pourtant, selon l’auteure, cette loi a pour effet de légitimer et renforcer leur stigmatisation en les soumettant à un risque accru de discriminations, de violences et d’impunité (§ 2.7). Elle en est elle-même victime, ayant dû « changer sa façon de vivre et de se comporter en public » comme en privé, vivant dans la crainte permanente d’être arrêtée (§ 2.7). Compte tenu de cette législation, elle n’a pas plus été en mesure de dénoncer auprès des autorités les actes dont elle aurait été la cible, notamment en raison de son militantisme, comme par exemple le fait qu’en 2013, des autorités étatiques l’accusent publiquement de propager l’homosexualité et la pédophilie ou encore qu’en 2014, son association soit placée sous surveillance (§§ 2.4-2.6).
Afin que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après, « le Comité ») puisse se prononcer et constater, le cas échéant, des violations de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après, « la Convention »), l’auteure doit tout d’abord démontrer que l’incrimination des relations entre personnes de même sexe/genre, formulée désormais en des termes généraux, discrimine davantage les femmes et leur fait courir plus de risques qu’aux hommes. Pour l’auteure de la communication, cette asymétrie provient du croisement de deux facteurs de discrimination la concernant : une femme et une « minorité sexuelle ». L’article 365 A du Code pénal porterait donc atteinte au droit à la non-discrimination garanti par l’article 2 al. a) et d) à g) de la Convention (§ 3.1). De plus, l’inaction de l’État – en l’absence de toute modification ou abrogation de l’incrimination litigieuse – à combattre les actes de discrimination elle est victime, également en tant que militante, constituerait une violation nette de l’article 2 f) et g) de la Convention obligeant les États à prendre « toutes les mesures appropriées […] pour modifier ou abroger toute loi [y compris pénale] qui constitue une discrimination à l’égard des femmes » (§ 3.2). En outre, eu égard aux effets de l’incrimination sur la sécurité des femmes (voir supra), l’État ne s’acquitterait pas de son obligation de respecter et de protéger l’auteure des violences de genre au titre de l’article 2 al. c) à g) de la Convention, lu à la lumière de la Recommandation générale n° 35 du Comité, portant sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre (2017, U.N. doc. CEDAW/C/GC/35) (§ 3.3). Par ailleurs, l’incrimination des relations entre personnes de même sexe/genre étant fondée sur « des postures patriarcales fix[ant] les rôles de genre et réduis[ant] les femmes à leur simple fonction reproductive », elle légitimerait des stéréotypes de genre négatifs, que l’État a pourtant l’obligation de « modifier » au titre de l’article 5 al. a) (§ 3.4). Par cet argument, l’auteure souligne que ce sont les mêmes concepts et « structures » qui « fond[ent] la plupart des injustices – notamment celles que subissent les femmes et les personnes LGBT » (AGNU, « Rapport de l’Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Pratiques d’exclusion », 76ème session, distr. 15 juillet 2021, U.N. doc. A/76/152, § 77). Enfin, cette incrimination porterait atteinte à « [l’]autonomie [notamment sexuelle] », « à [la] liberté de choix », ainsi qu’à « [l’]autodétermination individuelle » de l’auteure. L’État violerait ainsi l’article 16 de la Convention garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes « dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux », autrement dit, en matière de vie privée familiale, affective et sexuelle (§ 3.5, transposant la « jurisprudence » constante depuis l’affaire Toonen c. Australie en 1994 en matière de droit à la vie privée [Comité des droits de l’homme, communication n° 488/1992, U.N. doc. CCPR/C/50/D/488/1992, spéc. §§ 8.3-10]). En ce sens, la tierce intervention de Dianne Otto, professeure de droit spécialiste des inégalités liées au sexe, au genre et aux orientations sexuelles, présentée à la demande de l’auteure (§ 7.3), met notamment l’accent sur les discriminations subies par l’auteure, fondées sur son statut familial, en tant que femme non mariée (§ 7.4).
À la lumière de l’obligation incombant aux États d’abroger les dispositions pénalisant les relations entre personnes de même genre/sexe, réaffirmée à plusieurs reprises par les organes de traités des Nations Unies depuis l’affaire Toonen c. Australie devant le Comité des droits de l’homme (précitée ; pour des exemples en ce sens, voir Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Born free and equal. Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics in International Human Rights Law, 2nde édition, HR/PUB/12/06/Rev.1, Genève, 2019, pp. 42-46), cette espèce ne laisse que peu de doutes quant au constat par le Comité de la violation par le Sri Lanka d’un certain nombre de droits de la Convention à l’endroit de l’auteure. Cela est d’autant plus prévisible que, dès 2011, le Comité avait déjà recommandé de réformer la législation (§ 9.2, citant « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Sri Lanka », 2011, U.N. doc. CEDAW/C/LKA/CO/7, § 24 ; voir toutefois surtout le § 25 g), rappelé dans les « Observations finales » de 2017, précitées, § 23). L’État semble d’ailleurs le reconnaître implicitement lui-même quand, comme le souligne l’auteure (§ 5.3), il évoque de futures potentielles réformes de l’article 365 A (§ 4.5) tout en se défendant l’existence de « loi[s] autorisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle » (§ 6.1) !
Par conséquent, l’État ne peut que déplacer le débat sur le terrain de la recevabilité afin de mettre en échec la communication, à travers trois arguments.
Premièrement, il argue son irrecevabilité ratione temporis (§ 4.4). Le Comité rejette cet argument en raison de la potentielle « violation continue » des droits de l’auteure, l’article 365 A du Code pénal demeurant tel qu’amendé par la loi de 1995, postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention (§§ 5.2 et 8.5 ; en ce sens, voir également Comité contre la torture, constatations du 12 mai 2022, Elizabeth Coppin c. Irlande, communication n° 879/2018, U.N. doc. CAT/C/73/D/879/2018, § 6).
Deuxièmement, selon l’État, l’auteure n’aurait pas épuisé les voies de recours internes. Il invoque alors successivement les recours en réparation pour violation des droits fondamentaux par les personnes publiques et d’« intérêt public » devant la Cour suprême (§ 4.1) ; la saisine des tribunaux ordinaires en cas de violations des droits fondamentaux par des personnes privées (§ 4.1) ; ou encore d’autres recours non-judiciaires (§ 5.1), notamment devant la Commission sri-lankaise des droits de l’homme (§ 4.2). D’emblée, le Comité rappelle qu’il n’est pas obligé d’envisager « les recours non judiciaires aux fins de la recevabilité » (Comité des droits de l’homme, constatations du 17 mars 2017, Purna Maya c. Népal, communication n° 2245/2013, U.N. doc. CCPR/C/119/D/2245/2013). En outre, il ne peut évaluer si ces procédures auraient pu permettre à l’auteure d’obtenir la réparation des dommages découlant de l’article 365 A du Code pénal, dès lors qu’il est impossible en toute hypothèse de contester a posteriori une loi adoptée devant les tribunaux (§ 8.4). Enfin, si l’État admet l’impossibilité de contester a posteriori la constitutionnalité d’une loi, il argue de la possibilité de la contester a priori, préalablement à sa promulgation (§ 4.2), pendant une semaine après son inscription à l’ordre du jour du Parlement (§ 7.1), suggérant même qu’en n’ayant pas exercé ce recours, l’auteure aurait donc accepté la constitutionnalité de l’article en question (§ 6.2) ! Soulevant l’exception classique tenant à l’effectivité des voies de recours internes, le Comité estime qu’il « n’est [à nouveau] pas en mesure de vérifier » si l’auteure aurait pu « effectivement » solliciter le contrôle a priori de la loi, compte tenu tant du délai d’une semaine que du fait que l’État n’a pas expliqué comment concrètement elle aurait pu exercer ce recours « en temps voulu » (§ 8.3 [notre accentuation]).
Troisièmement et dernièrement, la communication ne serait pas « suffisamment étayée », notamment eu égard à la caractérisation des violations de la Convention à l’encontre de l’auteure (§ 4.3), suggérant même qu’une partie de ses allégations « s’appui[e] sur des scénarios hypothétiques ou relèv[e] de la conjecture » (§ 6.3). A contrario, le Comité souligne que les allégations de l’auteure portent sur « les effets » de l’incrimination à son encontre, (§ 8.6 ; en ce sens, voir CEDH, Pl., arrêt du 22 octobre 1981, Dudgeon c. Royaume, req. n° 7525/76, § 41), concluant ainsi à la recevabilité de la communication (§ 8.7).
Sur le fond, le Comité constate sans surprise et sans réticence de la part d’un membre du comité, la violation d’un certain nombre de droits de la Convention. Toutefois, ces constatations dépassent l’approche « classique » en matière de protection des droits des personnes LGBTIQA+, souvent centrée autour de la protection du droit à la vie privée, ainsi que le souligne Kseniya A. Kirichenko (« Queer Intersectional Perspective on LGBTI Human Rights Discourses by United Nations Treaty Bodies », Australian Feminist Law Journal, vol. 49, n° 1, 2023, pp. 55-70, spéc. pp. 65-66). En effet, selon cette analyse, en insistant systématiquement sur les trois facteurs – être une femme, lesbienne et militante – exposant l’auteure de la communication à la discrimination et à la violence, le Comité semble consolider une lecture pouvant être qualifiée d’intersectionnelle et queer, des droits et obligations de la Convention ainsi que de la situation de la requérante/des faits de l’espèce (Ibid.).
D’abord, le Comité juge que l’auteure est victime des discriminations croisées tant directes qu’indirectes découlant de l’article 365 A du Code pénal. En ne l’abrogeant pas, l’État viole par conséquent l’article 2 al. a) et d) à g) (§ 9.2). En outre, ce dernier n’ayant ni « réfuté » les allégations selon lesquelles l’article litigieux « [aggrave] les violences fondées sur le genre subies par les femmes […] dont [l’auteure de la communication] est elle-même l’objet » ni « précis[é] les mesures juridiques ou autres prises pour respecter et protéger [son] droit à une vie exempte de violences de genre », le Comité constate une violation de l’article 2 al. c) à f), lu conjointement avec les deux Recommandations n° 19 de 1992 (« Violence à l’égard des femmes », 1992, U.N. doc. A/47/38) et n° 35 (précitée) (§ 9.3). Rappelant ensuite la nécessité de « dépénaliser les relations homosexuelles entre personnes consentantes pour prévenir la violence, la discrimination et les stéréotypes de genre préjudiciables et protéger les personnes », le Comité fait également droit à l’argumentation de l’auteure relative à la violation de l’article 5 al. a) de la Convention, l’État ayant, de nouveau, échoué à « réfuter les allégations de l’auteure [et] précis[é] quelles mesures il avait prises pour éliminer les préjugés auxquels l’intéressée était exposée en tant que femme, lesbienne et militante » (§ 9.4 [notre accentuation]).
En outre, le Comité constate sua sponte la violation de deux articles de la Convention, évoqués dans la tierce intervention (§ 7.3 ; voir également K. A. Kirichenko, « Queer Intersectional Perspective on LGBTI Human Rights Discourses by United Nations Treaty Bodies », précité). D’un côté, rappelant la nécessaire participation active des femmes à la société civile pour atteindre « la démocratie, la paix et l’égalité des sexes » et l’impératif corolaire pour les États de les y encourager, le Comité estime que le Sri Lanka, en n’ayant pas protégé l’auteure du harcèlement, des abus et des menaces subis en sa qualité de militante des droits des personnes LGBTIQA+ et, a fortiori, en y ayant pris part, a violé le droit de l’auteure de « participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays » conféré par l’article 7 al. c) (§ 9.5). De l’autre côté, le Comité estime que l’incrimination « a engendré des difficultés bien plus lourdes pour l’auteure en tant que femme lesbienne », notamment dans l’exercice de son droit d’être protégée et d’obtenir des réparations, constatant alors une violation de l’article 15 par lequel l’État doit reconnaître « à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi » (§ 9.6 [notre accentuation]).
Enfin, le Comité réaffirme son approche inclusive des personnes protégées par la Convention, « les droits [qu’elle consacre] [appartenant] à toutes les femmes, y compris les lesbiennes, les bisexuelles et les femmes transgenres ou intersexes » (§ 9.7 [notre accentuation] ; voir en ce sens l’analyse de K. A. Kirichenko, « Queer Intersectional Perspective on LGBTI Human Rights Discourses by United Nations Treaty Bodies », précité, p. 63). Il en déduit que l’article 16 « s’applique également aux relations non hétérosexuelles » et en constate la violation (§ 9.7). Il est à noter que celui-ci consacre en son alinéa a) le droit de contracter mariage.
L’absence d’opinions dissidentes, envoie un signal fort et nécessaire en faveur du respect des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, eu égard aux dynamiques diplomatiques et nationales actuelles préoccupantes (voir en ce sens, par exemple, le dernier rapport d’Amnesty International, We are facing extinction. Escalating anti-LGBT sentiment, the weaponization of law and their human rights implications in select African countries, AFR 01/7533/2024, Londres, 2024, 64 p.). En outre, à travers son argumentation soucieuse de l’intersection des différents facteurs en raison desquels l’auteure a été triplement victime de discriminations et de violences – en tant que femme, lesbienne et militante – et son approche inclusive, le Comité s’oppose clairement aux tentatives de négation tant des droits des femmes que des droits des personnes LGBTQIA+ par leur « mise en concurrence » (voir AGNU, « Rapport de l’Expert indépendant (…) », précité, spéc. §§ 59-64) et souligne, au contraire, leur profonde interdépendance (Ibid., §§ 76-77, 81 et 82 c)).
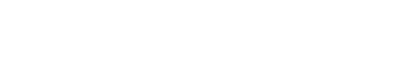

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
