Depuis l’adoption en 1876 par le Canada de la Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5), l’octroi à une personne du statut d’« Indien inscrit » (ci-après, « Indien ») via l’inscription de son patronyme au « registre des Indiens » (ci-après, « Registre ») lui permet l’accès à des droits réservés aux autochtones. Cette loi instaurait cependant une discrimination entre hommes et femmes en prévoyant la suppression du Registre du nom des femmes ayant épousé un homme non-inscrit, leur faisant perdre à la fois leur statut et le droit de le transmettre à leurs descendants. En 1985, à la suite de constatations rendues par le Comité des droits de l’homme en 1981 (Comité des droits de l’homme, Lovelace c. Canada, constatations du 30 juillet 1981, communication n°24/1977, doc. CCPR/C/OP/1), le Parlement du Canada modifia la loi en y ajoutant notamment un article 6 permettant aux femmes autochtones dont le nom avait été rayé du Registre d’y être de nouveau inscrites ainsi que de transmettre leur statut spécifique à leurs enfants. Ces derniers ne pouvaient toutefois voir leurs descendants inscrits (par. 6(2)), à moins que leurs deux parents le soient, ne faisant que prolonger les discriminations déjà existantes. Une réforme de 2011 modifia de nouveau la loi. Dorénavant, les enfants dont le nom de la mère avait été rayée du Registre, ou bien dont l’autre parent n’avait pas le droit d’être inscrit sur le Registre ou encore n’était pas Indien, pouvaient y être inscrits et transmettre, à leur tour, ce statut à leurs enfants. Toutefois, par application du paragraphe 6(2), leurs petits-enfants, quant à eux, ne pouvaient pas le transmettre à leurs descendants.
Tel était l’état de la loi sur les Indiens au moment où le requérant présentait en 2014 sa communication au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après, « le Comité »), en son nom et au nom de sa fille et de son fils. L’auteur de la communication fait partie de la Nation Squamish. La grand-mère de l’auteur avait épousé en 1927 un non-Indien, entraînant la suppression de son nom du Registre. En vertu de cette discrimination subie par sa grand-mère en tant que femme, l’auteur de la communication considérait que lui et ses enfants étaient victimes d’un préjudice dû à la violation des articles 1, 2 et 3 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (ci-après, « la Convention ») ratifiée par le Canada le 10 décembre 1981.
Dans son examen sur la recevabilité de la communication, le Comité met essentiellement l’accent sur deux points concernant le droit à agir : d’un part, la question du sexe de la personne pouvant présenter une communication sur le fondement de l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention adopté en 1999 (ci-après, « le Protocole ») ; et, d’autre part, la notion de victime directe, seule autorisée à présenter une communication sur le fondement dudit article 2. Dans ses observations, le Canada s’opposait à la recevabilité de la communication en fondant son argumentation sur le sexe du requérant considérant qu’en tant qu’homme il « ne pouvait pas prétendre être victime de violations au titre de la Convention » (§ 4.1). Le Comité rappelle que le Protocole, en utilisant le terme neutre de « particuliers » (§ 17.3) n’empêche pas un homme de pouvoir soumettre une communication au Comité. Pour ce faire, ce « particulier » doit toutefois être victime directe d’une violation de la Convention dont l’objectif est l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes comprise comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe » (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981, article 1er). En l’espèce, l’auteur de la communication est un homme fondant son action sur un préjudice dont la victime initiale est sa grand-mère. À cet égard, le Comité utilise ici pour la première fois la notion de préjudice transgénérationnel définie par la Cour pénale internationale comme « un phénomène de transmission entre ascendants et descendants d’une violence sociale provoquant des conséquences traumatisantes sur les descendants » (CPI, Chambre de première instance II, décision du 24 mars 2017, Le Procureur c. Germain Katanga, affaire n° ICC-01/04-01/07, § 132). Les membres du Comité reprennent ce concept en l’appréhendant à travers le prisme de la discrimination de genre en considérant que « les descendants, femmes ou hommes […], de femmes autochtones ayant perdu leur statut et le droit de décider de leur propre identité en raison des inégalités de genre imposées unilatéralement par l’État partie doivent être considérées comme des victimes directes […], sachant que le préjudice invoqué est le résultat direct de la discrimination fondée sur le genre dont ont été victimes leurs ancêtres maternelles » (§ 17.3, nous soulignons). C’est donc par le truchement de la notion de préjudice transgénérationnel que le Comité considère l’auteur de la communication comme une victime directe lui permettant, en conséquence, de pouvoir saisir le Comité. Grâce à ce développement juridique, le Comité élargit la notion de victime directe prévue à l’article 2 du Protocole et permet une adaptation spécifique de la notion aux préjudices subis par les peuples autochtones.
Concernant le fond de l’affaire, le Comité démontre que le préjudice transgénérationnel subi par l’auteur de la communication n’est que la résultante d’une discrimination intersectionnelle subie par les femmes autochtones, et ce en raison aussi bien de leur genre que de leur appartenance à une communauté autochtone. En effet, en déclarant que l’inscription au Registre permettrait de « détermine[r] qui est “Indien” afin d’assurer que ceux qui ont droit à l’inscription ont un degré de filiation suffisant […] avec les peuples historiques des Premières Nations » et que, partant, « l’inscription au registre des Indiens ne relève pas des droits humains » (§ 4.5), le Gouvernement canadien impose des conditions administratives discriminatoires et va à l’encontre du droit des peuples autochtones de « décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions » (Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007 dans sa résolution 61/295, art. 33). Un tel droit a été réaffirmé par la Cour interaméricaine des droits de l’homme déclarant que « l’identification de la Communauté, de son nom à sa composition, est un fait social et historique faisant partie de son autonomie » (CIADH, arrêt du 24 août 2010, Caso Comunidad indígena Xákmok Kásek v. Paraguay (fond, réparation et coûts), Série C, n° 214, § 37, notre traduction). En outre, en raisonnant de la sorte, le Gouvernement canadien a considéré « que le niveau de consultation des peuples autochtones n’[était] pas pertinent pour déterminer si les dispositions relatives à l’inscription [étaient] discriminatoires à l’égard des femmes » (§ 4.8) allant, de ce fait, à l’encontre de ce que la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme a considéré comme étant un principe général du droit international (CIADH, arrêt du 27 juin 2012, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador (fond et réparations), Série C, n° 245, § 164), le Comité précisant que : « le fait de ne pas consulter les peuples et les femmes autochtones chaque fois que leurs droits sont susceptibles d’être compromis constitue une forme de discrimination » (§ 18.11).
À la suite d’une nouvelle modification de la Loi au cours de la procédure devant le Comité, le Gouvernement canadien a considéré que ses dispositions « [n’étaient] plus source de discrimination fondée sur le genre » (§ 14.4). Or, la nouvelle version limite l’octroi du statut d’Indien aux personnes descendantes en ligne directe de personnes ayant droit à l’inscription et nées avant le 17 avril 1985. En imposant cette date de manière arbitraire, le Comité considère qu’une distinction discriminante persiste entre les personnes qui peuvent en bénéficier et continue d’aller à l’encontre du principe d’auto-identification reconnu aux peuples autochtones en excluant une partie des personnes pouvant prétendre au statut d’Indien. À juste titre puisque le Gouvernement canadien lui-même « reconnaît que […] le nouveau seuil d’exclusion nécessitera probablement des modifications législatives » (§ 16.2).
Huit mois après ces constatations, dans lesquelles le Comité contribua à la protection internationale des droits des peuples autochtones, ce dernier publia ses observations générales sur le droit des femmes et filles autochtones dans lesquelles il déclarait que « [l]es États doivent faire en sorte que les femmes et les filles autochtones puissent obtenir leur nationalité et leur statut autochtone, […] et les transmettre à leurs enfants et à leur conjoint, et aient accès à des informations sur ces droits dans le cadre de leurs efforts pour garantir le droit à l’autodétermination et à l’autoidentification » (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, « Recommandation générale n°39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones », adoptée le 31 octobre 2022, doc. CEDAW/C/GC/39, § 21). Le Canada, quant à lui, n’a pas, à l’heure actuelle, effectué les modifications recommandées par le Comité.
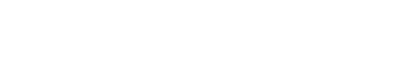

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
