L’affaire soumise au Comité des droits de l’homme évoque une arlésienne juridique française : le port du voile. Si celui-ci est prohibé dans les écoles publiques, les contours de cette interdiction interrogent.
L’auteure de la communication est une femme musulmane qui, en raison de ses convictions religieuses, porte un foulard couvrant ses cheveux (§ 2.1). Celle-ci s’est inscrite dans un groupement d’établissements publics chargé de la formation continue pour adultes afin de suivre une formation dans le but d’obtenir un BTS (§ 2.1). Ce groupement est localisé dans un lycée. L’auteure de la communication s’est vue refuser l’accès à l’établissement en raison de la loi du 15 mars 2004 qui, en son article premier, dispose que le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans les écoles, collèges et lycées publics (§ 2.2). Le port du voile ou du foulard islamique a été qualifié de signe manifestant ostensiblement l’appartenance religieuse (Conseil d’État, 5 décembre 2007, n° 295671, Ghazal). L’auteure a contesté cette décision devant les tribunaux internes, invoquant notamment une discrimination en raison de sa religion (§ 2.4). Le tribunal administratif a considéré qu’il n’avait pas été démontré l’existence de risques de troubles à l’ordre public, mais estime que le fait que les stagiaires de cette formation et les élèves du lycée se côtoient justifie la décision litigieuse (§ 2.4). La cour administrative d’appel a, pour sa part, considéré que cette possible rencontre entre les stagiaires en formation et les élèves du lycée est de nature à troubler l’ordre public dans cet établissement (§ 2.5). Faute de satisfaction devant les juridictions internes, l’auteure saisit le Comité et invoque une violation de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (§ 3.1) et des articles 18 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (§ 3.2).
Sur la recevabilité, le Comité note que, ratione materiae, il n’est pas compétent s’agissant du premier grief (§ 7.3). Sur les autres points, la recevabilité de la communication est admise sans difficulté.
Sur le fond, concernant l’invocation de violation de l’article 18 du Pacte, la restriction de l’exercice du droit à la liberté de manifester sa religion est aisément admise, d’autant que le Comité a déjà indiqué que la liberté de manifester sa religion englobe le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs (§ 8.3 ; Comité des droits de l’homme, « Article 18 (Liberté de pensée, de conscience et de religion) », Observation générale n° 22, 1993, U.N. doc. CCPR/C/21/Rev. 1/Add.4). Pour être conforme au Pacte, une ingérence à l’article 18 doit être prévue par la loi et nécessaire à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui (§ 8.4).
S’agissant de la base légale, le débat est particulièrement pertinent puisque les faits présentent une extension, de facto, de la loi de 2004 – puisque celle-ci ne s’applique théoriquement pas aux étudiants – en raison de la localisation de la formation au sein d’un lycée. Toutefois, selon le gouvernement, la jurisprudence du Conseil d’État sur la question de la laïcité, et notamment son avis du 27 novembre 1989, à l’application plus large que la loi de 2004, ainsi que des dispositions constitutionnelles constituaient, en l’espèce, une base légale suffisamment prévisible (§ 5.8). Le Comité opte pour une approche rigoureuse de la qualité de la base légale et affirme que ces normes « ne sont [pas] suffisamment précises pour permettre à un individu d’adapter son comportement en fonction de la règle ou à des personnes chargées de leur application d’établir quelles formes de manifestation de la religion ou de convictions sont légitimement restreintes et quelles formes de manifestation le sont indûment » (§ 8.8). Le Comité considère donc que l’ingérence n’est pas fondée sur une base légale. D’un point de vue comparatiste, notons que ce même avis de 1989 avait été jugé par la Cour de Strasbourg – certes, s’agissant de l’exclusion d’élèves de collège – comme une base légale suffisante (CEDH, arrêt du 4 décembre 2008, Dogru c. France, req. n° 27058/05, §§ 49-59). Les conditions fixées par l’article 18 – tenant à l’existence d’une base légale et à la nécessité de l’ingérence – semblant cumulatives, le Comité aurait pu conclure à la violation en constatant simplement l’absence de base légale. Le Comité poursuit toutefois l’analyse, probablement afin de renforcer le constat de violation.
S’agissant de la condition que la restriction puisse être considérée comme nécessaire à un des buts mentionnés à l’article 18 – à savoir la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui – le débat porte sur la possibilité de justifier l’ingérence par la protection de l’ordre public. Le Comité rappelle que les restrictions doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire et proportionnelles à celui-ci (§ 8.9 ; Comité des droits de l’homme, Observation générale no 22, précitée, § 8). Une nouvelle fois, le Comité s’appuie sur sa jurisprudence antérieure et rappelle sa « préoccupation quant à l’encadrement de la loi relative au port de signes religieux qualifiés d’‘‘ostensibles’’ dans les établissements scolaires publics » (§ 8.9 ; Comité des droits de l’homme, « Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la France », 3193ème séance, 2015, U.N. doc. CCPR/C/FRA/CO/5, § 22) et considère que le risque d’atteinte à l’ordre public n’est pas établi. Le Comité assure ainsi la cohérence avec sa jurisprudence, et notamment avec l’affaire Singh, dans laquelle il avait considéré que l’interdiction du port du turban devait être motivé par des « preuves convaincantes » de « menace pour les droits et libertés des autres élèves ou pour l’ordre au sein de l’établissement scolaire » (§ 8.9 ; Comités des droits de l’homme, constatations du 1er novembre 2012, Bikramjit Singh c. France, communication n° 1852/2008, U.N. doc. CCPR/C/106/D/1852/2008, § 8.7). Le Comité conclut donc, sans étudier la proportionnalité de l’atteinte au but poursuivi, à la violation de l’article 18.
Concernant l’invocation de violation de l’article 26, l’auteure considère qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire fondé sur sa religion (§ 3.5). L’État défendeur ne nie pas l’existence d’une différence de traitement, mais estime celle-ci fondée sur des critères raisonnables et objectifs, empêchant dès lors la qualification de discrimination indirecte (§ 5.11). Le Comité rappelle, comme il l’avait déjà énoncé dans le cadre de la fameuse affaire Baby-loup, que l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires pouvait constituer une discrimination intersectionnelle basée sur le genre et la religion (Comité des droits de l’homme, constatations du 16 juillet 2018, F.A. c. France, communication n° 2662/2015, U.N. docs. CCPR/C/123/D/2662/2015 et CCPR/C/123/D/2662/2015/Corr.1, § 8 ; Comité des droits de l’homme, « Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la France », 3193ème séance, 17 août 2015, U.N. doc. CCPR/C/FRA/CO/5, § 22). Pour être conforme aux exigences du Pacte, un traitement différencié doit être raisonnable et objectif (§ 8.14). Le Comité rappelle que l’interdiction du port du voile opposée à la requérante n’était pas prévue par la loi et n’avait pas de but légitime (cf. supra) et, partant, considère que le traitement différencié constitue une discrimination intersectionnelle basée sur le genre et la religion violant l’article 26 du Pacte (§ 8.14).
Si ces constatations ne sont pas particulièrement étonnantes compte tenu de la position du Comité sur la liberté de religion et ses corollaires (voir par exemple, Comité des droits de l’homme, Singh c. France, précitées), il n’en demeure pas moins intéressant de rappeler que le Comité a une position audacieuse, notamment si l’on compare celle-ci à celle de la Cour de Strasbourg (voir par exemple, CEDH, Dogru c. France, précité et CEDH, arrêt du 4 décembre 2008, Kervanci c. France, req. n° 31645/04 ; G. Gonzalez, « Bonne foi et engagements internationaux de la France en matière de liberté de religion », Revue du droit des religions, n° 2, 2016, pp. 171-175). En tout état de cause, cette affaire permet assurément d’interroger le « périmètre scolaire » prévu par la loi. En effet, les indications sur le statut des adultes suivant une formation professionnelle – particulièrement au sein d’établissements scolaires – à l’instar de celui des accompagnatrices voilées lors de sorties scolaires (voir par exemple, TA de Nice, 9 juin 2015, Madame D., n° 1305386), permettent de préciser la portée de la prohibition prévue par la loi de 2004.
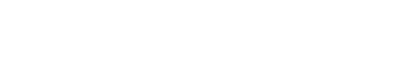

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
