En 1975, à l’âge de 15 ans, l’auteur de la communication a séjourné dans l’unité pour enfants et adolescents de l’hôpital psychiatrique public de Lake Alice, dirigée par le docteur Leeks. Il y aurait été traité par l’administration de chocs électriques, d’une électroconvulsivothérapie non modifiée et de médicaments, et aurait subi des coups et des viols (§ 2.1).
Ces traitements, également infligés à d’autres individus (Comité contre la torture, constatations du 4 décembre 2019, Paul Zentveld c. Nouvelle-Zélande, communication n° 852/2017, U.N. doc. CAT/C/68/D/852/2017), ont fait l’objet de procédures internes variées. D’abord, les plaintes déposées auprès du gouvernement et des organisations médicales en 1976 et 1977 n’ont entraîné aucune poursuite (§ 2.2). L’action civile intentée en 1999 a, quant à elle, conduit à des excuses générales de l’État partie, et au versement d’un paiement ex gratia à chaque victime (§ 2.3). La même année, le Conseil de l’ordre des médecins a radié le docteur Leeks et en a déduit qu’il ne pouvait plus enquêter sur les allégations de mauvais traitements (§ 2.4). En 2000, l’auteur de la communication a déposé une plainte pénale contre le personnel de l’hôpital, et le gouvernement a invité les autres victimes à faire de même. Toutefois, la police n’a clos l’enquête qu’en 2010, concluant à l’absence de motifs suffisants pour justifier des poursuites pénales, compte tenu, notamment, du temps écoulé depuis les événements (§ 2.5). En 2006, le Conseil des médecins de l’État de Victoria (Australie), où était venu exercer le docteur Leeks, s’est estimé incompétent pour se prononcer sur les plaintes déposées contre lui au motif qu’il venait de démissionner (§ 2.8). Enfin, en 2017, l’auteur a demandé – sans succès au jour de l’introduction de sa communication devant le Comité contre la torture en 2018 – la réalisation d’une enquête auprès du procureur général, de l’Ombudsman, de la Commission nationale des droits de l’homme et du ministère de la Justice (§ 2.8).
Devant le Comité, l’auteur allègue avoir subi une violation de ses droits reconnus par les articles 2 (prévention de la torture), 10 (formation du personnel), 11 (surveillance systématique), 12 (enquête impartiale et immédiate ex officio), 13 (droit de porter plainte et examen immédiat et impartial de la cause) et 14 (droit à réparation) de la Convention. En effet, il affirme avoir été victime de mauvais traitements et d’actes de torture à l’hôpital de Lake Alice, et reproche à l’État de ne pas avoir veillé à ce que le personnel médical réponde de ses actes, celui-ci n’ayant fait l’objet, en l’absence d’enquête effective, d’aucune sanction disciplinaire. En outre, les pratiques employées par l’établissement n’auraient été ni examinées par les autorités médicales, ni dénoncées, ni interdites. Enfin, le requérant n’aurait eu accès à aucune réadaptation adéquate (§§ 3.1 à 3.3).
Au stade de la recevabilité, l’examen est divisé en quatre étapes.
Premièrement, concernant la recevabilité ratione loci, le Comité déclare logiquement irrecevables les griefs concernant les décisions australiennes, au motif qu’il s’agit « d’actes commis en dehors de la juridiction de l’État partie » (§ 7.2), formule ne correspondant pas tout à fait à celle de l’article 22 (1) de la Convention.
Deuxièmement, s’agissant de la recevabilité ratione temporis, le Comité rappelle classiquement qu’un État partie est lié par ses obligations au titre de la Convention à partir de la date de son entrée en vigueur à son égard. Il ne relève curieusement pas que « l’interdiction de la torture […] était néanmoins universellement acceptée comme absolue à l’époque [des faits] » (Comité contre la torture, Paul Zentveld c. Nouvelle-Zélande, précitées, § 8.3). Cependant, il indique qu’il peut examiner les violations d’obligations conventionnelles procédurales postérieures à la date de la déclaration de l’État partie reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner les plaintes, et donc, éventuellement, des enquêtes portant sur des violations antérieures. En l’espèce, la déclaration de l’État partie au titre de l’article 22 (1) de la Convention a pris effet en 1990. Les traitements dont l’auteur aurait été victime en 1975 y sont donc antérieurs, mais le dépôt de sa plainte pénale en 2000, et la clôture de l’enquête en 2010 y sont postérieurs. Dès lors, si le Comité est incompétent ratione temporis pour se prononcer sur la violation de l’obligation substantielle de prévention de la torture issue de l’article 2 (1) de la Convention, il peut examiner celle de l’obligation positive procédurale d’enquêter, tirée des articles 12 et 13 de la Convention (§ 7.3-7.5). Il convient de souligner que ce raisonnement, fondé sur la technique de la « détachabilité », dissociant, pour un même droit, les obligations matérielles d’une part, et celles procédurales d’autre part, apparaît nettement plus convaincant que celui retenu dans l’affaire Coppin c. Irlande, tranchée le même jour. Le Comité y adopte en effet une conception discutable de la notion de violation continue, peu adaptée aux circonstances de l’espèce, et ce sans distinguer explicitement entre les différents volets des obligations (Comité contre la torture, constatations du 12 mai 2022, Elizabeth Coppin c. Irlande, 12 mai 2022, U.N. doc. CAT/C/73/D/879/2018, § 6. Cf. supra, la note de M. Dahhan, pp. 44-46).
Troisièmement, quant à l’épuisement des voies de recours internes, le Comité considère implicitement que les voies invoquées par l’État n’avaient pas à être épuisées, au motif qu’elles ne pouvaient remplacer une enquête pénale ou établir une responsabilité pénale (§ 4.5 et4.6 ; § 7.6).
Quatrièmement, le Comité déclare manifestement mal fondés, car non étayés, les griefs tirés de la violation des articles 10 et 11, mais constate la recevabilité du grief, fondé sur les articles 12 et 13, selon lequel l’État n’a pas veillé à ce qu’une enquête adéquate soit menée, et à ce que les responsables rendent compte des traitements subis par l’auteur, ce qui emporte des conséquences sur le plan procédural du droit à la justice et à la vérité, relevant de l’article 14 (§§ 7.7 et 7.8).
Le Comité se penche ensuite, au fond, sur la question de savoir si les autorités ont examiné immédiatement et impartialement les allégations de sévices infligés à l’auteur, conformément aux articles 12 et 13. De manière générale, chaque État partie doit réparer les actes de torture, en particulier ceux commis à l’encontre de groupes vulnérables placés sous sa garde, comme les enfants et les malades mentaux. Sa responsabilité est engagée si les autorités avaient des « motifs raisonnables de penser que des actes de torture » ont été commis, et n’ont pas exercé « la diligence voulue pour […] mener une enquête ou engager une action contre leurs auteurs », l’État approuvant alors tacitement lesdits actes et permettant l’impunité (Comité contre la torture, « Application de l’article 2 par les États parties », Observation générale n° 2, 2007, U.N. doc. CAT/C/GC/2, § 15, 18 et 21 ; voir en ce sens, dans les présentes constatations du Comité, § 8.6). Plus précisément, le Comité réitère que les États parties ont l’obligation de prendre les mesures raisonnables pour mener une enquête pénale permettant d’établir les faits et d’identifier et sanctionner les responsables (§ 8.2). Or, en l’espèce, au regard de la gravité des allégations, de la vulnérabilité de la victime alors mineure, du caractère routinier et punitif des traitements auquel a conclu un juge, de l’intérêt public continu pour cette affaire historique, et des recommandations d’enquête et de poursuite déjà adressées par le Comité à l’État partie, ce dernier n’a pas fait les efforts nécessaires pour établir les faits, ni pour reconnaître et qualifier les traitements infligés à l’auteur, atteignant pourtant le seuil de la torture (§§ 8.3 à 8.5).
À cet égard, le Comité tient compte de la modification de certaines pratiques à la suite de ses constatations Zentveld c. Nouvelle Zélande, ainsi que des poursuites pénales engagées en 2022 contre d’anciens membres du personnel hospitalier, mais remarque que l’un d’eux est particulièrement âgé et que les deux autres, dont le docteur Leeks, ne pourront être jugés, quand bien même des plaintes relatives à ces faits sont déposées depuis 1976. Il doute également de l’efficacité de l’enquête en raison du délai séparant les deux enquêtes pénales ayant abouti à des résultats opposés en 2010 et en 2021, et de la reconnaissance d’erreurs commises par la police lors des précédentes investigations (§§ 8.6 à 8.9).
À la lumière de ces éléments éparpillés, le Comité considère que l’État partie a violé les articles 12 et 13 de la Convention en ne procédant, ni ex officio, ni à la suite de plaintes, à une enquête immédiate et impartiale des allégations (pour un constat de non-violation de ces obligations dans le cadre d’une affaire dont les faits sont relativement proches de ceux de l’espèce, voir les constatations Elizabeth Coppin c. Irlande précitées, §§ 11.2 à 11.4, et la note précitée de M. Dahhan à laquelle elles ont donné lieu). Il conclut également à la violation du droit d’obtenir réparation, prévu par l’article 14, en affirmant, a priori à tort (§ 4.15), qu’elle n’est pas contestée (§ 8.10 et 8.11). Il reste que l’absence d’enquête ou de poursuites quant à des allégations de torture peut constituer un déni de ce droit (Comité contre la torture, « Application de l’article 14 par les États parties », Observation générale n° 3, 2012, U.N. doc. CAT/C/GC/3, §§ 16 et 17).
Le Comité demande alors à l’État de procéder à un examen juridictionnel, en temps utile, des allégations de torture de l’auteur de la communication, d’en sanctionner, le cas échéant, les responsables, et de lui accorder une réparation appropriée (§ 10).
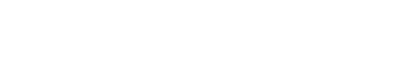

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
