Entre 1964 et 1968, de ses 14 à ses 18 ans, la requérante a été placée dans les « Magdalene Laundries », congrégations religieuses rattachées à l’État irlandais, dans lesquelles elle indique avoir été soumise à de la torture et à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (§ 2.1). Elle affirme avoir été soumise à de nombreuses reprises à des humiliations délibérées, à un déni d’identité, d’éducation et d’intimité, ainsi qu’à des formes graves d’abus physique et psychologique (§ 2.3). Au surplus, elle indique que les événements subis entre 1964 et 1968 ont eu des effets graves et préjudiciables sur sa santé physique et psychologique (§ 2.5).
Entre 1997 et 1998, la requérante a déposé une plainte sans succès auprès de la police irlandaise eu égard au délai de prescription de douze mois (§ 2.6). En 1999, la requérante a entamé une procédure civile devant la High Court qui fut annulée et déclarée irrecevable du fait d’un retard « démesuré et inexcusable » (§ 2.7). La requérante n’a pas fait appel de cette décision et la procédure fut abandonnée en 2002 (§ 2.7). Entre 2000 et 2013, l’Irlande a mis en place plusieurs mécanismes d’enquête et de réparation. En premier lieu, une Commission d’enquête sur la maltraitance des enfants dans les institutions de redressement ainsi qu’un Conseil de réparation des établissements de redressement chargé de réparer financièrement les victimes de maltraitance ont été mis en place en 2000, sans toutefois reconnaître la responsabilité étatique ou celle de la congrégation religieuse (§ 2.8). La réparation était accordée aux victimes sous condition d’une renonciation à tout droit de poursuite en justice, ce que la requérante a accepté (§ 2.8). En deuxième lieu, l’Irlande a instauré, en 2011, un Comité intergouvernental afin d’établir le degré d’implication de l’État dans les « Magdalene Laundries » qui, dans son rapport, a identifié l’implication directe de l’État dans 26 % des cas (§ 2.10). À la suite de la publication de ce rapport, le juge John Quirke fut nommé afin de concevoir un système d’indemnisation et de soutien aux victimes (§ 2.10). Enfin, en dernier lieu, le gouvernement a mis en place le « Magdalene Laundries Restorative Justice Scheme » dont la requérante a pu bénéficier en renonçant toutefois à son droit d’action en justice (§ 2.11).
Le 25 juillet 2018, la requérante demande au Comité contre la torture de constater la violation continue des articles 12 à 14 lus seuls et conjointement avec l’article 16 de la Convention garantissant respectivement le droit à une enquête impartiale, le droit de porter plainte, le droit d’obtenir réparation et enfin, l’obligation de l’État d’interdire dans tout territoire sous sa juridiction les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par un agent ou représentant de la fonction publique (§§ 3.1-3.5).
Lors de l’examen préliminaire, le Comité contre la torture estime que la requête est recevable. D’une part, le Comité indique que l’État partie n’avait pas produit d’éléments indiquant qu’un recours utile était disponible ou que d’autres recours pourraient apporter une réparation effective (§ 6). D’autre part, c’est précisément en ce point que réside tout l’intérêt de cette affaire, le Comité reconnaît de façon péremptoire sa compétence ratione temporis sur la base d’une notion juridique bien connue, celle de « la violation continue » (§6). La violation continue peut s’identifier lorsqu’une série d’actes ou d’omissions entrainant une violation débute avant et se poursuit après l’entrée en vigueur de l’instrument de protection (Cour ADHP, arrêt du 26 mai 2017, Comm. ADHP c. Kenya, requête 006/2012, §§ 64-66). Elle a pour conséquence d’étendre le domaine de compétence ratione temporis des organes de protection, au-delà de la date critique du consentement étatique, et par conséquent, d’étendre leur aptitude à connaître et à traiter d’une affaire. Une seconde technique, celle de la détachabilité, permet de parvenir au même résultat en dissociant l’obligation matérielle et procédurale d’un même droit (Cour EDH [GC], arrêt du 9 avril 2009, Silih c. Slovénie, n°71463/01, §§150 à 159, Cour IADH, 20 novembre 2007, Garcia Prieto et autres c. El Salvador Série C n°168. § 28). Bien que la jurisprudence entretienne une confusion étroite entre ces deux techniques (Comm. IADH, arrêt du 9 décembre 1998, Azocar et autres c. Chile, série C, §27), les dissocier paraît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique. En l’espèce, il ne s’agissait pas tant d’une violation continue comme indiqué par le Comité en ce que les prétendus actes de torture et de traitements dégradants subis dans les « Magdalene Laundries » par la requérante entre 1964 et 1968 ont pris fin avant l’entrée en vigueur du traité en Irlande. En réalité, le Comité était amené à se prononcer sur des violations de droits procéduraux distincts liés à la violation du droit à ne pas être soumis à des actes de torture ou des actes constitutifs de traitements dégradants (article 16) et ayant eu lieu après l’entrée en vigueur de la Convention contre la torture. Les droits à une enquête impartiale (article 12), à un recours effectif (article 13) ou encore à obtenir réparation (article 14), demeurent pour autant des droits bien distincts et par conséquent n’entrent pas non plus dans la catégorie de la détachabilité. A moins d’admettre que le droit à la vérité, à la justice et à la réparation tels que définis dans les « principes Joinet », sont en eux-mêmes des droits substantiels qui ne sont pas prescrits au nom de la lutte contre l’impunité (cf. le dernier rapport de F. Salvioli, A/HRC/54/24).
Au fond, le Comité examine les griefs formulés au titre des articles 12, 13, 14 et 16 de la Convention.
Sur le grief formulé au titre de l’article 12, alors que la requérante allégeait que l’État partie n’a pas mené d’enquête rapide, impartiale et approfondie, le Comité estime que l’État a pris les mesures nécessaires pour mener à bien une enquête efficace, objective et rapide, écartant toute violation de l’article 12 de la Convention (§ 11.3).
Sur le grief tiré de l’article 13, le Comité relève que la requérante n’a pas fait appel de la décision de radiation de l’affaire prononcée par la High Court, que cette dernière a reçu deux indemnités de réparation, signé deux renonciations et que des enquêtes pénales ont été ouvertes bien qu’elles n’aient pas permis d’établir de responsabilité. Dès lors, le Comité considère que l’État partie a rempli ses obligations en procédant aux examens nécessaires des demandes de la requérante par les autorités compétentes (§ 11.4).
Sur les griefs tirés de l’article 14, le Comité faisant référence à son Observation générale n° 3 (Comité contre la torture, « Application de l’article 14 par les États parties », 2012, U.N. doc. CAT/C/GC/3) met en exergue deux points fondamentaux. De prime abord, le fait pour un État de ne pas mener d’enquête, de ne pas engager de poursuites pénales ou de ne pas autoriser de procédures civiles liées à des allégations de torture peut constituer une violation des obligations de l’État au titre de l’article 14 (Observation générale n° 3, précitée, § 17) (§ 11.5). Par ailleurs, les programmes de réparations collectives et administratives ne peuvent pas rendre ineffectif le droit individuel à un recours et à obtenir réparation (Ibid., § 20) et les victimes doivent toujours avoir accès à des recours judiciaires (Ibid., § 30) (§ 11.6). Au surplus, le Comité indique que la réparation doit couvrir l’ensemble du préjudice subi et englober la restitution, l’indemnisation et les garanties de non-répétition, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas (Comité contre la torture, constatations du 8 novembre 2013, Mounir Hammouche c. Algérie, communication n° 376/2009, U.N. doc. CAT/C/51/D/376/2009, § 6.7). Or, il se trouve, que des procédures civiles et pénales ainsi que des enquêtes administratives ont été engagées par l’Irlande. Par conséquent, le Comité considère que le droit à la vérité a généralement été garanti par le fonctionnement des Commissions d’enquête ainsi que par les programmes de réparation. Par conséquent, même si l’accès à la justice, est resté limité, cela n’a pas constitué une violation de l’article 14, lu conjointement avec l’article 16, de la Convention (§ 11.7).
Enfin, en dernier lieu, le Comité considère que les souffrances continues de la requérante n’ont pas constitué une violation par l’État partie des obligations qui lui incombent, depuis mai 2002, en vertu de l’article 16 de la Convention, pris isolément et de manière combinée avec les articles 12 à 14 de la Convention (Comité contre la torture, constatations du 21 novembre 2014, Déogratias Niyonzima c. Burundi, communication n° 514/2012, U.N. doc. CAT/C/53/D/514/2012, § 8.8.). Au surplus, la requérante n’établit pas que l’évaluation de ses allégations par les autorités aurait été arbitraire ou aurait représenté un déni de justice ou des erreurs de procédure manifestes (§ 11.8).
En somme, si le Comité a reconnu sa compétence ratione temporis lors de l’examen préliminaire, il considère toutefois que l’Irlande a pris un nombre conséquent de mesures et ne reconnaît pas de violations. Une position à laquelle s’opposent en tout point trois membres du Comité, Ana Racu, l’experte moldave, et Erdogan Iscan, l’expert turc, ainsi que Todd Buchwald, l’expert américain, qui ont estimé dans leurs opinions dissidentes respectives que l’État partie n’a pas mené une enquête approfondie et impartiale et que la responsabilité de l’État n’a pas été clairement déterminée.
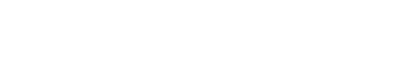

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
