Le titre de l’intervention telle qu’elle m’a été proposée postule l’existence d’un centre, d’un centre matériel et de destinataires primaires, qui se serait progressivement étendu. Si l’on se place du point de vue d’un juriste découvrant ce champ d’études, qui tenterait d’en dessiner le paysage à grands traits, on pourrait imaginer qu’il y verrait la personne humaine comme étant le destinataire « naturel » de la Déclaration et que cette personne se placerait dans le champ de l’État, lequel aurait un certain nombre d’obligations à son égard. Ce paysage ne serait pas erroné : le texte de la Déclaration a en effet été adopté par les États membres de l’Organisation des Nations unies et les droits déclarés concernent bien la personne humaine. De surcroît, le texte de la Déclaration fait plusieurs références à l’État[1].
Le croquis ainsi esquissé serait néanmoins largement incomplet. Le texte même de la Déclaration envisageait en effet ce paysage de manière plus riche ou, pour filer cette métaphore, envisageait la Déclaration comme un sol fécond : il prévoyait lui-même la possibilité d’une dynamique et il serait sans doute juste de dire que ses rédacteurs l’espéraient.
Il faut en effet dès à présent se tourner vers la clause finale du préambule, laquelle présente la Déclaration comme :
« l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés (…) ».
On peut y voir une véritable explicitation de la méthode par laquelle parvenir au développement du respect des droits et des libertés. Cette méthode suppose des rouages[2] et des acteurs. Force est de constater que l’État n’y est pas central, en tous cas certainement pas indépassable et c’est logiquement en cela que la Déclaration est universelle, pas simplement internationale. Dans son cours de 1951 à l’Académie de droit international de La Haye, consacré à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la mise en œuvre des droits de l’homme, René Cassin affirmait clairement deux idées qui éclairent la présente analyse. D’une part, il soutenait que « la Déclaration exclut délibérément le système d’après lequel la société dite internationale ne serait composée que d’États et ne comprendrait pas les êtres humains eux-mêmes ». D’autre part, René Cassin affirmait que « l’aspect universel de la Déclaration se révèle à ce qu’elle ne vise pas l’État comme le constant et seul débiteur de la protection des droits de l’homme. Elle n’a pas érigé en dogme le duo, et a fortiori, le duel, entre l’individu et l’État »[3].
Parmi les rédacteurs, la Déclaration était donc déjà pensée « au-delà de l’État ». Il ne s’agit pas que d’une formule. La lecture des travaux du Comité de Rédaction et de la Commission des droits de l’homme peut en effet laisser à penser que la clause finale du préambule était chargée d’attentes – à l’époque, le plus grand enjeu était la question coloniale, nous y reviendrons.
L’« élargissement » ne signifie pas, formellement, l’amendement du texte de la Déclaration, qui n’a pas changé au fil du temps. Il faut plutôt y voir ici une dynamique, notamment permise par une adjonction de traités. Ceux-ci ont contribué à la mise en œuvre progressive de la Déclaration et surtout à un enrichissement matériel des droits, en précisant par exemple certaines catégories de bénéficiaires. La soft law, avec plusieurs Déclarations importantes, a également nourri cette dynamique et ainsi permis certains élargissements.
Pour reprendre les termes très justes d’Alexandre Boza, historien, la Déclaration a permis « d’inscrire les droits de l’homme dans le patrimoine politique des sociétés » et surtout, d’en faire « une ressource pour l’action »[4]. Si l’on regarde l’évolution du droit international des droits humains ces soixante-quinze dernières années, il paraît juste d’affirmer qu’à compter de l’adoption de la Déclaration, la protection des droits de l’homme est devenue à la fois un discours et un processus institutionnalisé qui s’est affranchi des frontières de l’État-nation et a ainsi concrétisé l’ambition des rédacteurs.
Je vais ainsi revenir sur la Déclaration pensée et déployée « au-delà » de l’État et j’ai pour cela choisi quelques axes qui m’apparaissent illustratifs de la vitalité de la Déclaration, de la manière dont elle a pu constituer une ressource pour les peuples (I) et un horizon pour « tous les organes de la société » (II).
I. Une ressource pour « tous les peuples »
Mobilisés tant dans les mouvements de décolonisation (A) que plus récemment, dans le contexte de la quête de reconnaissance de droits pour les peuples autochtones (B), la Déclaration universelle des droits de l’homme et son langage ont pu constituer un outil dans différentes luttes d’émancipation.
A. Une déclaration pour les peuples colonisés[5]
La Déclaration ne reconnaît pas de droit à l’auto-détermination. On ne saurait pour autant en déduire que ce sujet fut absent des débats des rédacteurs. Il fut en effet notamment débattu au moment de la rédaction du préambule de la Déclaration et plus particulièrement de sa clause finale.
Alors que le représentant de l’URSS, Alexei Pavlov, envisageait de faire une référence expresse aux peuples sous tutelle[6], son homologue français, M. Ordonneau, avait rétorqué que le terme « universel » les incluait nécessairement. Estimant cependant que cette inclusion était loin d’aller de soi, M. Pavlov insista pour inscrire une référence explicite au terme « colonial » ou « sous tutelle » dans le préambule. Cette approche fut suivie, dans son esprit, par les représentants de l’Uruguay[7] et de l’Égypte[8]. De son côté, la représentante des États-Unis, Eleanor Roosevelt, exprimait ses craintes que l’inscription des territoires non autonomes dans la Déclaration leur confère un caractère permanent, raison pour laquelle elle préférait une référence générique à « tous les peuples »[9]. La formule finalement adoptée fut issue de la proposition chinoise. Elle ne fit mention que du seul mot « peuples » après les mots « toutes les nations »[10], ce qui permettait d’apaiser les craintes exprimées par Eleanor Roosevelt et de ne pas brusquer les agendas politiques occidentaux encore si frileux à l’égard de cette question.
Un saisissement du texte de la Déclaration par des peuples était ainsi possible, renforcé par le second paragraphe de l’article 2[11]. Il faut bien sûr se garder de l’idée selon laquelle l’autodétermination était un concept figé ou un projet aux inspirations et aux conséquences politiques univoques : comme cela a déjà pu être souligné[12], l’invocation d’un droit des peuples à l’autodétermination ne se résumait pas à la volonté d’accéder à la qualité d’État.
On peut toutefois observer que la Déclaration universelle a été mobilisée dans plusieurs instruments déclaratoires puis conventionnels en lien avec l’autonomie des peuples sous domination coloniale. Les non-alignés ont puisé dans la Déclaration un ressort pour leur propre doctrine, la mentionnant par exemple explicitement dans le Communiqué final de la Conférence de Bandung[13]. L’influence de Charles Malik, l’un des rédacteurs de la Déclaration universelle, lors de la Conférence de Bandung où il s’était rendu pour y représenter le Liban, a par ailleurs été mise en évidence[14]. Ensuite, on a retrouvé un appel au respect de la Déclaration universelle au paragraphe 7 de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du 14 décembre 1960[15], même s’il est vrai que la domination des peuples y fut comme étant contraire à la Charte des Nations Unies (premier paragraphe de la Résolution 1514). La Déclaration universelle des droits de l’homme tout comme la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux furent par suite toutes deux mobilisées dans le préambule de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965. Les deux pactes furent (enfin) adoptés l’année suivante et renferment tous deux un article 1 dont le premier alinéa énonce que « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes (…) »[16].
On observe ainsi, sans rentrer dans le détail des influences de tel État ou groupe d’États dans le jeu diplomatique, une continuité certaine de la mobilisation de la Déclaration dans plusieurs instruments successifs du droit international, jusqu’à l’affirmation d’un droit conventionnel des peuples à l’autodétermination. On peut sans doute y voir une marque de la « force créatrice » des peuples dans la dynamique du droit international, mise en évidence à cette même époque par Charles Chaumont[17].
Cette force créatrice s’illustre dans un autre cas de figure, celui des peuples autochtones.
B. Une déclaration pour les peuples autochtones
La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones[18] a été adoptée près de soixante ans après la Déclaration universelle. Elle accorde aux peuples autochtones du monde entier les droits qui furent reconnus par cette dernière, à laquelle renvoie immédiatement son article premier :
« Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme. »
Deux décennies ont été nécessaires à l’élaboration et l’adoption de cette résolution. Quatre États sur le territoire desquels sont implantées plusieurs communautés de populations autochtones, l’Australie, le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, ont toutefois voté contre[19]. A ce jour il n’y a guère de consensus international autour d’une nécessaire reconnaissance de droits à ces peuples dans un instrument conventionnel dédié, d’ambition universelle. La question fait toutefois son chemin, y compris au sein des États initialement les plus réticents, comme l’Australie.
Le vote négatif de l’Australie fit rapidement l’objet d’un désaveu politique par le gouvernement travailliste australien institué deux ans plus tard, qui appela à la soutenir. Dans le prolongement de ce soutien, quoique près de 15 ans plus tard, l’actuel gouvernement du premier ministre travailliste, Anthony Albanese, a proposé au peuple australien le référendum d’octobre 2023, appelé « Voice ». Celui-ci visait d’une part à reconnaître dans la Constitution les populations aborigènes et insulaires du détroit de Torres (lesquelles représentent 3,5% de la population australienne totale) comme peuples premiers d’Australie et d’autre part à mettre en place un organisme, la Voix aborigène, destiné à informer le parlement des incidences sur les aborigènes des politiques publiques les concernant. En dépit du soutien actif de certaines institutions, telles que la Commission australienne des droits de l’homme qui soutenait de longue date la reconnaissance de droits au peuple aborigène et du Détroit de Torres[20], le « non » l’a emporté à 60%. Plusieurs analyses ont toutefois démontré que des causes institutionnelles (condition de double majorité requise pour réviser la Constitution fédérale – au vote populaire et parmi les États) et politiques (le slogan de l’opposition, « if you don’t know, vote no », pour le moins réducteur) ont éclipsé un soutien populaire qui serait néanmoins plus solide qu’il n’y parut[21]. De récents développements concernant les peuples originels[22] témoignent de ce que la cause continue de « cristalliser », pour reprendre les termes de la thèse de Luc Leriche, un régime international de protection des expressions culturelles traditionnelles autochtones[23].
Ainsi mobilisée par les peuples colonisés et, plus récemment et plus indirectement, en défense de la reconnaissance de droits aux peuples autochtones, la Déclaration universelle Déclaration a donc témoigné d’une certaine vitalité malgré son grand âge. Le second versant de la clause finale de son préambule énonce le développement des droits, qu’elle remet entre les mains de « tous les individus » et de « tous les organes de la société ».
II. Un horizon pour « tous les individus et tous les organes de la société »
Si « tous les individus » sont chargés par la Déclaration de développer les droits fondamentaux, il faut ici souligner l’engagement de certains qui en font parfois le projet d’une vie, quitte à la mettre en péril. Il s’agit bien sûr des défenseurs des droits humains (A). Le développement des droits est aussi une cause soutenue par certaines organisations, aux dénominations et structures juridiques diverses, constituant autant « d’organes de la société » (B).
A. Le rôle essentiel joué par les défenseurs des droits humains
La Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme[24] a été adoptée dans le contexte du cinquantenaire de la Déclaration universelle, le 9 décembre 1998, après quatorze années de négociations pour ce sujet sensible. Son nom officiel fait une référence indirecte à l’aspect de la Déclaration universelle que nous étudions ici : « Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus »[25]. Une référence directe à la Déclaration universelle figure par ailleurs dans son préambule.
Au-delà de la définition large qu’elle donne à la notion de défenseurs des droits, relevons que cette déclaration met en garde contre tout risque de « privatisation » de la protection des droits humains, puisqu’elle rappelle dans son préambule que « c’est à l’État qu’incombent la responsabilité première et le devoir de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales ». On peut observer ici une précision de la dynamique, de la méthode contenue dans la clause finale de la Déclaration universelle : l’État n’est pas le seul débiteur de la protection des droits mais il en est le premier responsable. Cette précision importante trouve certainement à s’expliquer par une inquiétude portée à divers désengagements politiques, économiques et sociaux de l’État dans les années 1990.
Plus récemment, en 2022, la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains, Mary Lawlor, a publié un rapport sur les 25 années écoulées, intitulé « Persévérance et solidarité : les clés de 25 ans de réussite en matière de défense des humains »[26]. Le rapport vise à mettre l’accent sur les bons résultats obtenus par les défenseurs des droits humains, une orientation nouvelle qu’elle juge essentielle afin « de contrecarrer les projets des mouvements anti-droits et des gouvernements qui tentent de dépeindre les défenseurs et défenseuses des droits humains comme des personnes antipatriotiques opposées au développement, voire comme des traîtres, des criminels et des terroristes » (§ 5).
B. Les efforts portés par des « organes de la société »
Il est possible de s’arrêter brièvement sur les termes choisis par les rédacteurs de la Déclaration pour désigner tous les « organes de la société » : il s’agit d’une formule proposée par le gouvernement britannique, qui ne paraît relever, à la différence du choix du mot « peuple », aucun agenda politique particulier[27].
Néanmoins, la notion « d’organe de la société » paraît a posteriori particulièrement féconde puisqu’elle a permis de faire référence, au moins implicitement aux organisations non gouvernementales de défense des droits humains, aux syndicats, aux institutions nationales de protection des droits humains et même aux entreprises.
Les organisations non gouvernementales (ci-après « ONG ») ont été expressément consacrées par la Déclaration du 9 décembre 1998 précitée sur les défenseurs des droits de l’homme et elles ont obtenu un certain nombre de reconnaissances institutionnelles. On peut par exemple mentionner leur rôle décisif joué pendant la Conférence mondiale pour les droits de l’homme, tenue à Vienne en 1993. On peut également et remarquer la possibilité offerte aux ONG dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies[28] de participer aux sessions du Conseil des droits de l’homme en qualité d’observateurs. Cette possibilité leur permet notamment de faire une déclaration orale au Conseil des droits de l’homme, de participer aux débats ou encore d’organiser des manifestations parallèles sur les questions liées aux travaux du Conseil.
Il est probable que l’action des syndicats dans le développement des droits humains au plan international soit moins connue du grand public que celle des ONG. On peut toutefois relever qu’en juin 1948, soit quelques mois avant l’adoption de la Déclaration universelle qui fait référence en son article 23 au droit au travail et à la liberté syndicale, avait été adoptée la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. L’article 8 § 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 renvoie explicitement à cette Convention n° 87, qui joue le rôle de standard minimum en matière de protection des droits syndicaux. Dans la logique d’une responsabilité « collective » pour le développement des droits, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a eu l’occasion d’affirmer, concernant les droits des travailleurs, que si « seuls des États sont parties au Pacte, les entreprises, les syndicats et tous les membres de la société ont des responsabilités à assumer en ce qui concerne la réalisation du droit des travailleurs de jouir de conditions de travail justes et favorables. Ces responsabilités sont particulièrement importantes dans le cas de la sécurité et de la santé au travail (…) »[29].
Les institutions nationales de protection des droits de l’homme (ci-après « INDH »), dont Magali Lafourcade vient de parler en développant la pratique de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, font évidemment également partie des « organes de la société ». La Conférence mondiale sur les droits de l’homme précitée, tenue à Vienne en 1993, en a encouragé la création d’institutions nationales et le renforcement des institutions existantes, en tenant compte de principes particuliers, dits « Principes de Paris » approuvés par l’Assemblée générale des Nations unies[30].
On pourra enfin évoquer le rôle joué par les entreprises, en remarquant ici comme celles-ci ont progressivement quitté les habits d’« organes non-étatiques » et sont devenues identifiées en tant que telles comme organes de la société. Leurs responsabilités sont progressivement reconnues, d’abord par le prisme de la soft law avec les principes adoptés par le Conseil des droits de l’homme en 2011[31], dits « principes John Ruggie »[32], et depuis 2014 avec le projet d’instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme[33].
***
Le « paysage » des droits et libertés que la Déclaration universelle des droits de l’homme a contribué à façonner ces soixante-quinze dernières années s’avère ainsi indéniablement riche et dense. Au terme de cet exposé nécessairement sélectif, pour cadrer avec le format de nos échanges, j’espère surtout avoir démontré qu’en fait d’« élargissement », la Déclaration a suivi la trajectoire espérée par ses rédactrices et rédacteurs, qui avaient pour cela pris soin d’en consigner une méthode dans la clause finale du préambule.
Puisque nous fêtons un anniversaire, Madame la présidente, je me permets de formuler un vœu. Ce matin, dans son témoignage sur le président Cassin, Madame Questiaux soulignait comme celui-ci s’était entouré de juristes jeunes, en qui il avait placé sa confiance. Dans soixante-quinze ans, en 2098, la plupart d’entre nous ne serons pas là pour fêter les 150 ans de la Déclaration. Je fais donc aujourd’hui le vœu que les « générations futures », comme nous les désignons dans le langage juridique contemporain, que ces générations à venir, parmi lesquelles grandiront les esprits et les acteurs de demain, continuent sans faiblir de cultiver ce champ fécond que constitue la Déclaration.
[1] Préambule ; article 13 ; article 16 ; article 30.
[2] Notamment « l’enseignement et l’éducation », voir la contribution de Kishore SINGH, « La portée du droit à l’éducation et la formation aux droits de l’homme » à la présente journée.
[3] René CASSIN, « La déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme » (vol. 79), Recueil des cours de l’Académie de La Haye, pp. 43-44.
[4] Alexandre BOZA, « L’institutionnalisation paradoxale des droits de l’Homme en 1948 », in Valentine ZUBER, Emmanuel DECAUX et Alexandre BOZA (dir.), Histoire et postérité de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, Presses universitaires de Rennes, 2022, spéc. pp 51-59.
[5] Pour une analyse des rapports entretenus entre les mouvements de décolonisation et le droit international des droits humains, voir notamment René DEGNI-SEGUI, « La Déclaration universelle et la décolonisation », in La Déclaration universelle des droits de l’homme 1948-98, Actes du colloque des 14, 15 et 16 septembre 1998, La Sorbonne, La Documentation française, 1999, Paris ; Roland BURKE, Decolonization and the Evolution of International Human Rights, University of Pennsylvania Press, 1st ed. 2010, 240 p. ; Steven JENSEN, The making of international human rights : the 1960s, decolonization, and the reconstruction of global values, Cambridge University Press, 2016, 326 p. ; voir aussi l’analyse décoloniale de Nelson MALDONANO-TORRES, “On the Coloniality of Human Rights”, Revista Crítica de Ciências Sociais, vol. 114, 2017, pp. 117-136 ; ou plus récemment Brad SIMPSON, « Self-determination and decolonization », in Andrew Stuart THOMPSON and Martin THOMAS (dir.), The Oxford Handbook of the Ends of Empire, 2018, Oxford University Press, pp. 417-435.
[6] E/CN.4/SR.78, p. 7.
[7] E/CN.4/SR.78, p. 8 : référence à « toutes les Nations, indépendantes ou non autonomes ».
[8] E/CN.4/SR.78, p. 8 : « … à la fois parmi les populations des États membres eux-mêmes, que parmi les populations des territoires qu’ils administrent ».
[9] E/CN.4/SR.78, p. 10 : « En ce qui concerne la proposition de l’URSS, elle l’estime déplacée dans un Préambule, l’on peut dire en outre qu’un document comme la Déclaration ne doit pas attribuer un caractère permanent au statut des territoires non autonomes, il conviendrait donc d’employer l’expression « tous les peuples » ».
[10] E/CN.4/SR.78, p. 7.
[11] « 2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. » Sur cette clause, voir la contribution de William SCHABAS à la présente journée.
[12] Brad SIMPSON, « Self-determination and decolonization », in Andrew STUART THOMPSON and Martin THOMAS (dir.), The Oxford Handbook of the Ends of Empire, 2018, Oxford University Press, pp. 417-435.
[13] Tout en affirmant que « la culture asiatique et africaine est basée sur des fondements spirituels universels », le communiqué final, adopté le 24 avril 1955, consacre une section entière aux droits de l’homme, au même titre que la coopération économique et la coopération culturelle :
« 1. La Conférence afro-asiatique déclare appuyer totalement les principes fondamentaux des droits de l’homme tels qu’ils sont définis dans la Charte des Nations Unies et prendre en considération la Déclaration universelle des Droits de l’Homme comme un but commun vers lequel doivent tendre tous les peuples et toutes les Nations.
La Conférence déclare appuyer totalement le principe du droit des peuples et des Nations à disposer d’eux-mêmes tel qu’il est défini dans la Charte des Nations Unies et prendre en considération les résolutions des Nations Unies sur le droit des peuples et des Nations à disposer d’eux-mêmes, qui est la condition préalable à la jouissance totale de tous les droits fondamentaux de l’homme » (nous soulignons).
[14] Roland BURKE, Decolonization and the Evolution of International Human Rights, University of Pennsylvania Press, 1st ed. 2010, 240 p., spéc. pp. 21-22.
[15] Résolution 1514(XV) de l’Assemblée générale des Nations unies.
2 Tous les peuples ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel »
[16] En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».
[17] Charles CHAUMONT « Recherche du contenu irréductible du concept de souveraineté internationale de l’État », Hommage d’une génération des juristes au Président Basdevant, Paris, Pedone, 1960, pp. 114-151 spéc. p. 149 : « Il n’y a donc aucun principe spécial et indépendant qui puisse fournir la base juridique d’une souveraineté potentielle à une minorité nationale, si ce n’est la prise en considération des droits et des aspirations des personnes individuelles, c’est-à-dire du support psychologique et subjectif de toute activité sociale. Et c’est ici qu’en fin de compte le problème du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et par lui celui de la souveraineté, rejoignent le problème de la protection des droits et libertés fondamentales de l’homme ».
[18] AGNU, Résolution 61/295, 13 septembre 2007.
[19] Onze abstentions : Colombie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Géorgie, Burundi, Fédération de Russie, Samoa, Nigéria, Ukraine, Bhoutan et Kenya.
[20] La Commission se réfère indifféremment et extensivement à une pluralité de dénominations (« Peuples aborigènes » « peuples insulaires du détroit de Torres », « peuples des premières nations », « peuples indigènes », « propriétaires traditionnels ») aux populations concernées et à leurs membres la liberté de s’identifier comme ils l’entendent.
[21] Zérah BREMOND, « Australie : les peuples autochtones réduits au silence ? Réflexions sur les suites du référendum constitutionnel manqué du 14 octobre 2023 », Questions constitutionnelles, 3 décembre 2023. L’auteur souligne ainsi que « 5,51 millions d’Australiens [ont] voté oui, ce qui constitue un soutien supérieur à celui obtenu par n’importe quel autre parti politique australien aux élections générales ».
[22] Voir les développements de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples concernant l’expulsion de la communauté Ogiek de la forêt de Mau au Kenya, la Cour ayant interprété l’article 14 de la Charte africaine (droit de propriété) à la lumière de l’article 26 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (droit aux terres), Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya, n° 006/2012, 26 mai 2017, spéc. §§ 125-127. Voir également l’arrêt rendu par cette même Cour, dans cette même affaire, sur les réparations, 23 juin 2022, spéc. § 39. Voir la communication tranchée par le Comité des droits de l’homme, Daniel Billy et autres c. Australie, 21 juillet 2022, n° 3624/2019 et spécialement le raisonnement tenu sur le fondement de l’article 27 du Pacte (droit de jouir de sa propre culture), interprété en mobilisant la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, § 8.13, et le commentaire y relatif de Nadia SEQAT dans le présent numéro de cette revue [https://www.crdh.fr?p=7200].
[23] Luc LERICHE, L’émergence d’un droit à la vie autochtone, École de droit de la Sorbonne (dir. Jean Matringe), soutenue le 6 décembre 2022, 699 p., spéc. p. 390 et s.
[24] AGNU, Résolution 53/144 adoptée par consensus, « Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus ».
[25] Nous soulignons.
[26] A/HRC/52/29.
[27] Dans la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, il est fait référence à « tous les membres du corps social ». Le gouvernement français avait proposé « tous les membres de la société universelle » (2e session du Comité de Rédaction, Communication reçue du gouvernement français, 6 mai 1948, E/CN.4/82/Add.8). Le terme « organes de la société » est apparu dans les travaux de la Commission des droits de l’homme peu après, par la proposition du gouvernement du Royaume-Uni (3e session de la Commission des droits de l’homme, Projet de préambule à la Déclaration, Royaume-Uni, 10 juin 1948, E/CN.4/124) et a également été proposé quelques jours plus tard par le Liban (3e session de la Commission des droits de l’homme, Projet de préambule à la Déclaration, Liban, 14 juin 1948, E/CN.4/132), avant d’être repris dans la proposition du Comité du préambule, composé du bureau de la Commission des droits de l’homme (3e session de la Commission des droits de l’homme, Proposition du Comité du préambule, composé du Bureau de la Commission des droits de l’homme, 15 juin 1948, E/CN.4/138).
[28] ECOSOC, Résolution 1996/31 Relations aux fins de consultations entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, 25 juillet 1996.
[29] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), E/C.12/GC/23, § 74.
[30] Résolution 48/134, 20 décembre 1993.
[31] Conseil des droits de l’homme des Nations unies, Résolution 17/4, 16 juin 2011.
[32] Représentant spécial du Secrétaire général sur les droits de l’homme et les sociétés transnationales et autres entreprises, le Professeur John Ruggie a élaboré le cadre de référence et les principes applicables en la matière.
[33] Conseil des droits de l’homme des Nations unies, Résolution 26/9, 26 juin 2014.
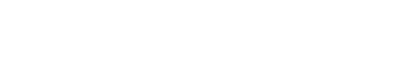

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
