Les vues exprimées dans le présent article n’engagent que l’auteur et en rien l’Organisation des Nations Unies, ni la Commission d’enquête sur le Burundi.
I. Introduction
La Commission d’enquête sur le Burundi a été créée par la résolution 33/24 du Conseil des droits de l’homme, en date du 30 septembre 2016, afin de mener une enquête approfondie sur les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits commises au Burundi depuis avril 2015, et d’identifier les auteurs présumés de ces actes. Son mandat a été renouvelé à quatre reprises, d’année en année, par la résolution 36/19 (adoptée le 4 octobre 2017), la résolution 39/14 (adoptée le 28 septembre 2018), la résolution 42/26 (adoptée le 24 septembre 2019) et la résolution 45/19 (adoptée le 6 octobre 2020) du Conseil des droits de l’homme. Dans les quatre rapports qu’elle a présenté devant le Conseil des droits de l’homme[1], la Commission d’enquête a conclu qu’elle avait des motifs raisonnables de croire[2] que l’État burundais était responsable des violations graves des droits de l’homme commises par ses agents – membres du Service national de renseignement (SNR), de la police et dans une moindre mesure de l’armée. La Commission a en particulier documenté de nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, d’arrestations et de détentions arbitraires, de tortures et d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que des violences sexuelles, commis par ces agents.
La Commission d’enquête a également réuni des informations fiables et concordantes auprès d’un grand nombre de victimes[3] sur le même type d’actes dont les auteurs ne sont pas des agents étatiques mais des Imbonerakure. Les Imbonerakure, dont le nom signifie en kirundi « ceux qui voient loin », forment la ligue des jeunes du Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD), parti au pouvoir depuis 2005 au Burundi. Le CNDD-FDD n’est pas le seul parti politique au Burundi à disposer d’une formation de jeunes militants dont, officiellement, les membres sont âgés de 18 à 35 ans. Toutefois, à travers les investigations qu’elle a menées, notamment en interrogeant d’anciens membres des Imbonerakure et du CNDD-FDD, la Commission d’enquête a mis à jour une organisation dont les fonctions et les tâches de plusieurs de ses membres outrepassent les simples activités militantes. Dès 2008, plusieurs rapports avaient déjà fait état de l’implication d’Imbonerakure dans la commission d’actes contraires aux droits de l’homme, en particulier durant les périodes pré-électorales[4]. À partir de 2014, des informations ont également circulé sur l’entraînement militaire de certains Imbonerakure au Burundi et en République démocratique du Congo, ainsi que sur des distributions d’armes[5]. En 2016, le Comité contre la torture des Nations Unies s’est lui-aussi inquiété « d’informations concordantes révélant que [le] groupe [des Imbonerakure] […] aurait été armé et entraîné par les autorités de l’État partie et interviendrait en liaison avec la police et les membres du Service national de renseignement dans les arrestations ainsi que de manière autonome dans des actes de répression, et ce, en toute impunité »[6].
La Commission d’enquête a été en mesure de corroborer ces informations[7]. Elle a en outre constaté le rôle croissant joué depuis 2015 par les Imbonerakure dans un contexte général d’embrigadement de la population et de persécution des opposants politiques ou des personnes perçues comme tels[8]. Dans le cadre du référendum constitutionnel qui s’est tenu le 17 mai 2018, des Imbonerakure, agissant seuls ou en présence d’éléments des forces de l’ordre, ont commis des actes contraires aux droits de l’homme pour contrôler notamment si les Burundais en âge de voter s’étaient inscrits sur les listes électorales et si les personnes concernées s’étaient acquittées de leurs contributions pour les élections de 2020[9]. Le même contrôle exercé sur la population a pu être constaté durant le processus électoral ayant conduit à la tenue des élections présidentielle, législatives et communales du 20 mai 2020[10]. Des opérations de recrutement forcé au sein des Imbonerakure et/ou du CNDD-FDD ont également eu lieu, visant des membres de partis politiques d’opposition ou des personnes sans affiliation politique. Elles ont aussi donné lieu à des menaces, des arrestations arbitraires, des tortures et mauvais traitements, des exécutions sommaires, et des enlèvements[11]. Cet accroissement d’activités et la liberté plus grande qui est laissée aux Imbonerakure démontrent leur connivence avec les structures formelles et informelles de répression de l’État[12]. Des Imbonerakure participent aux « comités mixtes de sécurité humaine » créés par ordonnance en 2014[13], avec des représentants de l’administration et de la police, preuve d’une reconnaissance de leur rôle dans l’appareil sécuritaire[14]. Des Imbonerakure ont été utilisés, avec l’assentiment de l’administration locale, comme supplétifs ou en remplacement des forces de l’ordre, notamment à l’intérieur du pays où ces dernières sont moins présentes ; mais aussi près des frontières, en particulier celles avec le Rwanda voisin[15]. Des témoignages ont même souligné l’ascendant que certains Imbonerakure avaient sur la police, y compris lors d’opérations menées contre des opposants[16].
Face à ces informations, la Commission d’enquête s’est interrogée sur la responsabilité de l’État burundais pour les actes contraires aux droits de l’homme commis par les Imbonerakure[17]. S’agit-il de violations des droits de l’homme pour lesquelles l’État burundais peut être reconnu responsable ? En droit international des droits de l’homme, l’État est tenu à une triple obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits de l’homme. Seules les deux premières obligations sont pertinentes dans le cas qui intéressait la Commission d’enquête. L’obligation de respecter implique que les agents de l’État ou toute personne sous leur contrôle ne violent pas les droits de l’homme reconnus en vertu des conventions internationales auxquelles il est partie. L’État doit également garantir le respect des droits de l’homme dans la planification et la conduite des opérations menées par ses agents ou par toute personne ou entité sous son contrôle.
L’obligation de protéger impose pour sa part que l’État protège les individus de violations commises par des tiers. Pour ce faire, les individus doivent avoir leurs droits garantis et, à ce titre, pouvoir être en mesure d’en demander la mise en œuvre[18]. L’État est ainsi tenu de garantir l’existence d’un système judiciaire qui offre la possibilité d’un recours utile aux victimes. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise ainsi que par garantir, il est entendu que l’État s’engage à faire en sorte que « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles », et que « l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel » (article 2, par. 3 b et c du Pacte). Il s’agit ici d’obligations positives que le Comité des droits de l’homme a complété par celle pour l’État « d’exercer la diligence nécessaire pour prévenir et punir de tels actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, enquêter à leur sujet ou réparer le préjudice qui en résulte en sorte que lesdits actes sont imputables à l’État partie concerné »[19]. Dans le contexte du Burundi, la Commission d’enquête a conclu que l’État n’a pas satisfait à son obligation de protéger et de garantir les droits de l’homme de ses citoyens en laissant des Imbonerakure responsables d’actes contraires aux droits de l’homme impunis, notamment en ne diligentant pas des enquêtes ou en ne lançant pas des poursuites contre eux. En outre, en ne luttant pas contre l’impunité de manière active et en ne réformant pas en profondeur son système judiciaire, l’État burundais a favorisé la répétition des violations des droits de l’homme.
La Commission d’enquête aurait pu s’en tenir à ce constat et retenir la responsabilité de l’État burundais sur la seule base de l’obligation de protéger. Toutefois, si l’État manque à cette dernière, il n’est pas tenu directement responsable pour la violation commise, cette responsabilité pesant sur l’auteur de la violation. Il est en revanche responsable de ne pas avoir protégé de manière satisfaisante la victime, ni mis en œuvre les obligations positives qui découlent de l’obligation de protéger. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi jugé que lorsqu’un individu est soumis à une menace clairement identifiée, l’État doit prendre des mesures spécifiques de protection[20]. Même dans ce cas, l’État, s’il manque à son obligation, n’est pas tenu responsable pour la violation en elle-même, mais pour son manquement à protéger la victime. On le voit, la différence entre une responsabilité retenue au titre d’un manquement à l’obligation de respecter et celle prononcée sur la base d’un manquement à l’obligation de protéger est grande. Dans un cas, l’État engage sa responsabilité pour l’acte lui-même ; dans l’autre, il est tenu responsable pour sa passivité face à des actes commis par des tiers. Les implications morales et juridiques ne sont pas semblables. Elles ne sont pas non plus les mêmes s’agissant des réparations auxquelles les victimes peuvent prétendre[21].
Le présent article, suivant en cela le raisonnement de la Commission d’enquête, s’attache donc à examiner la question de l’attribution des actes des Imbonerakure à l’État burundais afin de montrer que ce dernier a manqué à son obligation de respecter les droits de l’homme au Burundi. Il a en outre pour objet de déterminer – toujours dans le sillage de la Commission – que la responsabilité de l’État burundais peut être retenue non pas seulement au cas par cas, mais pour l’ensemble des actes contraires aux droits de l’homme commis par les Imbonerakure sur le territoire du Burundi.
II. Attribution à l’État burundais d’actes contraires aux droits de l’homme commis par des Imbonerakure : une attribution au cas par cas
Le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, tel que revu et adopté par la Commission du droit international en 2001, prévoit huit cas d’attribution à un État d’un comportement contraire au droit international. Les Imbonerakure ne rentrent pas dans le premier cas de figure qui couvre les agissements d’un organe de l’État. Le paragraphe 2 de l’article 4 du Projet d’articles définit en effet un « organe de l’État » comme « toute personne ou entité qui a ce statut d’après le droit interne de l’État ». Il est clair qu’aucun texte juridique burundais ne confère ce statut aux Imbonerakure. De la même manière, l’article 5 du Projet d’articles qui traite du « comportement d’une personne ou d’une entité exerçant des prérogatives de puissance publique » se limite clairement aux entités que le droit interne habilite à exercer cette puissance publique, comme cela est souligné dans le texte même de l’article et dans le commentaire qu’en a fait la Commission du droit international[22]. Encore une fois, les Imbonerakure n’ont jamais reçu une telle habilitation. Partant du même constat, les actes contraires aux droits de l’homme commis par les Imbonerakure ne peuvent pas être examinés sous l’angle de l’article 7 du Projet d’articles couvrant les cas d’« excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions » qui, selon les termes même de l’article, ne concernent que « le comportement d’un organe de État ou d’une personne ou entité habilitée à l’exercice des prérogatives de puissance publique ».
Les agissements des Imbonerakure ne peuvent pas non plus être examinés sous l’angle des articles 6, 9 et 10 du Projet d’articles qui traitent respectivement du « comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État », du comportement d’une entité non-étatique « en cas d’absence ou de carence des autorités officielles » et du comportement d’un « mouvement insurrectionnel ou autre » qui, soit devient le nouveau gouvernement de l’État, ou parvient à créer un nouvel État sur une partie du territoire d’un État préexistant ou sur un territoire sous son administration. On pourrait toutefois arguer que les Imbonerakure agissent, du moins dans certaines parties du territoire où les forces de l’ordre ne sont pas présentes, dans un contexte de carence de l’État. Or, le commentaire de la Commission du droit international sur l’article 9 insiste sur le « caractère exceptionnel des circonstances envisagées dans cet article » qui « ne surviennent que dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une révolution, un conflit armé ou une occupation étrangère au cours desquels les autorités régulières sont dissoutes, disparaissent, ont été supprimées ou sont temporairement inopérantes ». Ce n’est bien évidemment pas le cas du Burundi dont le gouvernement dispose de la pleine souveraineté sur son territoire. Cette précision est importante et fera l’objet de développements supplémentaires plus loin dans cet article.
A. Reconnaissance et adoption
Reste donc les deux circonstances envisagées par les articles 8 et 11 du Projet d’articles. L’article 11 – pour commencer par lui – prévoit qu’un comportement peut être « considéré comme un fait [d’un] État d’après le droit international si, et dans la mesure où, cet État reconnaît et adopte ledit comportement comme sien ». L’affaire, généralement citée y compris par la Commission du droit international dans son commentaire de l’article 9[23] afin d’illustrer la reconnaissance et l’adoption, est celle du Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran[24]. En l’espèce, la Cour internationale de Justice a reconnu la République islamique d’Iran responsable de la capture de l’ambassade des États-Unis à Téhéran le 4 novembre 1979, ainsi que de la détention de son personnel, sur deux bases juridiques distinctes. Dans un premier temps, suite à l’occupation spontanée de l’ambassade américaine par un groupe de militants, la responsabilité de l’Iran a été retenue pour ne pas avoir pris les mesures appropriées pour faire cesser cette occupation illégale alors que les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires exigent que l’État hôte protège les missions diplomatiques sur son sol. Appliqué à un contexte de violations des droits de l’homme, cela reviendrait à retenir la responsabilité de l’État sur la seule base de l’obligation de protéger et non sur celle de respecter. La Cour internationale de justice a considéré, toujours dans la même affaire, que le décret pris par l’ayatollah Khomeiny consistant à maintenir l’occupation de l’ambassade et la détention de son personnel afin de faire pression sur le Gouvernement des États-Unis, par la suite « appliquée par d’autres autorités iraniennes et appuyée par elles de façon réitérée dans des déclarations faites à diverses occasions […] a eu pour effet de transformer radicalement la nature juridique de la situation créée par l’occupation de l’ambassade et la détention de membres de son personnel diplomatique et consulaire en otages »[25]. Ce faisant, les autorités iraniennes ont non seulement reconnu officiellement, mais aussi adopté comme leurs l’occupation de l’ambassade américaine et la détention de son personnel, ces dernières leur étant dès lors directement imputables. Il est à noter que, comme le souligne la Commission du droit international dans son commentaire de l’article 11, « les conditions consistant à reconnaître et adopter sont cumulatives »[26].
Dans le cas du Burundi, la Commission d’enquête a retenu la responsabilité de l’État burundais sur la base de l’article 11 du Projet d’articles du fait des nombreux témoignages qu’elle a reçus selon lesquels les Imbonerakure ont procédé dans diverses localités du pays à des arrestations, puis remis les individus appréhendés à la police ou au SNR qui les ont acceptés et placés en détention. La Commission a également recueilli des informations faisant état d’Imbonerakure ayant commis des actes contraires aux droits de l’homme alors qu’ils portaient des uniformes et des armes de la police ou de l’armée, ce au vu et en présence de membres de ces corps. Dans ces deux cas de figure, les autorités burundaises ont adopté les agissements des Imbonerakure. S’agissant de la reconnaissance, elle n’a pas nécessairement besoin d’être orale. Dans son commentaire de l’article 11, la Commission du droit international met sur le même plan les cas où « l’État se contente de reconnaître l’existence factuelle du comportement » et ceux où il « exprime oralement son approbation »[27]. Pour elle, « quelle que soit la façon dont cette acceptation est exprimée […], l’expression reconnait et adopte à l’article 11 indique clairement que ce qui est exigé́ va au-delà̀ de la reconnaissance générale d’une situation de fait, il faut que l’État identifie et fasse sien le comportement en question »[28]. Pour la Commission d’enquête, ce niveau d’exigence est atteint au Burundi : l’État fait bien sien le comportement des Imbonerakure lorsqu’il place et maintient en détention des personnes, pour la plupart opposants avérés ou supposés au gouvernement, que les Imbonerakure ont arrêtées illégalement. De la même manière, en laissant certains Imbonerakure opérer avec des uniformes et des armes de la police ou de l’armée à la vue de membres de ces forces, les autorités burundaises reconnaissent et adoptent les violations des droits de l’homme que les Imbonerakure commettent dans ce contexte.
B. Instructions
L’article 8 du Projet d’articles prévoit que le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes peut être attribué à un État si cette personne ou ce groupe de personnes « agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État ». La jurisprudence internationale a depuis longtemps admis la responsabilité d’un État pour un comportement qu’il a autorisé́[29]. Peu importe en pareil cas le caractère de la personne incriminée, qu’elle ait le statut d’organe de l’État ou qu’elle soit privée. La nature du comportement n’a pas non plus d’importance, qu’il relève ou non d’une « activité publique », comme le relève la Commission du droit international dans son commentaire[30]. Cette dernière souligne que dans la plupart des cas, « il s’agit de situations où les organes de l’État complètent leur propre action en recrutant des personnes ou groupes de personnes privées à titre « d’auxiliaires », ou les incitent à agir à ce titre tout en restant en dehors des structures officielles de l’État. Il peut s’agir, par exemple, d’individus ou de groupes de personnes privées qui, bien que n’étant pas spécifiquement recrutés par l’État et ne faisant pas partie de la police ou des forces armées de celui-ci, sont employés comme auxiliaires […] »[31].
Au vu des informations qu’elle a reçues, la Commission d’enquête a considéré qu’en plusieurs circonstances, les agissements des Imbonerakure entraient dans ce dernier cas de figure. Elle a en effet recueilli de nombreux témoignages faisant état de liens étroits entre des membres, y compris haut placés, du SNR, de la police, de l’armée et de la Présidence de la République burundaise, d’une part, et certains Imbonerakure, d’autre part, ces derniers ayant reçu des premiers des instructions pour violer les droits de l’homme, notamment des ordres spécifiques de tuer certains opposants ou détracteurs. La Commission d’enquête a également documenté des cas précis d’Imbonerakure agissant sur instruction d’autres agents étatiques, en particulier des autorités locales au niveau des provinces. Elle a établi en outre que des Imbonerakure opéraient dans l’enceinte de prisons, comme celle de Mpimba à Bujumbura, ou dans des cachots de la police. Certains Imbonerakure présents dans les prisons assument les fonctions de « capita généraux » et, comme tels, sont chargés de la sécurité au sein de prisons.[32]
Dans les cas de figure applicables au Burundi et examinés jusqu’à maintenant – la reconnaissance et l’adoption ultérieures d’un agissement ou l’émission d’ordres destinés à diligenter cet agissement –, l’implication de État doit être démontrée au cas par cas pour que sa responsabilité soit retenue. La Commission d’enquête, ayant recueilli de nombreux témoignages faisant état de liens étroits entre les Imbonerakure et plusieurs échelons de l’État jusqu’aux plus hauts placés, a cherché à établir la responsabilité de l’État burundais non pas seulement dans des circonstances données, mais de manière générale.
III. Attribution à l’État burundais de l’ensemble des actes contraires aux droits de l’homme commis par les Imbonerakure : la question de l’existence d’un organe de fait
Cette question s’est posée dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua[33] où il s’agissait de savoir si le comportement des contras[34] était attribuable aux États-Unis au point de rendre ces derniers responsables d’une manière générale des violations du droit international humanitaire commises par les contras. Afin d’y répondre, la Cour internationale de Justice a distingué entre les cas où le groupe non-étatique incriminé constitue un organe de fait de l’État, c’est-à-dire agissant sous sa totale dépendance, et ceux où le groupe opère sous le contrôle de l’État. Dans la première hypothèse, l’ensemble des actes commis par ce groupe peut être imputable à l’État. Toutefois, comme l’a souligné la Cour[35], les cas de totale dépendance restent exceptionnels. Cette position a été réaffirmée dans un arrêt ultérieur prononcé dans l’affaire Application de la Convention pour la prévention du génocide[36]. Il faut en effet pouvoir démontrer d’une part une dépendance financière et logistique de l’entité incriminée par rapport à l’État, mais aussi un alignement systématique de cette entité sur les positions de l’État[37]. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, la Cour internationale de justice n’a pas retenu cette hypothèse, considérant que « malgré les subsides importants et les autres formes d’assistance que leur fournissent les États-Unis, il n’est pas clairement établi que ceux-ci exercent en fait sur les contras dans toutes leurs activités une autorité telle qu’on puisse considérer les contras comme agissant en leur nom »[38]. La Cour a donc considéré que « pour que la responsabilité juridique [des États-Unis] soit engagée, il devrait en principe être établi qu’ils avaient le contrôle effectif des opérations militaires ou paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient produites »[39]. On le voit, il s’agit encore une fois de démontrer la responsabilité de l’État au cas par cas.
Dans le contexte du Burundi, la Commission d’enquête a reçu des témoignages confirmant l’existence d’un groupe de « démobilisés », rejoint par la suite par des Imbonerakure, qui a été créé, entraîné militairement, armé et rémunéré à partir de 2006 par l’ancien Administrateur général du SNR, Adolphe Nshimirimana. Après l’assassinat de ce dernier en 2015, ce groupe a été complété par de nouveaux membres qui ont été sélectionnés et utilisés par des responsables du SNR, de la police et de l’armée pour mener des opérations, notamment des exécutions sommaires et des disparitions ciblées. Des témoignages ont également fait état de rémunérations reçues à titre de salaires ou versées une fois les forfaits accomplis. Sur la base de ces informations, la Commission a estimé que ce groupe, lorsqu’il mène des opérations sous la supervision d’agents étatiques, agit sous la dépendance totale de l’État burundais. Toutefois, ce groupe ne constitue qu’une portion des Imbonerakure. La question de la possibilité d’envisager la responsabilité de l’État pour l’ensemble des actes contraires aux droits de l’homme commis par les Imbonerakure reste donc posée. Ce type de responsabilité peut-il être envisagé sous l’angle du contrôle tel que prévu par l’article 8 du Projet d’articles ?[40]
IV. Attribution à l’État burundais de l’ensemble des actes contraires aux droits de l’homme commis par les Imbonerakure : la question du contrôle
A. « Contrôle effectif » ou « contrôle global » ?
L’article 8 du Projet d’articles ne définit pas la notion de contrôle. Comme on l’a vu, le texte de cette disposition se contente de distinguer les cas de « contrôle » de ceux où une personne ou un groupe de personnes agit sur les « instructions » ou sur les « directives » de l’État. La Commission du droit international le souligne dans son commentaire : « Dans le texte de l’article 8, les trois termes « instructions », « directives » et « contrôle » sont disjoints ; il suffit d’établir la réalité de l’un d’entre eux » [41]. Il est à noter cependant que le premier rapport de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État présenté par James Crawford en 1998 prévoyait de relier la notion de directive à celle de contrôle[42]. Cette approche qui n’a pas été retenue par la Commission en 2001 reflétait le point de vue de la Cour internationale de Justice dans l’arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. Dans cette affaire, la Cour internationale de justice a introduit la notion de contrôle effectif qui nécessite de démontrer non seulement la participation de l’État au financement, à l’équipement et l’entraînement du groupe non-étatique incriminé, ainsi qu’à l’organisation, la coordination, ou la planification des opérations menées par ce groupe ; mais aussi sa supervision et sa direction au cours de chacune des opérations. Ce faisant, la Cour a envisagé la notion de contrôle liée à celle de directive.
Une approche différente a été adoptée par la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) en 1997 dans l’arrêt Le Procureur c. Duško Tadić (alias « Dule »)[43]. En l’espèce, la Chambre d’appel entendait se prononcer sur la nature du conflit en Bosnie-Herzégovine après le retrait de la République fédérale de Yougoslavie en mai 1992. Pour répondre à cette question, les juges de la Chambre d’appel ont examiné les agissements de l’Armée de la République serbe de Bosnie afin de savoir si elle agissait sous le contrôle de la République fédérale de Yougoslavie. Dans l’affirmative, le conflit pouvait être caractérisé d’international. Le Tribunal de première instance avait invalidé cette hypothèse sur la base du test du « contrôle effectif » établi dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. Sans rejeter cette notion, la Chambre d’appel du TPIY a considéré que « la notion de contrôle effectif, proposé par la Cour internationale de Justice, comme critère unique et exclusif, ne s’accorde pas avec la pratique internationale judiciaire et étatique : cette dernière a conclu à la responsabilité de l’État dans des circonstances où le degré de contrôle exercé était inférieur à celui exigé dans l’arrêt Nicaragua […] elle a retenu le critère Nicaragua lorsqu’il s’agissait d’individus ou de groupes non organisés composés d’individus agissant au nom des États, mais a appliqué un autre critère dans le cas de groupes militaires ou paramilitaires »[44]. Cet autre critère est, selon les juges de la Chambre d’appel, celui du contrôle global.
La Chambre d’appel du TPIY base son argumentation notamment sur les arrêts rendus dans des affaires concernant des groupes ayant agi sur le territoire iranien après la révolution de 1979. On l’a vu, dans l’affaire Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, la Cour internationale de Justice a retenu la responsabilité de l’État iranien en vertu de l’article 11 du Projet d’articles, mais a considéré que les militants s’étant emparés de l’ambassade des États-Unis à Téhéran avaient agi spontanément, hors de tout contrôle de l’État[45]. Dans une autre affaire, Kenneth P. Yeager c. la République islamique d’Iran, le Tribunal des différends irano-américains a au contraire considéré que les « gardiens de la Révolution » ou « Komitehs révolutionnaires » qui avaient commis des actes illicites à l’encontre de citoyens américains étaient sous le contrôle de la République islamique d’Iran car « [n]ombre des partisans de l’ayatollah Khomeiny s’étaient organisés en comités révolutionnaires locaux, appelés Komitehs, souvent issus des « comités de quartier » formés avant la victoire de la Révolution. Ces Komitehs exerçaient les fonctions de forces de sécurité locales aux lendemains immédiats de la révolution. D’après certaines sources, ils procédaient à des arrestations, confiscations de biens et mises en détention de personnes »[46]. La Chambre d’appel du TPIY a souligné dans l’arrêt Tadic : « Manifestement, ces « gardiens » formaient des groupes armés organisés exerçant de fait des fonctions officielles. Ils différaient donc des militants iraniens qui avaient fait irruption dans l’Ambassade des États-Unis à Téhéran le 4 novembre 1979 »[47]. On le voit, deux cas de figure se détachent de l’analyse de la jurisprudence internationale par le TPIY. Dans le cas où des individus agissent seuls pour le compte d’un État ou lorsqu’il s’agit de groupes qui « ne sont pas organisés en structure militaire »[48], le test du « contrôle effectif » trouve à s’appliquer. Dans les autres cas, le TPIY note que « le contrôle exercé par un État sur des forces armées, des milices ou des unités paramilitaires subordonnées peut revêtir un caractère global (mais doit aller au-delà de la simple aide financière, fourniture d’équipements militaires ou formation). Cette condition ne va toutefois pas jusqu’à inclure l’émission d’ordres spécifiques par l’État ou sa direction de chaque opération »[49]. Par conséquent, le test du « contrôle global » introduit par le TPIY distingue bien entre la notion de contrôle et celle de directive.
L’approche du TPIY dans l’arrêt Tadic a été rejetée par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, jugée en 2007[50]. Outre le fait que la Cour remet en cause la légitimité du TPIY à se prononcer sur la responsabilité d’un État en droit international[51] ; sur le fond, elle note que « le critère du « contrôle global » présente le défaut majeur d’étendre le champ de la responsabilité des États bien au-delà du principe fondamental qui gouverne le droit de la responsabilité internationale, à savoir qu’un État n’est responsable que de son propre comportement, c’est-à-dire de celui des personnes qui, à quelque titre que ce soit, agissent en son nom. Tel est le cas des actes accomplis par ses organes officiels, et aussi par des personnes ou entités qui, bien que le droit interne de l’État ne les reconnaisse pas formellement comme tels, doivent être assimilés à des organes de l’État parce qu’ils se trouvent placés sous sa dépendance totale. En dehors de ces cas, les actes commis par des personnes ou groupes de personnes — qui ne sont ni des organes de l’État ni assimilables à de tels organes — ne peuvent engager la responsabilité de l’État que si ces actes, à supposer qu’ils soient internationalement illicites, lui sont attribuables en vertu de la norme de droit international coutumier reflétée dans l’article 8 précité […] Tel est le cas lorsqu’un organe de l’État a fourni les instructions, ou donné les directives, sur la base desquelles les auteurs de l’acte illicite ont agi ou lorsqu’il a exercé un contrôle effectif sur l’action au cours de laquelle l’illicéité a été commise »[52]. Il est intéressant de noter que dans ce dernier arrêt, la Cour internationale de Justice, en reprenant la notion de contrôle effectif qui associe la notion de directive à celle de contrôle, ne semble pas avoir pris en considération l’évolution du texte du Projet d’articles dont la version adoptée en 2001 disjoint, comme on l’a vu, les deux notions. Ce point mériterait de plus amples développements qui dépassent le cadre du présent article.
B. Les critères du test du « contrôle effectif »
Une fois le test du « contrôle effectif » admis se pose la question des critères à appliquer pour mener à bien ce test. L’arrêt rendu dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua est particulièrement éclairant à ce sujet. En l’espèce, la Cour internationale de Justice note que si elle ne dispose pas de preuves suffisantes pour parvenir à une conclusion sur le fait de savoir si le « Gouvernement des États-Unis a mis au point la stratégie et dirigé les tactiques des contras […] n’épuise […] pas la question de la responsabilité incombant aux États-Unis pour leur assistance aux contras »[53]. A contrario, on peut estimer que la participation de l’État à la mise au point de la stratégie du groupe et le fait qu’il ait dirigé la tactique du groupe non-étatique constitue un des éléments à considérer pour établir le contrôle de l’État sur le groupe incriminé. De la même manière, la Cour note que « la question de la sélection, de l’installation et de la rétribution des dirigeants de la force contra n’est qu’un aspect parmi d’autres du degré de dépendance de cette force »[54]. Il ne s’agit donc là aussi que d’un des éléments à prendre en considération pour établir l’existence d’un contrôle. La Cour souligne plus loin que d’autres critères doivent être examinés, « tels que l’organisation, l’entraînement, l’équipement de la force, la planification des opérations, le choix des objectifs et le soutien opérationnel fourni »[55]. Mais, une fois encore, ces éléments, s’ils sont importants, ne sont ni exhaustifs, ni déterminants. Le point crucial est, comme on l’a vu plus haut, de montrer que l’État a ordonné les agissements contraires au droit international. La Cour internationale de Justice a en effet estimé dans l’arrêt Nicaragua que « même prépondérante ou décisive, la participation des États-Unis à l’organisation, à la formation, à l’équipement, au financement et à l’approvisionnement des contras, à la sélection de leurs objectifs militaires ou paramilitaires et à la planification de toutes leurs opérations demeure insuffisante en elle-même […] pour que puissent être attribués aux États-Unis les actes commis par les contras au cours de leurs opérations militaires ou paramilitaires au Nicaragua. Toutes les modalités de participation des États-Unis qui viennent d’être mentionnées, et même le contrôle général exercé par eux sur une force extrêmement dépendante à leur égard, ne signifieraient pas par eux-mêmes, sans preuve complémentaire que les États-Unis aient ordonné ou imposé la perpétration des actes contraires aux droits de l’homme et au droit humanitaire allégués par 1’État demandeur »[56].
Dans l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour internationale de Justice s’accorde avec l’analyse des juges dans l’arrêt Nicaragua et, ce faisant, rejettent, comme on l’a vu, l’approche développée par la Chambre d’appel du TPIY dans l’arrêt Tadic. La Cour n’introduit pas de nouveaux critères à prendre en considération lorsqu’on applique le test du « contrôle effectif », mais se contente de rappeler que, contrairement à ce que prétendait le requérant dans le cas d’espèce, « il est nécessaire de démontrer que [le] « contrôle effectif » s’exerçait […] à l’occasion de chacune des opérations au cours desquelles les violations alléguées se seraient produites, et non pas en général, à l’égard de l’ensemble des actions menées par les personnes ou groupes de personnes ayant commis lesdites violations »[57].
Dans le contexte burundais, la Commission d’enquête a cherché à voir si les critères du test du contrôle effectif établis dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua étaient réunis. Elle s’est d’abord interrogée sur le rôle de l’État dans la planification et l’organisation des actes commis par les Imbonerakure. Sur ce point, la Commission a reçu des témoignages, y compris d’anciens agents étatiques et d’Imbonerakure, faisant état de réunions au niveau local entre des responsables du SNR, de la police, du parti au pouvoir et/ou des Imbonerakure, durant lesquelles ont été identifiées les personnes – pour la plupart opposants politiques ou susceptibles de contester la ligne du gouvernement et du CNDD-FDD – à appréhender ou à faire disparaître. Certains témoins ont mentionné l’existence de recensements visant à identifier les opposants en vue du référendum et des élections de 2020, voire même d’une opération auparavant connue sous le nom de « Safisha » (i.e. « nettoyer » en Kirundi) et aujourd’hui dénommée « Gutakara » (i.e. « se perdre » ou « tuer ») visant à éliminer ces opposants[58]. Poursuivant l’examen des critères du test du contrôle effectif, la Commission a pu en outre établir que des Imbonerakure ont agi, dans plusieurs cas, sous les ordres et la supervision d’agents étatiques[59]. Des témoignages ont, par ailleurs, fait mention de distribution, jusqu’en 2018, d’armes et/ou de matériel militaire à des Imbonerakure, y compris sous la supervision de haut-responsables de l’armée et de la police, ainsi que d’entraînements physiques et militaires d’Imbonerakure[60]. Plusieurs témoignages ont également souligné le fait qu’à de nombreuses occasions des Imbonerakure portaient des habits ou des bottines militaires et parfois étaient munis d’armes à feu[61]. Certains Imbonerakure ont aussi reçu des téléphones, des cartes SIM et des crédits téléphoniques afin de renseigner des responsables du CNDD-FDD et du SNR sur les activités d’opposants ou pour identifier parmi eux ceux qu’il s’agit d’appréhender[62]. Des groupes Whatsapp ont également été utilisés à cet effet.[63] Ces différentes informations attestent d’un niveau de contrôle de l’État burundais sur certains Imbonerakure qui peut être qualifié de « contrôle effectif » ; mais, comme on l’a déjà mentionné, ce type de contrôle reste à démontrer au cas par cas.
Cela étant dit, la Cour internationale de Justice a semblé introduire en 2008 un éclairage nouveau à la notion de contrôle. Dans l’affaire Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), elle a été amenée à rendre, le 15 octobre 2008, une ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Géorgie en vue de protéger les droits qu’elle tenait de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale afin « de protéger ses ressortissants des violences à caractère discriminatoire que leur inflige[aie]nt les forces armées russes opérant de concert avec les milices séparatistes et les mercenaires étrangers »[64]. Ce faisant, elle a notamment ordonné aux Parties en Ossétie du sud, en Abkhazie et dans les régions géorgiennes adjacentes de « faire tout ce qui [était] en leur pouvoir afin de garantir que les autorités et les institutions publiques se trouvant sous leur contrôle ou sous leur influence ne se livrent pas à des actes de discrimination raciale à l’encontre de personnes, groupes de personnes ou institutions »[65]. La Cour n’a cependant pas eu l’occasion d’expliquer par la suite dans un arrêt sur le fond la notion d’« influence » qu’elle ne définit pas dans son ordonnance.
Il est néanmoins permis de penser qu’elle se base sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette dernière a en effet considéré dans les affaires ayant traits à des violations commises en Transnistrie, en particulier dans les arrêts Ilascu et autres c. Moldavie et Russie, Catan et autres c. République de Moldova et Russie, Mozer c. République de Moldova et Russie de 2004, 2012 et 2016, que le degré élevé de dépendance de la République moldave de Transnistrie (RMT) à l’égard du soutien russe « constituait un élément solide permettant de considérer que la Fédération de Russie continuait d’exercer un contrôle effectif et une influence décisive sur les autorités transnistriennes »[66]. La notion de « contrôle effectif » est ici appliquée de manière souple par la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans les arrêts précités, utilise également à plusieurs reprises l’expression d’« autorité effective », en la confondant avec celle de « contrôle effectif »[67]. Ainsi, dans l’arrêt Ilascu et autres c. Moldavie et Russie, la Cour conclut que la « RMT », établie en 1991-1992 avec le soutien de la Fédération de Russie et dotée d’organes de pouvoir et d’une administration propres, continue à se trouver sous l’autorité effective, ou tout au moins sous l’influence décisive, de la Fédération de Russie » (par. 392). L’expression « ou tout au moins » laisse penser que l’« influence décisive » constitue un degré moindre de contrôle que celui exercé dans l’hypothèse d’un « contrôle effectif ». Les critères d’évaluation, aux yeux de la Cour européenne des droits de l’homme, n’en demeurent pas moins les mêmes dans les deux cas : il s’agit d’évaluer le soutien militaire, économique, financier, informationnel et politique apporté par l’État concerné à l’entité non-étatique ayant commis les violations. C’est sous cet angle que la Cour européenne des droits de l’homme a pu conclure que, sans le soutien de la Fédération de Russie, la République moldave de Transnistrie ne pourrait pas subsister. Le Comité des droits de l’homme semble avoir suivi la même logique en adoptant une approche liant la notion d’influence à celle de « contrôle effectif », notamment dans les observations finales concernant le septième rapport périodique de la Fédération de Russie. Dans ce texte, le Comité engage la Fédération de Russie « à assurer l’application du Pacte eu égard aux actes perpétrés par des groupes armés et par les autorités proclamées de la « République populaire de Donetsk », de la « République populaire de Lougansk » et de l’« Ossétie du Sud », autoproclamées, dans la mesure où l’influence qu’elle exerce sur ces groupes et ces autorités équivaut à un contrôle effectif de leurs activités »[68].
Dans toutes ces cas cependant, la question de la responsabilité a été examinée tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par le Comité des droits de l’homme sous l’angle de la juridiction[69] qui est différent de celui de l’attribution stricto sensu. Cet angle se comprend car les entités ayant commis des actes contraires aux droits de l’homme opéraient en dehors du territoire des États incriminés. Il s’agissait donc de démontrer d’une part la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme pour les juger et d’autre part celle du Comité pour les considérer. Dans le contexte du Burundi, la question de la juridiction ne se pose pas, les actes en question ayant été perpétrés par les Imbonerakure sur le territoire burundais. Il faut par conséquent en revenir à l’attribution.
C. La question du territoire
Pour ce faire, il convient de se tourner à nouveau vers la jurisprudence de la Cour internationale de Justice. Une fois encore, force est de constater que seules des cas d’extra-territorialité ont été examinés à ce jour par la Cour. Ainsi, dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, les contras opéraient sur un territoire autre que celui des États-Unis dont il s’agissait de déterminer la responsabilité. Dans cette perspective, la Cour internationale de Justice a voulu utiliser des critères stricts pour établir l’existence d’un contrôle et, ainsi, démontrer, en plus d’une assistance substantielle, l’existence d’ordres ou d’instructions précises en vue de la commission des agissements incriminés. Le fait qu’une entité opère hors du territoire de l’État dont la responsabilité doit être établie lui confère, de par la distance géographique et l’absence d’implantation de l’État sur le territoire concerné, une marge de manœuvre qui peut l’amener à commettre des actes contraires au droit international sans que l’État n’ait eu aucun pouvoir sur ces agissements, et alors même qu’au-delà de ces agissements, il fournit un soutien conséquent à l’entité en question.
Dans cette lignée, la Cour internationale de Justice, dans l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, a reproché au TPIY, en introduisant dans l’arrêt Tadic le test du « contrôle global » qui n’exige pas l’émission d’ordres ou d’instructions à l’occasion de chaque opération ou agissement, de distendre « trop, jusqu’à le rompre presque, le lien qui doit exister entre le comportement des organes de l’État et la responsabilité internationale de ce dernier »[70]. En l’espèce, l’Armée de la République serbe de Bosnie agissait, à l’instar des contras au Nicaragua, en dehors d’un territoire sur lequel la République fédérale de Yougoslavie exerçait sa souveraineté. De nombreux commentateurs de l’arrêt de la Cour internationale de justice ont noté que, si le test du « contrôle global » est moins exigeant que celui du « contrôle effectif », il n’en demeure pas moins élevé puisqu’il impose de démontrer le soutien logistique et financier apporté par l’État au groupe incriminé, en plus du rôle de l’État dans la planification des opérations. Au risque de se répéter, il ne s’agit pas toutefois dans le présent article de se prononcer sur le test à retenir entre le « contrôle global » et le « contrôle effectif ».
Le jugement du TPIY dans l’arrêt Tadic n’en présente pas moins l’intérêt de souligner que « le degré de contrôle requis peut […] varier selon les circonstances factuelles propres à chaque affaire […] le droit international ne saurait exiger dans tous les cas un contrôle très étroit. Il convient de distinguer plusieurs cas de figure »[71]. Ainsi, les juges du TPIY ont estimé : « Bien évidemment, si, comme dans l’affaire Nicaragua, l’État exerçant le contrôle n’est pas celui sur le territoire duquel les affrontements armés se produisent ou, en tout état de cause, celui où les unités armées commettent leurs actes, il faut davantage de preuves incontestables pour démontrer que l’État contrôle réellement les unités ou les groupes, dans la mesure où, non content de les financer et de les équiper, il dirige également leurs actions ou les aide à les planifier en général »[72]. Là encore, il ne s’agit pas de plaider pour le test du « contrôle global » au détriment de celui du « contrôle effectif », mais de prendre en considération l’argument avancé par le TPIY, à savoir que l’appréciation du contrôle ne sera pas la même si l’entité non-étatique agit sur le territoire de l’État dont la responsabilité est à démontrer, une hypothèse qu’à ce jour la jurisprudence internationale n’a eu que rarement l’occasion d’examiner.
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme, à l’instar de la Cour internationale de Justice, n’a eu à juger que d’affaires posant des questions de responsabilité extraterritoriale, en particulier s’agissant de violations commises dans le nord de Chypre ou, comme on l’a vu, en Transnistrie. De la même manière, la jurisprudence du Comité des droits de l’homme n’offre en majorité que des cas d’extra-territorialité[73]. En 2015, le Comité a eu toutefois à examiner des violations commises par des groupes dit « d’autodéfense » sur le territoire colombien. Dans ce cas, le Comité a retenu la responsabilité de l’État colombien pour les actes commis par ces groupes non pas en appliquant les critères du test du « contrôle effectif », mais ceux de la « totale dépendance », propre aux organes de fait. Le Comité note en effet que « l’État partie a encouragé la création des groupes dits « d’autodéfense », y compris dans un cadre légal, pour qu’ils aident les forces de l’ordre à combattre la rébellion, puis il les a entraînés, leur a procuré des armes et un appui logistique, et/ou a permis la participation active des forces armées à leurs opérations »[74]. Dans l’affaire Blake c. Guatemala jugée en 1998, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a également appliqué les critère de la « totale dépendance » afin de démontrer la responsabilité du Guatemala pour les actes commis par les « patrouilles civiles », dans la mesure où celles-ci avait été créées par décret ministériel, participaient à des activités en soutien des forces armées et sous leur supervision, recevaient des ordres directs de ces dernières, ainsi que des ressources, des armes, et des formations[75].
V. Le cas particulier d’une entité non-étatique agissant sur le territoire de l’État : pour un « contrôle effectif général »
Quoiqu’il en soit, l’État dispose dans le cadre de ses frontières de moyens qu’il n’a pas sur un territoire étranger. Il a tout d’abord à sa disposition un pouvoir législatif et règlementaire lui permettant de déclarer ce qui est licite et ce qui ne l’est pas, mais aussi d’établir le cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre de décisions politiques, ainsi que de politiques publiques. Au Burundi par exemple, en décembre 2017, le Gouvernement a décidé par voie d’ordonnance d’organiser la collecte d’une contribution pour les élections de 2020[76], un projet que le Chef de l’État avait appelé de ses vœux en mai 2017. C’est cette contribution dont la Commission d’enquête a pu établir, comme on l’a déjà mentionné, qu’elle était dans bien des cas perçue par les Imbonerakure, agissant seuls ou conjointement avec des membres de la police et du SNR, ce qui donnait lieu à des actes contraires aux droits de l’homme[77]. Sur son territoire, un État dispose également du pouvoir exécutif lui permettant de maintenir l’ordre public et d’utiliser, si besoin, la violence à cet effet. Cette fonction revient normalement à des forces de sécurité dont l’organisation et l’étendue des pouvoirs sont établies par la constitution ou la loi. La constitution burundaise prévoit ainsi l’existence de deux corps de défense et de sécurité : la « force de défense nationale » et la « police nationale », auxquelles il faut ajouter le SNR[78]. L’utilisation d’Imbonerakure à des fins sécuritaires pose donc la question du lien qu’ils entretiennent avec l’État burundais, alors même qu’ils n’ont reçu aucune habilitation officielle pour exercer des prérogatives de puissance publique. Enfin, l’État a sur son territoire les moyens judiciaires de punir les violations de la loi en poursuivant les auteurs de ces violations et s’assurant qu’une sanction est prononcée à leur encontre par un juge. L’impunité dont bénéficient la grande majorité des Imbonerakure[79] au Burundi questionne sur la latitude que l’État burundais leur laisse pour agir.
Toutefois, dans le contexte du Burundi où – faut-il le rappeler – l’État a la maîtrise du territoire national et sur lequel il a les moyens d’exercer son entière souveraineté, il ne s’agit pas d’établir la seule carence de l’État face au comportement des Imbonerakure. Cela reviendrait à nouveau à conclure au manquement de l’État à son obligation de protéger. L’objectif est de montrer que l’État a manqué à son obligation de respecter et, ce faisant, de lui imputer les actes commis par les Imbonerakure. L’intérêt néanmoins de souligner l’absence de réponse de l’État burundais face aux agissements des Imbonerakure est de voir comment, assortie d’un comportement positif de sa part, il contribue à définir un champ d’action dans le cadre duquel les Imbonerakure peuvent agir.
Vu sous l’angle de la carence de l’État, il est clair que l’État burundais n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les violations commises par les Imbonerakure. En particulier, il n’a pas appréhendé les Imbonerakure soupçonnés d’avoir commis des actes illégaux[80]. Son inaction dans ce domaine a été d’autant plus flagrante lorsque les Imbonerakure ont, comme de nombreux témoignages recueillis par la Commission d’enquête l’ont montré, agi en présence et au vu d’agents étatiques[81]. Dans la majorité des cas, l’État n’a pas non plus diligenté d’enquête contre les Imbonerakure, ni ne les a poursuivis[82]. Il n’a en d’autres termes ni utilisé son pouvoir exécutif ni son pouvoir judiciaire pour faire respecter la loi et l’ordre public et punir les agissements des Imbonerakure qui leur étaient contraires. La Commission a par ailleurs reçu des témoignages selon lesquels des Imbonerakure ont été détenus dans des cachots de l’État, non pas en raison des exactions qu’ils auraient commises, ni à l’issue d’une procédure judiciaire, mais à titre de sanctions disciplinaires internes[83]. Cet usage privatif de cellules relevant de l’autorité de l’État montre non seulement la collusion qui existe aujourd’hui entre les Imbonerakure et l’État burundais, mais également que des sanctions sont possibles contre les Imbonerakure et que, lorsqu’elles sont prises, ce n’est pas dans l’intérêt de la justice ni du bien commun, mais dans celui seul de l’État. L’État burundais, à travers ses agents, pourraient très bien appréhender et détenir les Imbonerakure qui se rendent coupables de violations des droits de l’homme, de la même manière qu’il permet à des Imbonerakure d’utiliser ses cachots pour sanctionner certains de leurs membres en les privant de liberté. L’impunité, dont les Imbonerakure jouissent au Burundi, apparaît, au vu de ces informations, comme tout sauf fortuite. Elle montre que l’État définit bien, à la fois de manière positive et négative, le champ d’action laissé aux Imbonerakure.
En outre, l’État burundais a, utilisé les Imbonerakure comme auxiliaires ou supplétifs dans un certain nombre de tâches allant du maintien de l’ordre public à l’identification, l’arrestation, et parfois l’élimination physique d’opposants politiques ou de personnes supposées tels. Les Imbonerakure ont également exercé des prérogatives de puissance publique, comme collecter des contributions qui constituent un impôt[84]. Ces éléments attestent, comme on l’a vu, d’une forme de contrôle qui renforcent l’idée que l’État burundais définit de manière positive le champ d’action dont bénéficient les Imbonerakure.
Il convient donc de s’interroger pour savoir si ce champ d’action défini à la fois en termes négatifs sous l’angle de l’inaction de l’État, et positifs sous celui de son action, ne constitue pas une forme de contrôle. C’est, semble-t-il, l’approche que le Tribunal des différends irano-américains a adopté dans sa décision Kenneth P. Yeager c. la République islamique d’Iran lorsqu’il a conclu que : « Le Défendeur [en l’occurrence la République islamique d’Iran] n’a pas […] fait la preuve que dans le cadre de cette opération [à savoir le fait de forcer des étrangers à quitter le pays], il ne pouvait contrôler les « Komitehs révolutionnaires » ou « gardiens de la Révolution ». Parce que le nouveau Gouvernement a accepté, en principe, leurs activités et leur rôle dans le maintien de l’ordre public, des appels à un surcroît de discipline, formulés dans des termes généraux plutôt que spécifiques, ne correspondent pas au degré de contrôle qui aurait permis d’empêcher effectivement ces groupes de commettre des actes répréhensibles contre des ressortissants des États-Unis »[85]. En tout état de cause, l’évidence d’un champ d’action, défini aussi bien positivement que négativement, à laquelle s’ajoutent les critères du « contrôle effectif », a permis à la Commission d’enquête de conclure à un contrôle effectif général de l’État burundais sur les Imbonerakure[86].
On le voit, l’effectivité du contrôle se déduit de l’existence des critères établis par la Cour internationale de Justice pour démontrer l’existence d’un « contrôle effectif ». Le caractère général du contrôle renvoie quant à lui à l’idée développée ici de champ d’action laissé à l’entité incriminée et défini à la fois négativement et positivement par l’État. L’existence d’un tel champ d’action permettant de conclure à un contrôle effectif général est propre aux situations où l’entité incriminée opère sur le territoire de l’État dont la responsabilité est à établir. Dans cette hypothèse, le contrôle, une fois son existence admise, n’aura pas à être démontré au cas par cas.
[1] A/HRC/36/54, A/HRC/39/63, A/HRC/42/49 et A/HRC/45/32.
[2] Ce niveau de preuve est celui qui a été retenu dans de nombreux cas par les commissions d’enquête des Nations Unies en matière de droits de l’homme (voir Commissions d’enquête et missions d’établissement des faits sur le droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire international : Orientations et pratiques, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 2015, p. 70, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_FR.pdf). Il est moins élevé que celui retenu par les tribunaux pour conclure à la culpabilité d’une personne ou établir la responsabilité d’un État, c’est-à-dire une absence « de tout doute raisonnable ». Il s’agit néanmoins du même niveau de preuve permettant par exemple à la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de délivrer, sur requête du Procureur, un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître à l’encontre d’une personne.
[3] La Commission d’enquête n’a pas eu accès au Burundi du fait du refus du gouvernement burundais de coopérer avec elle. En trois années d’existence, la Commission d’enquête a néanmoins réussi à conduire plus de mille entretiens avec des Burundais ayant fui le pays et réfugiés dans les pays voisins du Burundi (Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie) et en Belgique, ainsi qu’avec des Burundais restés dans le pays grâce à des moyens de communication sécurisés.
[4] Voir par exemple le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme et les activités du Haut-Commissariat au Burundi en date du 31 août 2009 (A/HRC/12/43).
[5] En avril 2014, un câble interne du Bureau des Nations Unies au Burundi adressé au siège des Nations Unies à New York a fuité dans la presse. Il faisait état d’armes et d’uniformes de l’armée et de la police qui auraient été distribués par deux généraux à des Imbonerakure et à des militaires démobilisés à Rumonge, dans le sud du pays (Câble interne du 3 avril 2014, intitulé : « Reports of alleged distribution of weapons to the Imbonerakure »). Plusieurs hauts-responsables, dont les deux Vice-Présidents, le Ministre de la sécurité publique et le Président du CNDD-FDD ont démenti ces allégations (Communiqué du Gouvernement du Burundi à la suite du rapport confidentiel adressé au Secrétaire général des Nations Unies par Monsieur Onanga-Anyanga, 16 avril 2014 – http://presidence.bi/spip.php?article4616).
[6] CAT/C/BDI/CO/2/Add.1, par. 14.
[7] Toutes les informations relatives au comportement des Imbonerakure auxquelles le présent article fait référence sont tirées des quatre rapports que la Commission d’enquête a présentés à ce jour au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/36/54, A/HRC/39/63, A/HRC/42/49, et A/HRC/45/32), tous accompagnés d’une version détaillée (A/HRC/36/CRP.1, A/HRC/39/CRP.1, A/HRC/42/CRP.2, et A/HRC/45/CRP.1) disponible sur la page internet de la Commission d’enquête :https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/hrc/coiburundi/pages/coiburundi.aspx.
[8] A/HRC/36/54, par. 23-27 ; A/HRC/39/63, par. 20-27; A/HRC/42/49, par. 25-26 ; A/HRC/45/32, par. 29.
[9] A/HRC/39/63, par. 20.
[10] A/HRC/39/63, par. 31-51.
[11] A/HRC/36/54, par. 14 ; A/HRC/39/63, par. 20 ; A/HRC/42/49, par. 21 et 51 ; A/HRC/45/32, par. 61.
[12] Cette connivence est également manifeste dans le fait que Sylvestre Ndayizeye, ancien responsable du département de renseignement intérieur du SNR et ancien gouverneur de la province de Karuzi, a été désigné en 2016 comme Secrétaire national du CNDD-FDD en charge de la gestion des ligues affiliées au parti.
[13] Ordonnance conjointe du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la sécurité publique n° 530/215/137/2014 portant cahier des charges des comités mixtes de sécurité humaine.
[14] En 2017, la Secrétaire exécutive chargée de la communication et de l’information du CNDD-FDD, Nancy-Ninette Mutoni, a reconnu ce rôle dans une réponse à des questions posées par l’ONG Human Rights Watch.
A/HRC/36/54, par. 34 et 58 ; A/HRC/39/63, par. 21 ; A/HRC/42/49, par. 25 ; A/HRC/45/32, par. 83.
[16] A/HRC/39/63, par. 21 ; A/HRC/42/49, par. 79.
[17] Cette question est de première importance pour toute commission d’enquête ou mission d’établissement des faits. Elle justifie que le personnel employé dans ce type de mécanisme ait non seulement des compétences en droits de l’homme et droit humanitaire, mais aussi en droit international public.
[18] Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 2 par. 1) précise à cet égard que ses États parties s’engagent non seulement « à respecter », mais aussi « à garantir » les droits qu’il contient « à tous les individus se trouvant sur leur territoire ».
[19] Comité des droits de l’homme, observation générale n° 31 sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, adoptée le 29 mars 2004 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13). Le Comité précise à cet égard qu’il « existe un lien entre les obligations positives découlant de l’article 2 et la nécessité de prévoir des recours utiles en cas de violation, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 » (par. 8 de l’observation générale).
[20] Cour européenne des droits de l’homme, Osman c. Royaume-Uni, arrêt, 28 octobre 1998 ; Cour européenne des droits de l’homme, Mahmut Kaya c. Turquie, 28 mars 2000 ; Cour européenne des droits de l’homme, Kiliç c. Turquie, arrêt, 28 mars 2000.
[21] À titre d’exemple, dans deux affaires contre la Turquie jugées par la Cour européenne des droits de l’homme, toutes les deux initiées par les épouses d’hommes qui auraient été tués par des agents de l’État turc, ce dernier n’a pas été condamné aux mêmes montants de dommages et intérêts selon que la Cour a reconnu dans un cas qu’il avait seulement failli à son obligation de protéger en ne diligentant pas une enquête efficace sur les circonstances de la mort de l’époux, et dans l’autre qu’il était directement responsable de la mort du mari de la requérante en violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans la première affaire, Tanrikulu c. Turquie (1999), la requérante a reçu 15 000 GBP au titre du préjudice moral. Dans la seconde, Akkoç c. Turquie (2000), la Turquie a été condamnée à verser 25 000 GBP au titre du préjudice moral subi par la requérante.
[22] Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, p. 99.
[23] Ibid., p. 128.
[24] Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, C.I.J., recueil 1980, p. 3.
[25] Ibid., par. 74.
[26] Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, p. 129.
[27] Ibid., p. 128.
[28] Ibid.
[29] Voir, par exemple, les affaires Zafiro, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI (1925), p. 160 ; Stephens, ibid., vol. IV (1927), p. 267 ; Lehigh Valley Railroad Company, and others (USA) v. Germany (Sabotage Cases) : incidents du « Black Tom » et du ́Kingslanda, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. VIII (1930), p. 84, et vol. VIII (1939), p. 458.
[30] Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, p. 110.
[31] Ibid.
[32] Pour plus de détails, voir : A/HRC/36/CRP.1, p. 65 ; A/HRC/39/CRP.1, p. 83, et A/HRC/42/CRP. 2, p. 45.
[33] Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, C.I.J. Recueil 1986, p. 14.
[34] Les contras (terme espagnol signifiant « contre-révolutionnaires »), appelés aussi « Résistance nationale », étaient des groupes armés en lutte contre le gouvernement sandiniste au Nicaragua.
[35] Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, par. 110.
[36] Dans cet arrêt, la Cour a considéré qu’une « telle assimilation aux organes de l’État de personnes ou d’entités auxquelles le droit interne ne confère pas ce statut ne peut que rester exceptionnelle, elle suppose en effet que soit établi un degré particulièrement élevé de contrôle de l’État sur les personnes ou les entités en cause […] » in Application de la Convention pour la prévention du génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J, recueil 2007, par. 406.
[37] Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, par. 110, et Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2007, par. 406.
[38] Ibid., p. 62.
[39] Ibid., par. 115.
[40] Pour plus de détails, voir : A/HRC/39/CRP.1, p. 83.
[41] Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, p. 114.
[42] James Crawford, Premier rapport sur la responsabilité de l’État, Annuaire de la Commission du droit international 1998, Vol. II, 1, 4. Le texte proposé du premier alinéa de l’article 8 était : « […] agit en fait sur les instructions ou les directives et sous le contrôle de cet État ».
[43] TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić (alias « Dule »), jugement du 7 mai 1997.
[44] Ibid., par. 124.
[45] La Cour a noté : « Il n’a pas été soutenu qu’au moment où ils attaquaient l’ambassade les militants aient eu un statut officiel quelconque en tant qu’« agents » ou organes de l’État iranien. Leur comportement, lorsqu’ils ont organisé l’attaque, envahi l’ambassade et pris ses occupants en otages, ne saurait donc être considéré comme imputable à l’État iranien sur cette base. Il ne peut pourrait être considéré en lui-même comme directement imputable à cet État que s’il était avéré que les militants agissaient alors effectivement pour son compte, parce qu’un organe compétent dudit Etat les aurait chargés d’une opération déterminée. Les éléments d’information dont la Cour dispose ne permettent cependant pas d’établir, avec le degré de certitude nécessaire, l’existence au moment d’un tel lien entre les militants et un organe compétent de l’État », in Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (Fond), Arrêt : C.I.J., Recueil 1980, par. 58.
[46] Kenneth P. Yeager v. Islamic Republic of Iran, 17 Iran-U.S. Claims Tribunal Reports, 1987, vol. IV, par. 39. Le Tribunal des différends a ajouté : « Même s’il y a eu des plaintes concernant le manque de discipline au sein des nombreux Komitehs, l’ayatollah Khomeiny les a soutenus et les Komitehs, en général, ont été d’une loyauté sans faille envers lui et les dignitaires religieux. Peu après la victoire de la Révolution, les Komitehs, à l’inverse des autres groupes, ont réussi à asseoir leur position au sein de la structure du pouvoir et se sont finalement vus attribuer une ligne permanente au budget de l’État » (ibid., par. 39).
[47] TPIY, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Duško Tadić (alias « Dule »), jugement du 7 mai 1997, par. 127.
[48] Ibid., par. 137.
[49] Ibid.
[50] Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2007, par. 406.
[51] Selon la Cour international de justice, le TPIY « n’était pas appelé dans l’affaire Tadic, et qu’il n’est pas appelé en règle générale à se prononcer sur des questions de responsabilité internationale des Etats, sa juridiction étant de nature pénale et ne s’exerçant qu’à l’égard des individus », in Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2007, par. 403.
[52] Ibid. par. 406.
[53] Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, par. 110.
[54] Ibid., par. 112.
[55] Ibid.
[56] Ibid. par. 115.
[57] Application de la Convention pour la prévention du génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J, recueil 2007.
[58] A/HRC/39/CRP.1, par. 235.
[59] A/HRC/36/54, par. 25 ; A/HRC/39/63, par. 22 ; A/HRC/42/49, par. 25 ; A/HRC/45/32, par. 83.
[60] A/HRC/36/CRP.1, par 711 ; A/HRC/39/CRP.1, par. 235 ; A/HRC/42/CRP.2, par. 72 ; A/HRC/45/CRP.1, par. 159.
[61] A/HRC/39/CRP.1, par. 235, 292 et 350 ; A/HRC/42/CRP.2, par. 72, 88 et 396 ; A/HRC/45/CRP.1 ; par. 198,278, 286 et 418.
[62] A/HRC/39/CRP.1, par. 235.
[63] A/HRC/39/CRP.1, par. 235 ; A/HRC/45/CRP.1, par. 167.
[64] Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), Ordonnance, C.I.J., Recueil 2008, p. 353 et suivantes.
[65] Ibid., par. 149.
[66] Catan et autres c. République de Moldova et Russie, par. 122, et Mozer c. République de Moldova et Russie, par. 110.
[67] Cour européenne des droits de l’homme, Ilascu et autres c. Moldavie et Russie, par. 392 et Catan et autres c. République de Moldova et Russie, par. 111).
[68] CCPR/C/RUS/CO/7, par. 6.
[69] Le Comité des droits de l’homme, dans son observation générale n° 31, aborde également la question du « contrôle effectif » sous l’angle de la juridiction. Il a ainsi noté que « les États parties sont tenus de respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et à tous ceux relevant de leur compétence les droits énoncés dans le Pacte. Cela signifie qu’un État partie doit respecter et garantir à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son contrôle effectif les droits reconnus dans le Pacte même s’il ne se trouve pas sur son territoire » (par. 10). Le Comité des droits de l’homme a en outre considéré la question du contrôle d’un État sur des entités non-étatiques davantage sous l’angle de l’étendue des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques que sous celui de l’attribution stricto sensu. Cela a notamment été le cas dans la Communication No. 2134/2012 (par. 5) s’agissant du contrôle exercé par la Colombie sur des groupes paramilitaires ou dans les observations finales sur la Fédération de Russie de 2015 (par. 6) à propos du contrôle qu’exerce la Russie sur les groupes opérant dans le Donbass (Ukraine) et en Ossétie du Sud (Géorgie).
[70] Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2007, par. 406.
[71] TPIY, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Duško Tadić (alias « Dule »), jugement du 7 mai 1997, par. 117.
[72] Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2007, par. 138 et 139.
[73] Communication n° 12/52, Saldías de López c. Uruguay, Communication n° R.13/56, Celiberti de Casariego c. Uruguay, Communication n° 623/1995 Domukovsky c. Géorgie.
[74] Communication no 2134/2012, Serna et autres c. Colombie, par. 9.3.
[75] Par. 76-78 du jugement.
[76] Voir : http://www.burundi.gov.bi/spip.php?article3082.
[77] A/HRC/39/63, par. 20.
[78] Il est à noter que depuis la révision de la constitution burundaise entrée en vigueur en 2018, le SNR ne fait plus partie des « corps de défense et de sécurité », mais relève directement de l’autorité du Président de la République. Cette modification implique que le SNR n’est plus soumis au respect de quotas ethniques qui, en revanche, continuent d’être applicables à l’armée et à la police nationale.
A/HRC/36/54, par. 80 ; A/HRC/39/63, par. 13, 25, 27 et 28 ; A/HRC/42/49, par. 25-26 ; A/HRC/45/32, par. 83-84.
[80] Ibid.
[81] A/HRC/36/54, par. 26 ; A/HRC/39/63, par. 20 et 38 ; A/HRC/42/49, par. 25 ; A/HRC/45/32, par. 83.
[82] A/HRC/36/54, par. 80 ; A/HRC/39/63, par. 13, 25, 27 et 28 ; A/HRC/42/49, par. 25-26 ; A/HRC/45/32, par. 83-84.
[83] Pour plus de détails, voir : A/HRC/39/CRP.1, par. 237.
[84] A/HRC/39/63, par. 20.
[85] Kenneth P. Yeager v. Islamic Republic of Iran, 17 Iran-U.S. Claims Tribunal Reports, 1987, vol. IV, par. 45.
[86] A/HRC/39/63, par. 27. Cette expression ne doit pas être confondue avec le « contrôle global effectif » utilisé par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt rendu le 18 décembre 1996 dans l’affaire Loizidou c. Turquie (par. 49). Outre qu’il s’agissait ici encore d’un cas d’extra-territorialité, la Cour européenne des droits de l’homme avait pris soin dans l’examen des exceptions préliminaires de qualifier la République turque de Chypre du Nord d’« administration locale subordonnée » à la Turquie, relevant de ce fait davantage de l’article 6 (« Comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État ») que de l’article 8 (« Comportement sous la direction ou le contrôle de l’État ») du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.
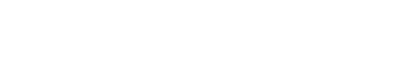

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
