
Louis Joinet, le juste et le droit.
Ma première rencontre avec Louis Joinet date de 1992. A ce moment, je suis étudiant à Nanterre et je milite au sein de la Maison des droits de l’Homme, une petite association qui relaie l’activité des ONG sur le campus. Et surtout je suis révolté : révolté par la guerre en ex-Yougoslavie et par ce que je considère comme l’inaction coupable de mon pays, la France, et des autres pays européens. Je connais le nom de Louis Joinet, qui est déjà un mythe pour tous les jeunes de ma génération qui s’intéressent aux droits de l’Homme. Outre sa qualité d’expert français à la Sous-Commission des droits de l’Homme, il est président-rapporteur du Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire et il vient de mener une visite conjointe en ex-Yougoslavie avec Tadeusz Mazowiecki, rapporteur spécial de la Commission des droits de l’Homme sur les violations commises dans ce conflit qui replonge l’Europe dans une barbarie jamais vue sur le continent depuis la Seconde guerre mondiale. Je suis chargé par Emmanuel Decaux de mener un entretien avec Louis Joinet pour le premier numéro du fanzine de la MDH, Horizon1. Tout en ayant a priori beaucoup d’admiration pour le personnage, je ne peux me défaire d’un certain scepticisme lorsque Louis Joinet me déclare devoir renvoyer à la justice le soin de déterminer si les nationalistes Serbes sont principalement responsables des exactions. De toute façon, les enquêtes, les casques bleus, l’action de l’ONU en général… tout ça me paraît dérisoire et en fait indécent. Il faut comprendre que pour les gens un peu engagés de ma génération, l’ex-Yougoslavie et le Rwanda constituent deux traumatismes majeurs et nourrissent le sentiment durable que ceux qui sont alors aux commandes ont trahi les promesses du nouvel ordre mondial qui paraissait devoir émerger de la Chute du Mur. Ils fondent pour certains un scepticisme radical, voire un nihilisme ; pour d’autres, comme moi, un pessimisme actif et un idéalisme réaliste.
Deux ans passent. Diplômé de Master 2 (on disait à ce moment un « DEA »), je candidate pour être stagiaire de Louis Joinet à la Sous-Commission des droits de l’Homme : je me retrouve aux premières loges, dans la salle XVII du Palais des Nations, à Genève, juste derrière un expert qui a fondamentalement le souci de la transmission.
Je ne savais pas que Louis avait été éducateur de rue, que sa carrière avait commencé comme ça : en tant qu’éducateur2. Sa vocation profite en fait à tous les stagiaires présents lors des sessions de la Sous-Commission : au moins une fois par semaine, il les réunit dans une salle attenante à la salle XVII, après la fin de la séance, pour décrypter les discussions – sans cela complètement ésotériques pour de jeunes esprits. Il nous apprend notamment la règle de base : « A l’ONU, le fond c’est la forme ». Autrement dit : tout est dans la procédure. Il la manie à la perfection, au moins autant que son complice et adversaire de toujours, le diplomate cubain Miguel Alfonso Martinéz. Les deux sont des travailleurs acharnés dont les nuits sont courtes ; ils jonglent avec les articles du règlement pour se poser mutuellement des chausse-trappes et prendre l’avantage l’un sur l’autre. Les autres membres de la Sous-Commission sont souvent leurs jouets ingénus, pris dans des stratégies qui les dépassent.
Être le stagiaire de Louis Joinet, c’est le nec plus ultra, un privilège incomparable par rapport aux autres stagiaires : un décryptage en direct, et des travaux pratiques. Louis me « traîne » partout, dans tous les petits conciliabules, au « Serpent » (la cafétéria du Palais des Nations, qui a cette forme reptilienne – et les conversations les plus secrètes ont lieu dans la « tête », tout au bout) ou dans un des bureaux derrière la salle XVII, où l’on rédige, sur un coin de table, des projets de résolutions ; ou au restaurant des délégués, où Louis obtient des concessions d’un ambassadeur qui pensait l’apprivoiser… En l’accompagnant, j’assiste à des discussions sur l’avenir du Timor oriental, avec José Ramos Horta – qui était alors sur les bancs des ONG et qui deviendra après l’indépendance premier ministre puis président de son nouveau pays –, j’écoute avec passion les émissaires du mouvement pacifique d’Ibrahim Rugova sur la situation au Kosovo et je vois s’écrire les clauses sur les droits de l’Homme et la transition démocratique du futur accord entre le gouvernement guatémaltèque et les chefs de la guérilla de l’URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca). Plus pratiquement encore, j’ai l’honneur de me faire marcher sur les pieds par une experte quelque peu dédaigneuse qui est visiblement agacée que je sois assis juste derrière Louis ; et je rédige un projet de note à l’intention du … Président de la République François Mitterrand… Car je découvre aussi progressivement « l’ubiquiste » qui, tout en menant les débats à la Sous-Commission à l’ONU, suit ses dossiers à l’Élysée et s’occupe de l’organisation du prochain festival du théâtre de rue à Aurillac… Combien cet homme a-t-il de vies ? Lui-même semble parfois s’y perdre, lorsqu’il s’emmêle avec ses différentes cartes de visite. Autre question tout aussi insondable : combien a-t-il eu de vies, avant d’être le Louis Joinet que je connais ? Un jour où je l’accompagne en voiture à l’aéroport, où il file toujours en dernière minute, il aperçoit dans mon coffre des chaussons d’escalade et s’émeut : cela lui rappelle le temps où il allait grimper à Fontainebleau !3 Je l’invite à une petite escapade le week-end sur quelques rochers (ça ne manque pas autour de Genève) : il me regarde et soupire que ce temps est passé. Il est dans une autre vie.
Un soir, Louis me demande même de l’accompagner pour le dîner : il est invité par la correspondante du journal Le Monde à Genève, Isabelle Vichniac. L’occasion est particulière : « Isa » a arrangé un dîner avec l’opposant marocain en exil, Abraham Serfaty, qui espère regagner sa patrie à l’issue de la timide ouverture politique esquissée par le Roi. Il s’agit de voir comment la France pourrait faciliter la chose… Louis ne sait pas qu’un an après je retournerai, avec ma future femme, Sara, voir Isa et son mari Jacques, dit « Genia », et que nous deviendrions des « enfants Vichniac », invités plusieurs fois par semaine de ces dîners complètement fous et improvisés rue de Beaumont, où se croisaient ambassadeurs, journalistes, opposants politiques et défenseurs des droits de l’Homme de tous les pays, peintres, poètes, amoureux transis et cœurs brisés (et parfois tout ceci à la fois)4.
A peine ai-je quitté Louis que je veux le retrouver pour continuer d’apprendre à ses côtés : je lui demande l’autorisation d’être son « assistant » cette fois en sa qualité de Président-Rapporteur du Groupe de travail sur la détention arbitraire, ce qui me permet d’assister à une session à huis-clos. C’est l’occasion de voir Louis exerçant l’art de la présidence – encore une autre facette : la construction habile du consensus. Louis dirige son Groupe de travail de cinq experts comme une barque dans la tourmente, alors que Cuba (encore « l’ami » Miguel…) mène l’offensive pour réduire la portée de son mandat. Emmanuel Decaux prend alors l’initiative d’organiser un colloque à Paris et m’invite à faire une de mes premières interventions d’apprenti-universitaire5. Le colloque et la contre-offensive diplomatique qui s’ensuit permettent de sauver l’essentiel, à savoir d’une part la capacité du Groupe de rendre certes non plus des « décisions », mais à tout le moins des « opinions » sur des cas individuels, en se fondant sur la Déclaration universelle des droits de l’Homme ; et d’autre part la compétence de se prononcer sur des cas de « détention » au sens large, incluant à la fois les détentions administratives, préventives, mais aussi les « emprisonnements » après jugement – ce qui impliquait que le Groupe de travail devait apprécier le caractère équitable du procès. A peu près au même moment, je boucle l’ouvrage tiré de mon mémoire de DEA sur les « procédures thématiques » de la Commission des droits de l’Homme, dont l’avant-propos est signé par mon directeur, Emmanuel Decaux, et la préface par Louis Joinet6.
Les nouvelles fonctions de Sara à Genève, comme représentante permanente de la FIDH, me conduisent de plus en plus à fréquenter les couloirs du Palais des Nations, où je m’emploie à mettre en œuvre les ficelles apprises de mon maître, mais au service de la diplomatie non gouvernementale. C’est ainsi qu’après avoir participé pendant trois ans à la négociation de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme7, je suis chargé par Antoine Bernard, alors directeur de la FIDH, d’assurer le suivi du projet de convention sur les disparitions forcées. Le projet en est au stade préliminaire, il fait encore l’objet de consultations au sein d’un groupe de travail informel réuni par des ONG autour de Louis Joinet, en tant que rapporteur du projet pour le Groupe de travail sur l’administration de la justice de la Sous-Commission des droits de l’Homme. C’est le début d’une nouvelle aventure, presque dix années, de novembre 1997 à décembre 2006, durant lesquels je vais constamment croiser la route de Louis, qui accompagnera tout le processus de rédaction en tant qu’expert et « sage ». Pendant la négociation8, Louis jouera un rôle clé à différents égards, en particulier auprès du président du Groupe de travail de négociation (2003-2006), l’ambassadeur français Bernard Kessedjian, mais aussi auprès des délégations étatiques, ignorantes pour beaucoup du phénomène des disparitions forcées, et que des trésors de pédagogie pouvaient amener à comprendre les spécificités du « crime du temps suspendu »9.
La conclusion du groupe de travail de négociation en septembre 2005 fut un moment d’intense émotion et de joie. Tous ceux qui étaient présents se souviennent de Louis, sortant son accordéon dans la salle XII, pour jouer le « tango de la ONU », puis à nouveau le soir, à la résidence de l’ambassadeur : voir et entendre les mères de disparus, les persécutés, les militants le plus souvent conspués par les États entonner en cœur Le temps des cerises dans un lieu si diplomatique, quel souvenir !
Entretemps, Emmanuel Decaux m’avait proposé en 2001 de renouveler l’expérience d’un entretien avec Louis Joinet10. Il s’agissait de réfléchir avec un peu de recul à la « lutte contre l’impunité », cette lutte (sociale) qui avait donné son nom à des principes (juridiques), généralement connus sous le nom de « Principes Joinet »11. Plus profondément, l’article s’intitulait « le temps des questions », parce qu’après une phase extraordinaire d’expansion durant les années 90, la lutte contre l’impunité et la justice pénale internationale semblaient marquer le pas. On commençait à voir les limites des tribunaux pénaux internationaux, les difficultés d’une prohibition totale des amnisties (de droit ou de fait) pour crimes graves en droit international, mais aussi les dysfonctionnements ou les limites de la compétence universelle, que l’affaire Pinochet avait mis sous les feux de la rampe et qui avait suscité un enthousiasme un peu exagéré, apparaissant comme une sorte de solution miracle pour lutter contre l’impunité. L’entretien avait lieu dans le Bureau de Louis Joinet à la Cour de cassation. Nous avons parlé plusieurs heures et l’article tel que publié constitue une synthèse d’une discussion passionnante entrecoupée de nombreuses digressions sur toutes sortes de sujets. Un moment m’a particulièrement marqué, qui ne se retrouve évidemment pas dans l’article : la discussion avait dérivé sur l’Algérie – l’Algérie contemporaine d’abord, avec la situation des familles de disparus des années 90 – puis l’Algérie de la « guerre de libération ». Louis Joinet commençait à évoquer cette période et je sentais sa voix se troubler. Puis tout à coup, à ma grande surprise, voilà ce monsieur, toujours calme, détendu et souriant, qui fond en larmes. J’étais sidéré : il esquisse une explication, puis s’arrête, c’en est trop. Un silence s’installe. Nous avons stoppé là l’entretien pour le reprendre un autre jour. Je ne lui ai plus jamais posé de questions, et il m’a fallu attendre la publication de ses mémoires pour apprendre la cause de son traumatisme12.
En raison de cette histoire, Louis Joinet a toujours entretenu une relation particulière avec l’Algérie, faite d’intérêt profond mais aussi de distance prudente. En 1995 ou 1996, il avait pris à la Sous-Commission l’initiative d’une résolution sur la situation en Algérie, mais l’avait retirée au dernier moment, voyant qu’elle risquait de ne pas réunir la majorité des voix. Comme je représentais à ce moment la FIDH, je lui avais reproché cette reculade en des termes vifs, à vrai dire excessifs, voire grossiers. Je crois qu’il en avait très blessé, parce qu’il ne manquait pas, de temps à autres, de me rappeler mes paroles, avec amusement, mais aussi avec un fond visible de tristesse. Plus tard, il avait tenté d’obtenir un visa pour participer à une session de formation avec les familles de disparus à Alger : le visa lui avait été refusé. Encore plus tard, dans le contexte d’un débat sur les disparitions forcées à l’ONU, il avait émis devant l’Ambassadeur d’Algérie le souhait de pouvoir retourner un jour dans ce pays, en compagnie de Germaine, « avant de partir pour un monde que j’espère meilleur… »
On ne peut pas espérer de meilleur maître à l’ONU que Louis Joinet. Et c’était un maître non pas pour enseigner la théorie – cela ne l’intéressait guère – mais la pratique. Louis était un praticien par excellence : c’est à dire qu’il enseignait à celui ou celle qui l’assistait la pratique du droit, par l’exemple. Il discourait peu. Éventuellement, il commentait, décryptait. C’est ce qu’il faisait lors de ces séances avec les stagiaires de l’ONU : il mettait en lumière ce qui venait de se passer et qui, sinon, serait resté pour nous dans l’obscurité ; il nous donnait les sous-titres nécessaires sans lesquels nous n’aurions pas pu comprendre le film des événements.
Si je traduis en une formule un peu théorique (dans laquelle il ne se reconnaîtrait pas forcément), il m’a enseigné que le droit n’est pas un jeu abstrait de l’esprit, mais des règles dont se saisissent les acteurs sociaux en vue de défendre leurs intérêts. Voilà pour la connaissance. Une fois que l’on a compris cela, on ne « lit » plus le droit de la même manière, comme une suite d’énoncés articulés entre eux par des connecteurs logiques. Derrière le droit, il y a la société.
Mais il y a aussi la morale du droit : la question du « que dois-je faire » en tant que juriste ?
Sur ce point, il y aurait beaucoup à tirer de la pratique de Louis Joinet, mais aussi de ses « maximes » – ces petites phrases qu’il répétait souvent, avec des variations selon les contextes, mais qui concentraient une expérience unique. Ces maximes, toutes celles et tous ceux qui l’ont fréquenté les ont en tête ; certaines sont retranscrites dans ses écrits, depuis ses rapports jusqu’à ses Mémoires, en passant par ses interventions dans les colloques : « à l’ONU, le fond c’est la forme »13 ; « sans les ONG, il n’y a pas d’ONU »14 ; « quand la roue de l’Histoire finit par tourner, l’opinion internationale découvre avec stupeur que ces prétendus « mensonges » [à propos des allégations de violations des droits de l’homme] étaient bien en deçà de la vérité ! »15 ; « pour pouvoir tourner la page, encore faut-il l’avoir lue ! »16 ; « ne pas mettre sur le même plan l’oppresseur et l’opprimé »17… Dans le cadre limité de cet article, j’aimerais m’attarder sur deux de ces formules, que je qualifie volontiers d’impératifs pratiques pour le juriste.
Qualifier ces deux formules d’« impératifs pratiques » est parfaitement apocryphe. Louis n’a pas utilisé ces termes. Je joue donc ici le rôle d’un exégète qui, à partir des paroles du maître, cherche à construire une pensée. J’espère seulement ne pas trop trahir la sienne. Voici à peu près comment ces formules peuvent s’énoncer : « chercher la solution entre l’idéalement souhaitable et le relativement possible »18 ; et : rechercher « des compromis sans compromissions »19. Ce ne sont pas des principes théoriques, mais bien pratiques, en ce sens où ils sont à la disposition du praticien lorsqu’il se trouve face à des choix.
Ces deux formules m’accompagnent tout le temps – et c’est en ce sens que je les traduis en « impératifs ». Elles permettent de baliser un parcours difficile, où il faut constamment faire son examen de conscience : si je veux arriver à un but, quelles ambitions dois-je avoir, quels compromis puis-je accepter ? La première maxime rappelle ce qu’un autre maître, que j’ai moins connu, Antonio Cassese, aurait appelé une « utopie réaliste »20. J’utilise aussi les termes d’« idéalisme pratique ». Lorsqu’on agit, il faut toujours viser l’idéal. Ce qui implique qu’il faut avoir un idéal clairement conçu et défini, un horizon clair, une vision nette de ce vers quoi l’on tend. L’idéal, dans cette conception, n’est pas l’Idée platonicienne : ça n’est pas un état inatteignable dans le monde humain, mais un état que l’on vise comme fin et qui ne paraît pas irréalisable dans ce monde – qui n’est pas « purement chimérique », écrivait le vieux Kant21. Pour autant, l’action implique de prendre en compte les contraintes ici et maintenant : c’est le « relativement possible ». La question que l’on doit donc sans cesse se poser est : que puis-je faire hic et nunc, compte tenu des contraintes multiples, pour me rapprocher au maximum de l’idéal que je me suis fixé ? Cette maxime incite donc à une recherche d’efficacité maximale en fonction d’un but, compte tenu des contraintes existantes. Mais pour tenir compte de ces contraintes et agir, il faut faire des compromis.
C’est là qu’intervient la seconde formule : qui distingue les « compromis » et les « compromissions », deux termes qui, malgré leur relative homophonie, ne veulent effectivement pas du tout dire la même chose : le « compromis », c’est la solution intermédiaire ou de moyen terme, nous enseigne le dictionnaire de l’Académie française. Tandis que la « compromission », c’est « l’acte par lequel, que ce soit par faiblesse de caractère, par intérêt ou par ambition, on transige sur ses principes, sur ses opinions », selon la même source. Dans les deux cas, il y a bien accord et concession. Mais il y a deux différences fondamentales : d’abord le mobile de l’accord dans la compromission se rapporte à soi, et non à quelque chose qui est extérieur à soi : on a peur, on veut sauvegarder son intérêt, on ne vise pas l’idéal. Ensuite, la compromission est fondée sur une transaction avec ses propres principes : cela peut être des principes moraux ; mais aussi des principes juridiques. Autrement dit, l’accord se fait au prix d’une violation de règles qui, pourtant, auraient dû s’appliquer et fixer le cadre dans lequel l’accord pouvait intervenir. Pour un juriste, cette condition est fondamentale : la création juridique, c’est-à-dire le fait de fixer de nouvelles règles générales, ou bien d’appliquer des règles générales à des cas particuliers, s’entend d’une création dans un cadre préexistant de normes qui limitent nécessairement la créativité, mais en même temps garantissent que la norme créée soit non seulement conforme, au sens juridique, aux principes, mais plus profondément fidèle à ces principes, dans un sens davantage éthique cette fois. Le compromis est une transaction et un accord dans un cadre préexistant ; ce cadre étant fixé en vue de prévenir les acteurs du compromis contre les risques liés à leur propre subjectivité : peur, préjugé, envie, intérêt… voire, dans les cas les plus graves, risque d’arbitraire, choix fait sans raison, l’irrationalité ayant pour objectif précisément de créer un sentiment d’insécurité chez l’autre et, par là, de lui faire comprendre la réalité brute et éventuellement brutale d’un pouvoir de fait.
Ces deux maximes sont donc des guides dans l’action. Évidemment, leur mise en pratique au cas par cas est affaire de jugement. Et l’on peut se tromper dans son jugement. Je ne prétends pas d’ailleurs que Louis Joinet ne se soit jamais trompé dans sa pratique de juriste22. Pas plus que je prétende avoir toujours visé juste lorsque, à maintes reprises, je me suis rappelé ces maximes au cours d’une négociation. Ce sont des formules, pas des recettes. Elles permettent de se figurer différents éléments et la manière de les combiner pour arriver à un résultat juste, mais pas exact. C’est la recherche d’un équilibre, mais aussi un cadre, fait de lignes rouges à ne pas dépasser : voulez-vous accomplir trop rapidement votre idéal, en faisant fi des contraintes pratiques ? La réalité se chargera de se rappeler à vous et condamnera votre entreprise à l’échec. Pensez-vous au contraire pouvoir accomplir quoi que ce soit en perdant de vue cet idéal et en ne vous efforçant pas de vous hisser à sa hauteur ? Vous êtes voués à la médiocrité dans l’action. Inutile de polluer les débats avec vos petites idées. Êtes-vous pressé d’obtenir un accord avant la fin de la journée, pour clore une négociation difficile et prêt, à cette fin, à transiger avec les principes ? Vous devenez dangereux, parce que pour gagner un jour, une année de votre temps, ou vous prévaloir d’une petite victoire – une victoire « à la Pyrrhus » – vous êtes prêts à compromettre la vie des autres. Quittez la table, revenez demain, ou même l’année d’après, ce sera l’occasion de reprendre la négociation à un niveau supérieur, en élever le « centre de gravité », pour utiliser une autre expression de Louis Joinet23. A l’inverse, vous ne voulez rien lâcher et restez arcbouté sur une manière de formuler les choses, parce que vous êtes sûr d’avoir raison et que l’autre a tort ? Restez chez vous, écrivez des romans ou des essais de philosophie, mais ne venez pas gâcher l’effort diplomatique au sens noble, consistant à accorder ceux que tout oppose, à transformer, comme une sorte d’alchimiste, la discorde en consensus…
***
On pourrait interpréter ces maximes comme relevant strictement de la technique de la négociation. Mais Louis Joinet montre qu’elles participent de l’éthique du juriste, puisqu’elles permettent de justifier ce qu’il appelle des « décisions limites » sur le plan juridique qui elles-mêmes sont appelées à conforter de « bonnes raisons » d’Etat. Cette distinction entre « bonnes » et « mauvaises » raisons d’Etat – qui sont en fait des « déraisons d’Etat » – constitue le fil rouge des Mémoires d’un épris de justice, dont le titre m’avait personnellement, dans un premier temps, laissé songeur : Mes raisons d’Etat. Tiens, voilà Joinet partisan de la raison d’Etat ? Quel drôle de retournement pour quelqu’un qui a toujours été du côté des opprimés ! Pourtant, à bien le lire, il n’y a pas eu changement de cap, mais approfondissement d’une intuition. En 1990, on peut déjà lire sous sa plume cette conviction que certaines raisons d’Etat doivent être entendues. C’est une réflexion qui naît dans son dialogue continu, en tant qu’expert indépendant, avec les ONG :
« Beaucoup d’Organisations non gouvernementales dénoncent les pressions des gouvernements sur les experts, mais elles ne se rendent pas compte qu’elles sont essentiellement un « lobby » qui fait des pressions sur les experts. Elles sont le sentiment, et c’est le plus souvent vrai, que c’est pour, sinon la bonne cause, du moins une cause meilleure que celle qui inspire trop souvent la raison d’État. Mais de l’autre côté, plus ça va, plus la notion de raison d’État est une raison objective. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il y en a qui sont justifiées et d’autres pas, mais il y a un certain nombre de cas où la raison avancée par un État pour prendre telle position peut avoir un fondement et que l’on doit accepter de discuter sans nécessairement se compromettre, et ça c’est très difficile de le faire admettre par les O.N.G. »24
Apparaît déjà l’idée que la prise en compte de la raison d’Etat peut donner lieu à un « compromis sans compromission » (« accepter de discuter sans nécessairement se compromettre »). Cette conviction est confortée par plusieurs affaires auxquelles Louis Joinet a été étroitement associé : l’élaboration de la « doctrine Mitterrand » à propos des anciens membres des groupes armés italiens25 ; les « transfèrements prétextes » de prisonniers de l’ETA afin de leur permettre de participer, dans une « maison isolée » à des négociations secrètes avec des émissaires espagnols26 ; les accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie, accordant l’amnistie aux membres du FLNKS (crimes de sang exclus, mais les accusés comparaîtraient libres à leurs procès, ce qui impliquait leur libération par effet de la loi et non sur décision d’un juge)27 ; des situations de « transition » au Timor oriental et en Haïti28. Dans tous ces cas, la solution est trouvée au prix de libertés prises avec la loi, ce qui ne peut manquer de faire réfléchir le juriste. Le fait de se retrouver ainsi au carrefour du politique et du juridique amène Louis à prendre le parti de l’esprit sur celui de la lettre et à rejeter ce qu’il appelle « l’intégrisme juridique », c’est-à-dire une interprétation trop rigide des règles de droit qui revient à se réclamer d’un « droit hypostasié ». Au contraire, dans toutes ces affaires, les « bonnes raisons d’État » amènent à faire plier le droit sans le rompre, à faire preuve d’« inventivité juridique »29. A quelles conditions ? Là encore, Louis ne théorise pas – et il nous laisse là un vaste sujet de méditation. Il esquisse quelques pistes toutefois, à plusieurs endroits du livre. A propos des accords de Matignon et des négociations avec l’ETA, il avance que la « raison d’Etat » dont il se réclame « allait dans le sens de la paix et celui du droit des peuples : il consistait, précisément, à réparer des situations de “déraison d’Etat” qui avaient pu pousser une communauté à se placer ainsi, à tort ou à raison, en position d’autodéfense »30. Compromis sans compromission, donc, au nom du progrès vers une fin ultime (la paix), de principes supérieurs (le droit des peuples), voire en réparation d’une « injustice » historique qu’un écart momentané par rapport à la règle rend possible. A propos des situations de transition, « entre l’idéalement souhaitable et le pratiquement possible, le juge doit souvent choisir le second terme de l’alternative, le pire étant l’immobilisme par excès de légalisme »31. Il faut en effet admettre une « certaine flexibilité juridique »32 et « bricoler des solutions de remplacement les plus proches possible de la légalité future » en recourant à des « garanties de substitution » ou des « équivalences de garanties »33. Exemple : un juge haïtien doit placer en détention provisoire neuf personnes auteurs d’exactions, alors qu’il n’existe plus de lieux officiels de détention utilisables – la privation de liberté dans un gymnase ou un entrepôt désaffecté est inévitable « malgré sa fragilité légale », mais avec des « garanties de substitution » :
« A ma demande, l’acte de réquisition précisa que le lieu de ce local provisoire soit rendu public, que son responsable officiel soit identifié, qu’un registre de présence et de mouvements des détenus soit tenu à jour et qu’enfin ces locaux soient accessibles à des contrôles de légalité »34.
On le voit, la raison d’Etat « façon Louis Joinet » reste « juridique », au sens large, c’est-à-dire par renvoi à une légalité non strictement positive (ce qui est écrit dans les lois), mais englobant les finalités, les principes et les règles supérieures de rang constitutionnel ou relevant du droit international : la paix, les droits de l’homme, le droit à l’autodétermination etc. Une position justifiée par la conscience des risques de dérives vers une forme de jusnaturalisme ou de « loi morale » qui renverrait à la subjectivité de chaque gouvernant, ce qui reconduirait une forme de « déraison d’Etat » :
« Mes bonnes raisons d’Etat impliquent d’assumer des décisions “limites”, prises dans le respect des droits de l’homme. Pour qui a connu trente-trois ans d’ONU, après avoir vécu l’affaire Ben Barka, cette précision n’a rien d’une langue de bois : il est des droits « indérogeables » »35.
Assez logiquement, ce « positivisme élargi » peut aller jusqu’à la désobéissance civile, c’est-à-dire le fait de violer une loi en vigueur et d’encourir la sanction pour cette violation, ceci en vue de dénoncer le caractère « injuste » de cette loi, ou le fait qu’elle est contraire à des normes supérieures36. Ainsi, dans le contexte de l’affaire du plateau du Larzac, Louis n’hésite pas à affirmer :
« Nous, juristes, dans cette affaire, devions rejoindre ce mouvement de désobéissance civile, au nom de cette légalité future »37.
Reste qu’un juge qui préconise de violer la loi au nom d’une légalité future, ça n’est pas (de droit) commun… Est-ce que le fait même de légitimer au nom du droit le contournement de la légalité ne signe pas la désintégration de l’idée de droit ? La condition même de l’existence du droit ne réside-t-elle pas dans le présupposé de l’obligation inconditionnelle qu’a le sujet d’y obéir ? Mais alors, on retombe sur ce que Louis appelle « l’intégrisme juridique » et sur la prétendue « neutralité axiologique » du juriste qui doit se contenter d’appliquer le droit « tel qu’il est »38. Au fond, ce que montre Louis, c’est que le juriste est « condamné » à ce tâtonnement, celui qui le conduit à « analyser, de manière très politique, toutes les situations où l’on est contraint, entre deux maux, de choisir le moindre »39. Et c’est dans cette quête qui sans cela serait aveugle que les deux impératifs peuvent aider : viser une solution entre le « l’idéalement souhaitable et le relativement possible » et trouver des « compromis sans compromission », ce qui exige d’avoir en vue ce « cadre » préexistant dont on a parlé plus haut : des décisions « limites » … dans le respect des droits de l’homme… Je dirais pour ma part que c’est ce qui, à travers la pratique du droit, aide le juriste à se situer au plus près de la justice. Mais disant cela, on laisse une marge d’erreur possible. Encore une fois, nulle recette dans ces préceptes, simplement quelques balises sur le chemin tortueux du droit que nous empruntons parfois dans une quasi-obscurité. Mais paradoxalement c’est cette marge d’erreur, cette incertitude et cette conscience de notre faillibilité qui nous préserve du fondamentalisme, d’une confusion entre le Juste et le Bien.
Finalement Louis Joinet ne nous laisse aucune certitude, aucun mode d’emploi :
« Où sont-elles, Mlle Denis, et Norma, et Juliana ? La coiffeuse tondue et la militante torturée et fracassée, et l’avocate de Rio, hantée par les fantômes des tortionnaires qui la poursuivaient. […] »40
Il nous lègue ses fantômes, pour que nous en prenions soin, pour que nous en entretenions la signification. C’est le legs d’un juste.
- « L’ONU et l’ex-Yougoslavie : un entretien avec M. Louis Joinet », Horizon. Le journal de la Maison des droits de l’Homme, n° 1, mars 1993.
- Louis Joinet, Mes raisons d’État. Mémoires d’un épris de justice, Paris, La Découverte, 2013, pp. 21 et suiv.
- Louis Joinet, Mes raisons d’État. Mémoires d’un épris de justice, Paris, La Découverte, 2013, p. 25.
- V. le récit de Cécile Romane, Les téméraires, Flammarion, 1993.
- Emmanuel Decaux (dir.), L’ONU face à la détention arbitraire. Bilan de six années de fonctionnement du Groupe de travail sur la détention arbitraire, avant-propos de Louis Joinet, Actes et documents, Réseau d’instituts des droits de l’Homme, n°2, 1997.
- Olivier de Frouville, Les procédures thématiques : une contribution efficace des Nations Unies à la protection des droits de l’Homme, Avant-propos d’Emmanuel Decaux, Préface de Louis Joinet, Paris, Pedone, coll. des « Publications de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l’Homme (FMDH), n°3, 1996.
- Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 53/144 du 9 décembre 1998. V. notamment « Les défenseurs des droits de l’homme ont-ils des droits ? L’ONU en question. Bilan de la 10ème session du Groupe de travail de l’ONU sur la protection des défenseurs des droits de l’homme », La Lettre de la FIDH, n°574-575, février 1995, pp. 2-7.
- V. notamment Olivier de Frouville, « La Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées : les enjeux juridiques d’une négociation exemplaire », Droits fondamentaux, n°6, 2007.
- V. le résumé de l’intervention de Louis Joinet dans le rapport du groupe de 2003 : E/CN.4/2003/71, § 21. La disparition forcée, en effet, « suspend » le temps, en ce sens où la disparition donne lieu à une incertitude quant au sort de la personne disparue. La situation reste « figée » au moment de la disparition. Les proches de la personne disparue demeurent dans l’attente de son retour. Et chaque jour commence avec cette question : « Où sont-ils ? » Cette « suspension » génère une angoisse tellement forte qu’elle est considérée comme une forme de torture par les organes de protection des droits de l’homme : une torture infligée au disparu, bien sûr, mais aussi aux proches du fait de cette attente insupportable. Pour riposter à cette forme de torture, le droit organise à son tour la suspension du temps en empêchant la prescription de courir. L’article 8 de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées énonce par conséquent : « 1. Tout Etat partie qui applique un régime de prescription à la disparition forcée prend les mesures nécessaires pour que le délai de prescription de l’action pénale : a) Soit de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de ce crime ; b) Commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu. 2. Tout Etat partie garantit le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription. »
- V. « Lutte contre l’impunité : le temps des questions. Entretien avec Louis Joinet », Droits fondamentaux, n°1, 2001, en ligne.
- V. le rapport final révisé établi par Louis Joinet en tant que rapporteur spécial sur la question de l’impunité des auteurs de violations des droits de l’homme (civils et politiques), E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 octobre 1997 et l’Ensemble de principes actualité pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité par Mme Diane Orentlicher, E/CN.4/2005/2012/Add.1, 8 février 2005.
- Louis Joinet, Mes raisons d’Etat, op. cit., pp. 32-34 : « Ma guerre active se condensa dans un seul “engagement”, au sens très militaire du terme, qui m’a traumatisé à vie. J’avais tué un homme. Un insurgé qui ne m’avait rien fait, sinon me prendre, à juste titre, pour un tueur placé là pour l’empêcher d’être chez lui. […] »
- V. Louis Joinet, « La Sous-Commission des droits de l’homme », in H. Thierry, E. Decaux (dir.), Droit international et droits de l’homme, Paris, Montchrestien, 1990, p. 156.
- Id., p. 160. Avec une variante utilisée ultérieurement : « sans les ONG, l’ONU serait au chômage technique ». V. notamment la préface à l’ouvrage de Sara Guillet, Nous, peuples des Nations Unies. L’action des ONG au sein du système de protection internationale des droits de l’homme, Paris, Montchrestien, 1995, p. 1.
- Louis Joinet, Mes raisons d’Etat, op. cit., p. 274. Ici cité dans le contexte du discours que Louis fit lors d’une conférence de presse à Port-au-Prince le 5 novembre 2003 en tant qu’expert indépendant sur la situation en Haïti.
- Dit à propos des violations des droits de l’homme du passé : v. notamment le rapport final révisé sur la lutte contre l’impunité, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, § 50.
- Louis Joinet, Mes raisons d’Etat, op. cit., p. 333.
- Comme Louis pratiquait plutôt la transmission orale, les traces de ces maximes dans ses écrits sont assez rares – si on les compare à l’usage qu’il en faisait dans sa pratique quotidienne, du moins celle dont j’ai été témoin. V. Cependant, pour la première, le rapport intérimaire sur la question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme, établi par MM. Guissé et Joinet, E/CN.4/Sub.2/1993, 6, 19 juillet 1993, où on trouve deux occurrences, § 62 et § 75, pour décrire la « gamme » des solutions en vue de répondre au « besoin de justice » face à l’impunité. Par ex. dans le paragraphe 75 : « Là encore, de l’idéalement souhaitable au relativement possible, il existe toute une gamme d’options : a) L’idéalement souhaitable serait un tribunal pénal international permanent institué par une convention multilatérale […]. B) Le relativement possible, dans un délai raisonnable, nous ramène à l’hypothèse de la création de tribunaux « ad hoc » du type de celui dont le Conseil de sécurité a décidé la création […] pour juger les crimes graves commis dans l’ex-Yougoslavie […] ». On trouve une version plus « pratique » ou « réaliste » dans les Mémoires d’un épris de justice, p. 285, à propos de la situation en Haïti : « Disons que, dans ces situations de transition, entre l’idéalement souhaitable et le pratiquement possible, le juge doit souvent choisir le second terme de l’alternative, le pire étant l’immobilisme par excès de légalisme ».
- Là aussi, les occurrences sont rares dans ses écrits, y compris les Mémoires. V. cependant, p. 262, évoquant la pression des ONG et la nécessité de préserver ses moyens d’enquête lors de visites in situ : « On est amené dans ce but à passer des compromis avec certains États, en se demandant constamment où finit le compromis et où commence la compromission. Il y faut des efforts patients et une vigilance de tous les instants pour éviter les nombreux pièges ».
- V. notamment l’introduction à l’ouvrage qu’il a dirigé et qui s’intitule de manière éloquente : Realizing Utopia. The Future of International Law, Oxford University Press, 2012.
- Emmanuel Kant, Projet de paix perpétuelle [1795], ed. bilingue, trad. de J. Gibelin, Paris, Vrin, 2002. Kant utilise cette idée de « chimère » ou de « fantaisie » à deux reprises dans le texte : AK VIII, 360 : « Or comme les relations (plus ou moins étroites ou larges), prévalant désormais communément entre les peuples de la terre, en sont au point qu’une violation du droit en un seul lieu est ressentie partout ailleurs, il s’ensuite que l’idée d’un droit cosmopolitique n’apparaît plus comme une manière chimérique [phantastiche, dans la version originale] et exagérée de concevoir le droit, mais comme un complément nécessaire au code non écrit du droit public et du droit des gens, afin de réaliser le droit public de l’humanité en général et par suite la paix perpétuelle dont on ne peut se flatter de se rapprocher sans cesse qu’à cette condition. » Et AK VIII, 368 : « C’est ainsi que la nature garantit, grâce au mécanisme même des penchants humains, la paix perpétuelle ; mais assurément, la sûreté qu’elle fournit n’est pas suffisante pour en prédire (théoriquement) l’avenir, elle suffit cependant relativement à la pratique et impose le devoir de travailler à ce but (qui n’est point purement chimérique). »
- Dans ses Mémoires, p. 262 et p. 297, par exemple, Louis évoque ses désaccords avec les ONG – qui me rappellent notre « discussion » à propos de l’Algérie, relatée plus haut. Ici à propos des « pressions » reçues par les experts indépendants : « Il est nature d’aborder la question de l’indépendance des experts sous l’angle des pressions que les Etats exercent sur eux. Plus complexe est la question, à l’opposé, des pressions exercées par certaines ONG pour faire passer leurs priorités. Quand on doit, par pragmatisme, emprunter un chemin plus inventif qui prenne en compte tout le contexte et n’aille pas s’embourber dans des dénonciations spectaculaires mais sans résultats, il est parfois plus difficile de savoir résister aux « amicales » pressions des ONG qu’à des pressions vindicatives des États ».
- On en trouve une trace dans un écrit, qui ramène à la problématique du « compromis sans compromission », à propos de l’usage du consensus par certains diplomates dans la négociation des résolutions à la Commission des droits de l’Homme : « On ne peut pas dire d’un côté : recherche de la coopération à tout prix et critiquer en même temps les recherches du consensus car les deux sont liés mais il arrive un moment où à rechercher un consensus exhaustif, on abaisse le centre de gravité de la résolution qui va réagir sur des violations, à un point tel que cela devient presque une caution. C’est un risque à long terme mais certains échecs peuvent néanmoins être des victoires. Dans certains cas on peut avoir un échec sur une résolution, je sais que les diplomates ne sont généralement pas d’accord avec cette stratégie mais dans des cas exceptionnels, il faut savoir laisser la Commission face à ses responsabilités. A ce moment-là, les organisations non gouvernementales prennent le relais de la critique. » Louis Joinet, « L’action des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme », Revue de droit public, 1990, n°5, p. 1252.
- Louis Joinet, « La Sous-Commission des droits de l’Homme », in Hubert Thierry et Emmanuel Decaux (précité note n° 11), p. 158.
- Louis Joinet, Mes raisons d’Etat, op. cit., chapitre 12, pp. 189 et suiv.
- Ibid., p. 225.
- Ibid., p. 234.
- Ibid., p. 282.
- Ibid., p. 235 : « Ce sont des cas où ce que j’appelle l’“intégrisme juridique” conduit droit dans le mur, selon le vieux principe cicéronien Summun jus, summa injuria (trop de droit tue le droit). Plus généralement, il arrive que ce “trop” de légalisme freine l’évolution nécessaire de la jurisprudence, alors que sa nature évolutive en fait le sel. Cet intégrisme est dangereux quand il conforte l’immobilisme et tarit l’inventivité juridique, à orienter bien sûr vers des progrès de l’État de droit. Une inventivité qui me tient à cœur comme juriste et même comme “rêveur” prêt à se situer parfois en fonction d’une légalité future. L’intégrisme légaliste revient à se réclamer d’un droit hypostasié, coupé de toute réalité et sans recours face à des crises où toute justice menace de disparaître. Ces situations sont certes résiduelles, mais assez régulières dans l’ordinaire d’un Etat de droit pour ceux qui en assurent la gouvernance ou la vigie, les “mains dans le cambouis” de la machine d’Etat. »
- Id., p. 235.
- Ibid., p. 285.
- Ibid, p. 282.
- Ibid., p. 283.
- Ibid., p. 284.
- Ibid., p. 170.
- Sur la désobéissance civile, v. par ex. Sandra Laugier, « La désobéissance comme principe de la démocratie », Pouvoirs, 2015/4, n°155, pp. 43-54 ; Albert Ogien, « La désobéissance civile peut-elle être un droit ? », Droit et société, 2015/3, n°91, pp. 579-592.
- Louis Joinet, Mes raisons d’Etat, op. cit., p. 84.
- V. sur ce point les travaux de Danièle Lochak, que Louis connaissait bien, sur le droit antisémite de Vichy : « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », in CURAPP, Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, p. 252 et « Ecrire, se taire… Réflexions sur la doctrine antisémite de Vichy », Le Genre humain, n°30-31, Le droit antisémite de Vichy, 1996. Et en écho à cette pensée, Olivier de Frouville, « Enseigner et militer : autour des deux visages de Danièle Lochak », in V. Champeil-Desplats, N. Ferré, Frontières du droit, critique des droits. Billets d’humeur en l’honneur de Danièle Lochak, Paris, L.G.D.J., 2007, pp. 311-320.
- Louis Joinet, Mes raisons d’Etat, op. cit., p. 333.
- Ibid., p. 334.
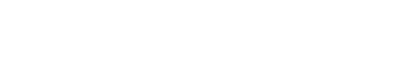

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
