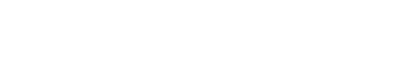PDF: ROME 70 DUDH DECAUX
INTRODUCTION
C’est un grand honneur pour moi de participer à cette session sur les fondements des droits de l’homme, avec une intervention consacrée à des notions essentielles, qui restaient implicites dans la Charte des Nations Unies comme dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, mais qui sont au cœur de la philosophie juridique de tout le système mis en place depuis plus de soixante-dix ans. En 1993, la Conférence mondiale des droits de l’homme de Vienne les a synthétisés, en affirmant que « tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés », avant d’ajouter sur un terrain plus politique : « La communauté internationale doit traiter les droits de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance ». Et de préciser dans un balancement fragile : « S’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales » (I, 5). Il s’agit bien de tous les droits de l’homme pour tous les hommes… Le défi est de passer de l’affirmation de ces grands principes à leur application pratique, avec le risque de sélectivité, de lacunes ou de « doubles standards ».
Cet anniversaire est l’occasion de revenir à la source, pour retrouver le fil conducteur du développement des droits de l’homme depuis la création des Nations Unies en 1945. Dès le préambule, ce ne sont pas tant que les États que les « peuples des Nations Unies », qui dans une forme de prosopopée, évoquent « le fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances » avant se dire résolus « à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites ». Ces deux premiers considérants de la Charte forment un diptyque saisissant, en fondant un nouvel ordre international qui associe l’égalité juridique des États et la dignité inhérente de la personne humaine, comme les bases de la justice et de la paix dans le monde. Au-delà des principes éthiques qui ont déjà évoqués – à commencer par le principe de dignité qui vient d’être présenté par le juge Raymond Ranjeva – il s’agit bien d’une révolution juridique dans le système international, d’un changement de paradigme faisant de la personne non seulement un objet mais également un sujet du droit international, contrairement à la logique inter-étatique du droit westphalien. Certes, cet idéalisme juridique va de pair avec le réalisme politique des États, dans le contexte de la seconde guerre mondiale puis de la guerre froide, mais la question de droits de l’homme cesse de relever de la compétence exclusive des États, de la sphère interne, comme c’était encore le cas avec la SDN, pour devenir un des objectifs de la coopération internationale, une « préoccupation légitime de la communauté internationale », comme le rappellera la Déclaration de Vienne (I, 4).
Les droits de l’homme figurent ainsi parmi les « buts » de la nouvelle organisation, comme le précise l’art.1 §.3 de la Charte qui vise à « réaliser la coopération internationale […] en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race de sexe, de langue ou de religion ». La formule constitue un leitmotiv de la Charte. On la retrouve de manière encore plus précise à l’article 55 qui évoque « le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Ainsi d’emblée le principe d’universalité et l’exigence d’effectivité sont-ils posés dans une tension permanente.
I – LES HORIZONS DE L’UNIVERSALITÉ
« La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » qui est le fondement de la Déclaration de 1948 implique l’universalité des droits de l’homme. Certes la Déclaration a été adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies – représentant avec une cinquantaine d’États « une très large majorité des membres de la communauté internationale » de l’époque, comme le soulignera la Cour internationale de Justice dans son avis du 11 avril 1949 – mais sa portée dépasse le cadre des États membres. De manière symbolique, René Cassin a introduit un amendement pour substituer au titre initial de « Déclaration internationale des droits de l’homme », celui de « Déclaration universelle des droits de l’homme ». Ce dépassement du cadre interétatique, pour viser tous les hommes, partout dans le monde, a des implications qui n’ont pas toujours été mesurées d’emblée.
Les destinataires des droits
1/ Elles concernent d’abord les « destinataires » de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le préambule le dit clairement, la Déclaration de 1948 est « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations », et doit être mise en œuvre « tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction ». Autrement dit, la Déclaration vise, sans doute de manière beaucoup trop indirecte, les peuples colonisés, mais elle n’en constitue pas moins déjà un puissant ferment pour l’affirmation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ainsi la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux adoptée par l’Assemblée générale le 14 décembre 1960 (rés.1514 (XV)) mentionne le « respect universel et effectif de droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » dans son préambule et se réfère expressément à la Charte et à la Déclaration universelle dans son dernier paragraphe. Inversement, le principe en vertu duquel « tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes » figure à l’article premier commun des deux Pactes sur les droits de l’homme de 1966. Les droits de l’homme et les droits des peuples sont indissociables, comme les deux faces d’une même liberté individuelle et collective.
Les nouveaux États membres, issus de la décolonisation, en adhérant aux Nations Unies, auront eux-mêmes l’occasion de souscrire aux principes de l’Organisation en se disant « capables et désireux de remplir les obligations de la Charte », mais au-delà de cette reconnaissance technique, ils auront l’occasion de manifester leur engagement politique lors de la conférence internationale des droits de l’homme de Téhéran en 1968, qui marque une nouvelle étape dans l’appropriation des droits de l’homme par l’ensemble des États, en mettant l’accent sur la lutte contre l’apartheid et la discrimination raciale ainsi que sur le développement économique et social. Il en ira de même, au lendemain de la chute du mur de Berlin, avec la Conférence mondiale des droits de l’homme de Vienne en 1993 qui constitue une réaffirmation solennelle des principes des droits de l’homme assortie d’un plan d’action visant leur mise en œuvre effective.
Enfin, il faut souligner que dans l’esprit des fondateurs, les droits de l’homme ne sont pas un privilège des États, ils concernent tous les peuples, y compris les peuples sous domination étrangère, et tous les individus, y compris les exilés et les persécutés, les réfugiés et les personnes déplacées, les apatrides et les « sans papiers »… À cet égard, l’une des dispositions les plus exigeante de la Déclaration de 1948 reste l’article 14 §.1 : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ». Force est de reconnaitre que cette formulation crée un droit individuel sans instituer sa contrepartie logique, une obligation étatique, en dehors du principe de non-refoulement. Il en va de même de l’article 13, « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » qui ne dit rien de l’État de destination. À ce stade, on peut seulement dire que la Déclaration fixe un principe général en renvoyant à des traités spécifiques, comme la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951, avec des limites dans l’espace et dans le temps qui seront gommées par le Protocole de New York en 1967, le soin d’en déterminer le contenu. Pour autant ces traités fondamentaux sont loin d’avoir fait l’objet d’une ratification universelle.
Les « débiteurs » des droits
2/ Mais, au-delà même de la prise en compte des groupes vulnérables, la Déclaration est universelle parce qu’elle s’adresse à « tous les individus et tous les organes de la société ». L’importance de cette formule ne sera perçue que progressivement. Certes le rôle des Organisations non gouvernementales, les « ONG » est reconnu par la Charte des Nations Unies qui consacre cette appellation avec son article 71, tout comme la Commission des droits de l’homme envisage dès le départ la création d’un réseau de commissions nationales des droits de l’homme. Il faudra attendre cinquante ans, pour voir adopter le 9 décembre 1998, la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme ou pour reprendre son intitulé complet la « Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus » (res.53/144).
En parlant de « droit et de responsabilité », l’AGNU se réfère à l’article 29 de la Déclaration universelle sur les devoirs à l’égard de la communauté, pour pratiquer un changement de perspective. Les droits de l’homme sont également les droits d’autrui. La Déclaration souligne dès son premier article que tous les êtres humains « doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Et elle s’achève en soulignant que « [l]’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible » (art.29). En introduisant les notions de solidarité et d’interdépendance entre les droits des uns et les devoirs des autres, en visant aussi bien les individus que « les organes de la société », la Déclaration met en lumière la responsabilité de nouveaux « débiteurs » des droits de l’homme.
À côté de l’État qui garde sa responsabilité première pour « respecter, protéger et mettre en œuvre » les droits de l’homme, les acteurs non-étatiques ont leur rôle à jouer dans leur « sphère d’influence ». C’est le cas des organisations internationales, à commencer par les Nations Unies, mais également des institutions financières et des banques de développement qui ne peuvent plus s‘abriter derrière une neutralité technique pour faire fi des conséquences de leurs politiques, notamment les ajustements structurels ou les conditionnalités, en matière de droits de l’homme. C’est également le cas des entreprises transnationales, souvent plus puissantes que les États, au-delà des engagements volontaires auxquelles elles peuvent souscrire dans le cadre du Global Compact depuis 2000, avec des obligations définies dans le « cadre conceptuel » adopté par le Conseil des droits de l’homme à la suite des travaux d’un expert indépendant, John Ruggie. Sur ce terrain la Sous-Commission des droits de l’homme avait fait œuvre de pionnier en soulignant la portée générale des instruments juridiques protecteurs des droits de l’homme afin d’éviter une forme de « pick and choose » de la part des multinationales, introduisant une sélectivité au sein droits fondamentaux de l’ONU et de l’OIT. Ces perspectives avaient été vivement critiqués à l’époque par les tenants du libéralisme économique qui estimaient que le marché indiscipliné devait faire le bonheur des peuples et que le droit international des droits de l’homme ne concernait que les États. Mais comme le disait déjà Lacordaire au cœur du XIX° siècle : « Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui libère ». Dans le même esprit, des négociations sont en cours, dans un groupe de travail du Conseil des droits de l’homme pour adopter un « instrument contraignant » sur les entreprises et les droits de l’homme.
En ce sens les droits de l’homme sont universels parce que la Déclaration s’adresse à tous, sans distinction, et rend chacun responsable des droits de tous, dépassant la conception traditionnelle des droits de l’homme fondée sur l’individualisme juridique qui se réduisait à un tête-à-tête entre l’individu et l’État. Deux composantes fortes apparaissent ainsi avec le principe de non-discrimination qui est le corollaire de l’égalité en dignité et en droits et vise aussi bien les législations et les politiques étatiques, en droit et en pratique, ainsi que la prise en compte des « relations horizontales – de l’effet à l’égard des tiers selon la théorie allemande de la Drittwirkung – entre personnes ou groupes ». D’une certaine manière le principe de non-discrimination est un dénominateur commun qui traduit aussi bien l’universalité que l’indivisibilité des droits de l’homme.
II – LES LIMITES DE L’INDIVISIBILITÉ
Si l’universalité est au cœur de la vocation des droits de l’homme il n’en va pas de même de l’indivisibilité. C’est la Déclaration universelle de 1948 qui opère une synthèse remarquable entre les différentes traditions juridiques, dans le droit fil du discours du président Roosevelt sur les « Quatre libertés » prononcé le 6 janvier 1941. Le préambule de la Déclaration y fait allusion en rappelant que « l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme ».
La synthèse initiale
1/ Tout le mérite de la Commission des droits de l’homme consistera à réconcilier les conceptions libérales héritées des grandes déclarations du XVIII° siècle et les aspirations sociales apparues au XIX° siècle. En 1919, le traité de Versailles dans sa partie XIII , portant création de l’OIT, traduisait cette première synthèse en soulignant que la « paix universelle (…) ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale » avant d’affirmer avec force une série de « principes généraux », comme l’idée que le travail ne doit pas être considéré comme une marchandise, et la reconnaissance de l’importance essentielle du « bien-être physique, moral et intellectuel » des travailleurs. Le programme de la nouvelle organisation est particulièrement impressionnant et vise notamment la liberté syndicale, le droit des travailleurs à un « salaire leur assurant un niveau de vie convenable », l’adoption de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures, l’adoption d’une repos hebdomadaire « qui devrait comprendre le dimanche toute les fois que ce sera possible », la suppression du travail des enfants, l’égalité salariale « sans distinction de sexe », la lutte contre le chômage, l’inspection du travail, etc. Ces principes affirmés au nom de la justice et de l’humanité sont également des éléments pour lutter contre le dumpling social, en notant que « la non-adoption par une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ». À l’évidence ce socle de droits sociaux était plus nécessaire que jamais au sortir de la grande crise économique et de la guerre mondiale qui se sont enchainées dans les années trente, montrant la fragilité des libertés publiques face aux États totalitaires.
Les auteurs de la Déclaration ont réussi à articuler dans un document unique l’ensemble des droits de l’homme, malgré les distinctions classiques entre libertés individuelles et créances sociales, obligations négatives – d’abstention de l’État – et obligations positives – impliquant au contraire une intervention publique. L’article 22 se trouve à la charnière des deux logiques, en précisant que « toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité […] ». Ce faisant la Déclaration répond autant aux réformes du New Deal et de l’État-providence, le Welfare State du plan Beveridge, visant à répondre à la crise des années trente qu’aux doctrines socialistes ou marxistes dénonçant les limites de la conception libérale des droits de l’homme. En ce sens parler de « sécurité sociale » n’est pas seulement instituer un régime d’assistance, une garantie minimale, c’est reconnaitre la dignité inhérente du travail et l’importance du libre développement de la personne, on pourrait parler ici de « sécurité humaine » et de « développement intégral ». Bien plus l’article 22 ouvre de nouveaux horizons en visant « l’effort national et la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et de ressources de chaque pays ». Sans remettre en cause la responsabilité première de chaque État, à travers la solidarité nationale, la coopération internationale a toute sa place pour contribuer à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels.
La Déclaration comporte une dimension culturelle particulièrement importante, même si elle est trop souvent négligée, en consacrant notamment le droit à l’éducation, éducation qui « doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (art.26 §.2). L’éducation aux droits de l’homme est ainsi un droit fondamental qui permet à chacun de connaître ses droits et les droits d’autrui, pour les respecter et les faire respecter. C’est le sens de la Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme adoptée au consensus le 19 décembre 2011 par l’Assemblée générale (res. 66/137).
L’indivisibilité retrouvée
2/ Mais le cadre synthétique ainsi défini par la Déclaration universel a vite trouvé ses limites. Lorsqu’il a fallu aller plus loin dans le programme de travail de la Commission des droits de l’homme, en passant d’une simple déclaration d’intention, un engagement moral, à un traité en bonne et due forme, créant des obligations juridiques, la logique volontariste du droit international a pris le dessus. Là où la Déclaration avait une portée erga omnes, les traités internationaux n’obligent que les États parties. Bien plus, en décidant, pour un choix tactique, de rédiger deux Pactes, l’un consacré aux droits civils et politiques, l’autre aux droits économiques, sociaux et culturels, la Commission des droits de l’homme introduisait une divisibilité dans le corpus de la Déclaration universelle. On retrouvera le même décalage dans le cadre régional, notamment au sein du Conseil de l’Europe.
Cette dualité rendait légitime de ratifier un instrument plutôt qu’un autre, voire de ne ratifier aucun des Pactes. Dans la pratique, on le sait, la ratification des deux Pactes de 1966 s’est faite de manière parallèle – avec aujourd’hui 172 États-parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 169 Parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – même si un clivage géopolitique majeur apparait avec les options radicalement opposées des États-Unis et de la Chine, qui continue à privilégier une conception idéologique des droits de l’homme au détriment d’une approche globale. Le divorce entre les deux Pactes se traduisait également par des approches différentes dans la garantie des droits, en mettant en avant la progressivité des droits économiques et sociaux, au détriment d’une pleine justiciabilité. Il faudra attendre le protocole additionnel au PIDESC adopté en 2008 pour voir reconnaître la compétence du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en matière de communications individuelles, rétablissant ainsi une symétrie complète entre les deux Pactes. Malheureusement cette consécration tardive survient au moment même où les « acquis sociaux » sont remis en cause dans de nombreux pays, et le nombre des ratifications du Protocole additionnel reste modeste.
Paradoxalement c’est en 1966 au moment de l’adoption des deux Pactes que la notion d’indivisibilité a été mise en valeur. Le préambule des Pactes convient une référence croisée, indiquant que l’idéal de la Déclaration « ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques ont créées » et inversement. Certes, il ne s’agit que des « conditions » et on pourrait craindre une conditionnalité subordonnant une catégorie à une autre, mais il n‘y a là ni « préconditions » impliquant une priorité ou une hiérarchie entre des « générations de droits», en permettant de renvoyer les libertés démocratiques à des jours meilleurs. Les droits de l’homme forment un tout, comme l’affirmera à son tour la Conférence mondiale de Téhéran en 1968 : « Les droits de l’homme et les libertés fondamentales étant indivisibles, la jouissance complète des droits civils et politiques est impossible sans celle des droits économiques, sociaux et culturels » (§.13). L’enjeu n’est pas seulement théorique, dans la mesure où l’indivisibilité de principe du corpus des droits de l’homme va de pair avec leur interdépendance.
III – LES CHEMINS DE L’INTERDÉPENDANCE
Loin d’être une simple répétition de l’indivisibilité, conçue comme un ensemble clos sur lui-même, à bien y réfléchir, l’interdépendance est une notion particulièrement ouverte. On pourrait la rattacher à l’idéal kantien de paix perpétuelle, tel qu’« une violation du droit en un seul lieu est ressentie partout ailleurs … ». Mais sans aller jusqu’à ce cosmopolitisme abstrait, impliquant des obligations solidaires, on peut suggérer deux pistes de réflexion, en envisageant une interdépendance matérielle et une interdépendance formelle.
L’interdépendance entre les droits
1/ Les droits de l’homme définis et énumérés dans les instruments universels ne sont pas pour autant « atomisés », il existe une solidarité profonde entre eux. Très souvent les violations sont multiples, mais elles prennent aussi parfois des formes systémiques. J’aimerai prendre deux exemples très différents qui illustrent des développements récents particulièrement importants. Le phénomène de l’extrême pauvreté est une notion qui a été prise en compte par les instances onusiennes, depuis une trentaine d’années, avec une étape marquante constituée par l’adoption par le Conseil des droits de l’homme de principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme en septembre 2012 (res.21/11), à la suite des travaux de la Sous-Commission des droits de l’homme puis d’une série d’experts indépendants. L’idée clef de ces travaux est le caractère cumulatif de l’extrême pauvreté, qui n’implique pas seulement la privation de « minima sociaux », mais la négation de l’ensemble des droits de l’homme, à commencer par l’accès à la justice, c’est-à-dire « le droit au droit ». Sans domicile, sans état-civil et parfois sans identité, il est impossible de voir reconnaitre sa « personnalité juridique », de faire valoir ses droits, de prendre part à la vie politique ou d’voir « un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille ». Autrement dit, les situations d’extrême pauvreté constituent la négation de tous les droits de l’homme. La question n’est pas seulement quantitative – en termes d’indicateurs avec des « besoins » à satisfaire – elle est avant tout qualitative avec des « droits » à respecter, à commencer par celui de l’égale dignité.
Dans un tout autre domaine, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée en 2006, crée à son article 1er alinéa 1, un nouveau droit de l’homme, en affirmant « [n]ul ne sera soumis à une disparition forcée ». Ce faisant la Convention demande aux États d’incriminer la disparition forcée en tant que tel, conformément à la définition donnée à l’article 2 : « On entend par « disparition forcée » l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toue autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État , suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ». Ces trois éléments objectifs sont essentiels pour une définition uniforme de ce phénomène complexe. En l’absence d’une telle incrimination, les organes internationaux – comme le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ou la Cour européenne des droits de l’homme – doivent procéder à une énumération de violations, comme les traitements inhumains ou dégradants, l’absence de garanties judiciaires, la négation de la personnalité juridique, l’atteinte au droit à la vie, etc. À l’évidence la disparition forcée est la somme de toutes ces violations – et on pourrait ajouter la liberté ‘aller et venir, la liberté de conscience, etc. – dans la mesure où elle constitue un déni absolu du droit.
La jurisprudence prend également l’angoisse des familles et des proches, en considérant que ceux-ci peuvent être également victimes de traitements inhumains.
Mais cette interdépendance des droits de l’homme peut prendre une dimension positive, avec des « cercles vertueux ». C’est le cas avec les Objectifs du développement durable, les ODD 2015-2030, qui ont pris la suite des Objectifs du millénaire pour le développement, les OMD 2000-2015. Alors que la place du droit au développement, conçu comme un droit individuel et collectif, depuis la Déclaration sur le droit au développement adoptée par l’Assemblée générale en 1986 (res. 41/128), donnait lieu à des discussions sans fin, la nouvelle approche a visé des priorités concrètes, avec des objectifs et des moyens, ainsi que des critères d’évaluation ; mais surtout en favorisant une « approche par les droits », les ODD réconcilient pleinement la promotion du développement durable et la protection de tous les droits de l’homme. Le droit à l’éducation pour tous, l’accent mis sur les droits des femmes, en termes de participation et d’autonomisation, d’empowerment, constituent des objectifs en soi mais également des leviers pour la mise en œuvre de l’ensemble des droits de l’homme, « les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux » selon une énumération qui souligne l’imbrication de tous les droits.
La cohérence entre les systèmes juridiques
2/ À côté de cette approche systémique portant sur la substance même des droits, il faut faire place à une approche plus formelle qui concerne les systèmes juridiques eux-mêmes.
Une première question concerne l’interaction entre les différents systèmes de protection des droits de l’homme qui s’inscrivent dans le droit fil de la Déclaration universelle. En effet, à la suite des deux Pactes, des conventions spécialisées ont été adoptées visant la protection de groupes vulnérables ou la prévention de crimes internationaux particulièrement odieux. Cet ensemble d’une dizaine de traités de base (core instruments), eux-mêmes assortis de protocoles facultatifs, ont une vocation universelle. La Déclaration de Vienne de 1993 recommandait d’ailleurs la ratification universelle des instruments déjà en vigueur, à l’instar des deux Pactes, la Convention contre la discrimination raciale de 1965, la Convention contre la discrimination à l’égard des femmes de 1979, la Convention contre la torture de 1984, la Convention des droits de l’enfant de 1989 et la Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990. Même si la Conférence de Vienne était restée très prudente à l’égard de nouvelles initiatives, deux autres conventions ont été adoptées en 2006, la Convention sur les droits des personnes handicapées et la Convention sur les disparitions forces dont il vient d’être fait mention. Ce corpus juridique de plus en plus dense et complexe, voulu par les États, répond à des besoins évidents. Force est de constater que les organes généralistes n’avaient pas pris la mesure de la spécificité de la question des droit des personnes handicapées, alors que la Convention apporte une philosophie radicalement neuve, fondée non sur une conception paternaliste voire eugéniste, mais sur « le respect de la dignité intrinsèque [et] de l’autonomie individuelle » des personnes en visant « la participation et l’intégration pleines et effectives à la société » (art. 3).
Toute réforme visant une harmonisation si ce n’est une uniformisation du système ne doit pas perdre la valeur ajoutée des instruments les plus récents et les plus novateurs. Pour autant un effort de « renforcement » et de simplification s’impose pour rendre plus lisible, plus transparent et surtout plus efficace, le fonctionnement du système dans son ensemble, sans remettre en cause les engagements conventionnels assumés par les États. C’est tout l’enjeu de la « revue » à l’échéance de 2020 qui a été lancée par l’Assemblée générale à la suite de la résolution 68/268 de 2014. De leur côté les organes conventionnels doivent veiller à la cohérence juridique des leurs décisions – aussi bien dans le cadre de leurs « constations » qui ne peuvent s’imposer que par la qualité de leur raisonnement, à défaut de l’autorité de la chose jugée, que dans celui des observations générales qui ne doivent pas créer d’« obligations extra-conventionnelles ». Il en va de la sécurité juridique des États et l’effectivité des droits des victimes, comme le rappelait la Cour internationale de justice dans son arrêt Diallo de 2010.
Mais cette exigence de cohérence juridique concerne également les différents systèmes régionaux. Autrement dit, le grand défi est de faire jouer le principe de subsidiarité entre les différents niveaux concernés, le cadre national avec ses principes constitutionnels et ses garanties judiciaires, le cadre régional avec ses normes et ses recours juridictionnels, et le cadre international avec ses principes universels et ses mécanismes quasi-juridictionnels ? La question est souvent envisagée sous l’angle procédural – épuisement des voies de recours internes, principe de litispendance pour éviter les recours parallèles, le forum-shopping, – mais c’est avant tout une question de fond, si l’on veut éviter les conflits de compétences et les contradictions d’interprétation. Face à la contestation populaire des juges, les « juges étrangers » comme les juges nationaux, comment assurer tout à la fois la pleine cohérence avec les principes fondateurs et l’acceptabilité sociale des décisions rendues ? Le risque de remettre en cause l’universalité au nom de la souveraineté nationale.
C’est ici qu’apparait une dernière dimension de l’interdépendance, en rappelant que les droits de l’homme sont indissociables des notions d’État de droit et de démocratie. Ce triptyque, apparu dans les années quatre-vingt-dix dans le cadre de la CSCE puis dans celui de l’ONU, a des racines plus anciennes. La Déclaration de 1948 elle-même rappelle « qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit […] » la version anglaise est encore plus directe « by the rule of law ». De même si les travaux préparatoires illustrent de nombreux débats pour définir la « démocratie véritable », opposant les régimes parlementaires et les démocratie populaires, la formule retenue en parlant d’une « société démocratique » (art.29 §.2) n’est pas un euphémisme, elle traduit au contraire une exigence allant bien au-delà de l’organisation des pouvoirs étatiques pour inclure l’ensemble de la société civile, une presse libre, des contre-pouvoirs et des « corps intermédiaires », des gouvernements locaux, des associations actives, une société vibrante, etc. Les droits de l’homme ne peuvent être séparés de ce terreau social.
C’est bien le sens d’une des dispositions les plus exigeantes de la Déclaration, l’article 28 qui souligne que « toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration, puissent y trouver plein effet ». Cette exigence d’effectivité est particulièrement forte, même si les voies de mise en œuvre de ce « droit » individuel et collectif restent floues. La version anglaise va plus loin en parlant d’ordre social et d’ordre international. Là encore les travaux préparatoires sont éclairants, les discussions pour savoir ce qu’était un « ordre juste » ayant opposé les libéraux et les marxistes, on s’en est tenu au mot « ordre » sans qualificatif, en considérant qu’il se suffisait à lui-même ! Ce double défi est immense : non seulement un ordre interne, garant de l’effectivité de tous les droits de l’homme, mais également un « ordre international » digne de ce nom. C’est aussi faire écho aux formules du préambule selon lesquelles la reconnaissance à tous les membres de la famille humaine de « droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.