De ses premiers postes au Quai d’Orsay aux affaires économiques et financières en 1973 ou à la direction des Nations Unies (NUOI) jusqu’à celui d’ambassadeur à Rome (2007-2011), en passant par celui de conseiller diplomatique du Président de la République Jacques Chirac (2000-2002) et de représentant permanent de la France au Conseil de sécurité (2002-2007), Jean-Marc de la Sablière a eu une carrière impressionnante de diplomate, consacrée par la dignité d’Ambassadeur de France. Placé aux premières loges de la gouvernance mondiale et y participant activement, il a livré un premier témoignage personnel Dans les coulisses du monde (publié chez R. Lafont, 2013). Fruit de cette longue pratique onusienne et d’un enseignement à Sciences Po, un récent ouvrage sur le Conseil de sécurité, présente de manière systématique ses ambitions et limites (éditions Larcier, 2015). L’Ambassadeur de la Sablière a bien voulu nous accorder un long entretien sur son expérience aux Nations Unies, tout particulièrement dans le domaine des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
Propos recueillis par Nathan COLIN, Sarah JAMAL, Anaïs SCHILL et Laurent TRIGEAUD en mars 2016
Droits fondamentaux – Dans votre rapport de 2012 sur les enfants1, vous soulignez les succès du système mis en place par le Conseil de sécurité avec la résolution 1612 (2005), mais également ses limites. Vous critiquez notamment le fait que la menace de « sanctions » n’est pas suffisamment mise à exécution par le Conseil. Pouvez-vous développer les raisons de ce manque de mise à exécution de la menace selon vous ?
J.-M. de La Sablière – La résolution 1612 (2005) est une résolution novatrice et perçue comme telle, y compris par les ONG. Au départ de cette affaire, il y a une rencontre entre un homme et la délégation française. Cet homme est Olara A. Otunnu, représentant spécial du Secrétaire général pour la protection des enfants dans les conflits armés. Très tôt, il a l’idée que le dossier doit aller au Conseil de sécurité, parce que c’est là que se prennent les décisions. Son engagement a besoin d’un relai. La France va l’aider. D’abord mon prédécesseur, Jean-David Levitte, puis moi-même. Après une mission en Afrique, je suis convaincu que le dossier des enfants soldats peut être celui de la grande initiative de la France à New York que je recherche dans le domaine des droits de l’homme.
Après l’adoption de la résolution 1539 (2004), qui est difficile, et dans les mois qui précédent la résolution 1612 (2005), l’ensemble du dossier est fragile. Les délégations s’interrogent sur la question de savoir comment mettre en application des résolutions fixant des objectifs et sont divisées. La relation de plusieurs pays avec le Secrétariat est compliquée. Avec mon équipe, nous allons heureusement réussir à faire adopter le compromis de la résolution 1612, résultat de plusieurs années d’efforts. Ainsi va être mis en place le mécanisme de surveillance et de communication de l’information, avec des garanties qui ont été négociées : que les informations soient objectives et que le mécanisme fonctionne avec l’ensemble des institutions des Nations Unies, ainsi que des représentants du Secrétaire général déjà sur place. Nous obtenons que le rapport du Secrétaire général dénonce autant les violations commises dans des situations à l’ordre du jour du Conseil (annexe 1), que dans des situations qui ne le sont pas (annexe 2) (ceci existait déjà, mais était contesté et devait être confirmé), ce qu’on appelle le naming and shaming. L’idée de la signature de plans d’action est reprise. Mais la France est obligée de concéder que tout dialogue avec des groupes armés non étatiques n’est possible qu’avec l’accord du gouvernement concerné (Résolution 1612 (2005) du 26 juillet 2005, §2 d). Afin que le système mis en place soit dynamique, nous préconisons la création d’un organe subsidiaire. Les délégations russes et chinoises en particulier comprennent qu’en échange de ce dynamisme demandé, ils pourront avoir un certain contrôle sur le groupe de travail grâce à la règle du consensus. Le sujet des enfants n’est pas un sujet déclaratoire, mais opérationnel, pour lequel l’accord de tout le monde est nécessaire. Le système, en coopération avec la représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, fonctionne tant sur la pression que la coopération, à l’image de la carotte et du bâton.
Pour en venir à la question des sanctions – le bâton – celle-ci est très débattue. Nous arrivons à la maintenir, en reprenant la réserve selon laquelle les sanctions ne peuvent être décidées que dans des situations qui sont à l’ordre du jour du Conseil (Résolution 1612 (2005) §9, reprenant le paragraphe 5 c) de la résolution 1539 (2004) du 22 avril 2004). En revanche, les délégations refusent l’idée d’un comité des sanctions thématique. J’essaierai plus tard sans succès que le groupe de travail se voit conférer les attributions d’un comité des sanctions assisté d’un groupe d’experts. Les Chinois et les Russes, en revanche, n’ont pas eu de problème à ce que l’on ajoute progressivement les critères concernant les enfants dans tous les mandats des comités des sanctions existants.
Droits fondamentaux – Que gagnent les délégations à ce que les critères ne soient intégrés que dans le mandat des comités de sanctions existants et non incorporés dans celui d’un comité des sanctions prévu à cet effet ?
J.-M. de La Sablière – C’est une question de principe. La gestion du problème des sanctions par certaines délégations est prudente ; d’autant plus qu’elles pensent que d’autres délégations pourraient en abuser. Aujourd’hui, c’est probablement d’autant plus difficile avec les sanctions occidentales contre la Russie à propos de l’affaire de la Crimée. Je pense toutefois que dans l’ensemble, les sanctions sont crédibles et que sans elles, le système de sécurité collective serait très fragilisé. En tant qu’ambassadeur, je peux vous dire que lorsque vous menacez un pays ou quelqu’un de sanctions, son gouvernement fait tout pour qu’elles ne soient pas adoptées, hormis la République populaire démocratique de Corée.
Droits fondamentaux – Vous expliquez que le système mis en place par le Conseil de sécurité concernant les enfants et les conflits armés a servi de schéma pour l’adoption d’autres résolutions thématiques, notamment sur la protection des civils ou la question « femmes, paix et sécurité ». Celles-ci ne comportent toutefois pas d’organe subsidiaire pour le suivi de leur application et peuvent ainsi paraître moins ambitieuses. Qu’est-ce qui selon vous explique cette différence?
J.-M. de La Sablière – Je soulignerai d’abord que le dispositif mis en place par la résolution 1612 a permis d’obtenir des résultats car les gouvernements ont libéré les enfants qu’ils avaient engagés. Reste la difficile question des pressions à exercer sur les acteurs non étatiques, que j’ai examiné dans mon rapport en 2012.
Quant au domaine thématique plus largement, il est intéressant de voir la percée du Conseil de sécurité dans ce domaine à partir des années 2000. L’ensemble des membres du Conseil a le souci d’essayer de faire mieux pour assurer la protection des civils, de dénoncer des violations. Il n’y a toutefois pas eu de politique du Conseil. Celui-ci fonctionne au cas par cas, en fonction des crises et des initiatives. L’influence de certaines délégations sur les questions thématiques n’est pas à négliger. Celle de la France sur les enfants a été importante et a eu une influence sur l’initiative des résolutions sur les femmes qui est venue d’Hillary Clinton, lorsqu’elle était Secrétaire d’Etat américain. Plusieurs délégations, notamment la Russie, la Chine, mais aussi des délégations de grands pays émergents tels que l’Inde ou le Pakistan, constatant le dynamisme du groupe de travail sur les enfants, regrettent au fond un peu d’avoir accepté sa création. Beaucoup de pays ne veulent pas que l’on donne une telle dynamique à tous les sujets. Les Américains finiront par accepter qu’il n’y ait pas de groupe de travail pour les résolutions thématiques sur les femmes. Je pense qu’il n’y en aura pas à court terme. Mon expérience au Conseil est que c’est au cas par cas que les choses se passent et que pour le long terme, on verra plus tard. Sur certains sujets et notamment les droits de l’homme, on prend ce qu’on peut gagner lorsque les conditions d’un compromis sont réunies, en cas de recul, on essaie de mettre une digue et le reste est reporté à plus tard. Ma vision est qu’il ne faut pas insulter le long – et même le moyen – terme.
Droits fondamentaux – Pensez-vous qu’à moyen ou long terme, le Conseil créera d’autres groupes thématiques ?
J.-M. de La Sablière – Je ne sais pas s’il y aura des nouveaux groupes de travail thématiques, mais je pense que quand il y a des crises, quand il y a un vrai besoin, quand il y a une volonté chez certains et pas d’obstacle chez d’autres, le Conseil peut être très créatif. Il l’a été dans le domaine des droits de l’homme, ne serait-ce que si l’on pense à l’adoption de la résolution 688 (1991)2. Les négociations ont permis d’adopter une résolution qui qualifie la répression des populations kurdes en Iraq, qui a conduit à un flux massif de réfugiés vers des frontières internationales ainsi qu’à des violations de frontières, de menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région3.
Droits fondamentaux – À ce propos, dans votre ouvrage, vous citez la lutte contre le terrorisme comme l’un des domaines illustrant cette créativité du Conseil à laquelle vous venez de faire référence, ainsi que sa capacité d’adaptation. Quels sont selon vous les apports du Conseil en la matière ?
J.-M. de La Sablière – Le terrorisme est aujourd’hui perçu comme la menace principale à la paix et à la sécurité internationales. Elle relève avant tout de la coopération entre les services compétents des Etats. Au niveau onusien, l’Assemblée générale traite de la question, ce qui est très bien, mais n’a pas beaucoup d’efficacité. Quant au Conseil de sécurité, sa contribution est triple dans ce domaine.
Tout d’abord, son action entraîne une grande mobilisation internationale. À titre d’exemple, le simple fait que le Conseil se saisisse de la question des combattants étrangers (résolution 2178 (2014) a eu un effet mobilisateur important sur le sujet.
La seconde contribution est apportée par les résolutions normatives, notamment la 1373, adoptée après le 11 septembre 2001, et la 1540 sur la non-prolifération des armes de destruction massive et les acteurs non-étatiques, dont j’ai participé à la négociation et à l’adoption. Nous avons eu du mal à faire adopter la résolution 1540 dans de bonnes conditions, car si la résolution 1373 a été adoptée dans les jours suivants les attentats du 11 septembre 2001, à un moment de grande émotion, la 1540 l’a été à froid. Or certains États étaient très réticents vis-à-vis de ce type d’outil, estimant que le Chapitre VII est fait pour gérer des crises et des conflits et non pour imposer des normes générales et permanentes. Cela risquait selon eux de transformer le Conseil en législateur. Les Allemands ainsi que les Pakistanais faisaient partie par exemple de ces Etats réticents. La négociation de la résolution 1540, adoptée juste après la crise irakienne de 2003, a pour cette raison été particulièrement difficile. L’enjeu pour une telle résolution adoptée en dehors d’une crise était de rassembler une large adhésion pour faciliter sa mise en œuvre. Nous avons donc rencontré de manière informelle, avec mes collègues britannique et américain, les représentants des groupes régionaux afin de leur présenter notre projet. Nous avons fini par réussir à les convaincre en mettant en avant le fait que l’adoption d’une résolution du Conseil sur le fondement du Chapitre VII de la Charte était amplement préférable à l’alternative consistant à négocier pendant des années une convention sur le sujet, en prenant le risque que la ratification universelle ne soit jamais atteinte. Le compromis a été de limiter les effets de la résolution à deux ans dans un premier temps, avant de l’étendre à dix ans, ce qui prouve son acceptation. Cette dynamique s’est poursuivie récemment avec l’adoption de la résolution sur les combattants étrangers que j’ai déjà évoquée et qui met plusieurs obligations à la charge des États pour lutter contre ce phénomène.
Enfin, la dernière contribution du Conseil de sécurité dans la lutte anti-terroriste repose sur les mesures ciblées (gel d’avoirs, interdiction de voyager, etc.) contre les personnes placées sur la liste du « comité 12674 ». Je note au passage que ces mesures montrent une nouvelle fois le caractère inapproprié du terme de « sanctions » du Conseil de sécurité, puisqu’il s’agit en réalité de mesures préventives. Quoiqu’il en soit, le grand intérêt de ces mesures réside dans leur universalité.
Droits fondamentaux – S’agissant de ce dernière outil, vous mettez en avant le fait que le principal défi actuel est l’équilibre à trouver entre les préoccupations sécuritaires et les exigences en matière de droits de l’homme dans l’imposition des « sanctions ciblées » du Conseil. Vous semblez estimer à ce sujet que les exigences de la CEDH5 et de la CJUE6 sont peut-être trop élevées, ce qui risque selon vous de « porter atteinte à un instrument essentiel du maintien de la paix et de la sécurité internationales pour les Nations Unies7 ». Pourriez-vous nous expliquer cette crainte et la manière dont devrait s’établir cet équilibre selon vous ?
J.-M. de La Sablière – C’est en effet mon sentiment. Nous avions perçu très tôt, avec Kofi Annan et d’autres délégations, notamment avec mon collègue anglais, que le respect des droits de l’homme était une exigence essentielle lors de l’inscription de personnes sur les « listes noires » du Conseil et que le système initial n’était pas satisfaisant en la matière. À cet égard, la première affaire Kadi a le mérite d’avoir obligé le Conseil à avoir une approche plus respectueuse des droits des individus. Il a ainsi créé le point focal et le bureau du médiateur, doté de pouvoirs importants, et imposé l’exigence de motivation de l’inscription de personnes sur les listes. Je pense donc que nous avons fait beaucoup de progrès et que nous avons petit à petit réussi à mettre en place un système assez respectueux des droits de l’homme. Mon expérience du Conseil de sécurité me laisse en tout cas penser qu’il sera difficile d’aller beaucoup plus loin que ce que nous avons déjà obtenu des autres États membres. Dès lors, j’espère que les juges, éventuellement sous réserve de quelques améliorations supplémentaires, finiront par se satisfaire des garanties mises en place. Dans le cas contraire, si les condamnations pour les mesures d’exécution des mesures du Conseil se multiplient, je crains en effet que les États ne finissent par abandonner le système des listes du Conseil et se tournent vers d’autres solutions, moins universelles et moins transparentes, basées exclusivement sur des mesures nationales et sur la coopération entre services étatiques.
Plus généralement, il me semble que dans des périodes aussi troublées que celle que nous vivons, la réaction normale des peuples est de demander plus de sécurité et que l’équilibre entre cette exigence et les droits de l’homme évolue nécessairement. Il est bon que les mesures sécuritaires restent encadrées par les juges, qui jouent leur rôle, mais j’espère que ceux-ci sauront s’adapter.
Droits fondamentaux – Nous voudrions à présent aborder le thème de la responsabilité de protéger (R2P). On sait que la genèse de ce concept a été assez longue et difficile, des appels de Kofi Annan, notamment lors du sommet du millénaire en 2000, à l’adoption du concept par l’Assemblée générale en 20058 et son endossement par le Conseil de sécurité en 2006. Vous qui avez été à l’ONU pendant une partie de cette période, pourriez-vous tout d’abord nous faire part de votre témoignage sur ce processus ?
J.-M. de La Sablière – Cela n’a pas été une négociation facile au départ et une personne a joué un rôle primordial. Cette personne, c’est Kofi Annan. Il faut se rappeler que nous sommes peu de temps après le génocide rwandais et l’intervention de l’OTAN au Kosovo et que le sujet est donc brûlant. C’est beaucoup à la suite des prises de position du Secrétaire général (Kofi Annan à l’époque) que la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États (CIISE) a été créée par le Canada et a effectué son travail préparatoire, suivi du rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement en 2004, et enfin de l’adoption du document final du Sommet mondial de 2005 entérinant la R2P. Vous pouvez constater qu’il y a des différences entre le rapport de la Commission CIISE et le texte final adopté par l’Assemblée générale. Nous avons cependant réussi à garder l’essentiel et à trouver un compromis sur l’action de la communauté internationale via le Conseil de sécurité, tout en faisant une place à l’action des organisations régionales, notamment à la demande de l’Union Africaine. Il a été difficile d’obtenir un consensus sur ce compromis, mais nous avons finalement fini par l’obtenir en nous appuyant sur l’engagement de Kofi Annan et l’aide du Président de l’Assemblée générale, Jean Ping. Une fois le texte du document final adopté par l’Assemblée générale, nous nous sommes demandé, avec mon collègue britannique, comment le transposer au Conseil de sécurité. Nous avons tenté de faire adopter une résolution spécifique à cet effet, mais cela n’a pas été possible. Nous avons donc profité de l’adoption de la résolution 1674 (2006) sur la protection des civils dans les conflits armés pour introduire un paragraphe réaffirmant le principe de la responsabilité de protéger tel que consacré aux paragraphes 138 et 139 du document final du sommet mondial. La première référence opérationnelle à la R2P est ensuite faite dans le préambule de la résolution 1706 (2006) sur le Soudan, avant sa mise en œuvre effective dans l’affaire libyenne sur le fondement de la résolution 1973 (2011).
Droits fondamentaux – S’agissant justement de l’application de la R2P dans l’affaire libyenne, la mise en œuvre de la résolution 1973, qui faisait référence au concept, a suscité un vif débat. Beaucoup d’États ont en effet estimé que l’OTAN a outrepassé le mandat conféré par la résolution, qui autorisait le recours à la force pour protéger les civils, pour renverser le régime de Mouammar Kadhafi. Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur cette controverse et ses implications pour le futur de la R2P ? Depuis, des références ont été faites dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité à la responsabilité première des États de prévenir les crimes de masse, mais pensez-vous que le troisième pilier de la R2P, qui concerne l’action de la communauté internationale en cas de manquement des autorités nationales, a encore des chances d’être mis en œuvre ?
J.-M. de La Sablière – À mon sens, la première erreur concernant la résolution 1973 est d’avoir « brandi le drapeau » de la R2P un peu trop précipitamment et un peu trop ostensiblement. Vu la difficulté que nous avons eu à adopter le concept, il eut été bon de réfléchir un peu plus attentivement au maniement qui allait en être fait.
Le second point concerne la mise en œuvre effective de la R2P dans cette affaire9. Je pense que ceux qui estiment que le mandat donné par la résolution 1973 a été outrepassé, comme ceux qui défendent la position inverse, ont des arguments. Mais en réalité, ce qui compte, c’est la perception qu’ont eu les États de l’application de la R2P. Or, beaucoup d’États membres, et pas seulement la Russie et la Chine, ont estimé que le mandat du Conseil de sécurité a été dépassé et que les États intervenants ont fait une utilisation abusive de la R2P. C’est cela qui importe, car il est impossible de manier de tels concepts sans un consensus, ou au moins un très large accord, entre les États membres.
La question est donc aujourd’hui de savoir si la R2P est morte. Je ne le crois pas pour plusieurs raisons. Tout d’abord on la retrouve dans des résolutions thématiques, notamment celle adoptée récemment sur la lutte contre le génocide (résolution 2150 (2014), présentée par le Rwanda). Ensuite, le Conseil se réfère encore souvent au premier pilier de la R2P. Enfin, il y a des actions qui correspondent au troisième pilier de la R2P, mais sans qu’on le dise. Par exemple, l’action de la France pour prévenir des massacres en République Centrafricaine, c’est de la R2P. Il en va de même pour l’action de l’ONU au Sud-Soudan. En revanche, il me semble qu’il est impossible, à l’heure actuelle, d’invoquer explicitement le troisième pilier. Les Russes, en particulier, le refuseraient. C’est pourquoi il n’a pas pu l’être sur la Syrie.
Pour l’avenir, si l’on veut réhabiliter le concept, je crois qu’il faudra accepter de discuter sérieusement des modalités de mise en œuvre, ce que les Occidentaux ont refusé de faire jusqu’à présent. En particulier, il faut, comme le demandent plusieurs États tel que le Brésil et comme le préconisait déjà la CIISE, poser la question de la progressivité de la réponse de la communauté internationale, pour savoir si l’usage de la force ne doit être considéré que comme un ultime recours (idée que certains États rejettent d’ailleurs en se fondant sur la lettre de la Charte, l’article 42 prévoyant la possibilité de recourir à la force sans imposer dans un premier temps des mesures coercitives non armées, si le Conseil les estime inadéquates). Il faut également s’interroger sur la question de l’encadrement de l’usage de la force autorisé par le Conseil. Il est évidemment difficile d’obtenir un consensus sur cette question, car les états-majors nationaux veulent avoir les mains les plus libres possibles, mais il est nécessaire d’avoir cette discussion. Je pense d’ailleurs que la position de la France sur le veto serait plus solide si nous acceptions parallèlement de discuter ces modalités.
Droits fondamentaux – Justement, que pensez-vous de la proposition française de renoncer, par un engagement volontaire des membres permanents du Conseil, à la possibilité d’utiliser le droit de veto en cas de crimes de masses ?
J.-M. de La Sablière – Je pense qu’il s’agit essentiellement d’une posture et que cette proposition a très peu de chances d’aboutir. En outre, sa mise en œuvre poserait beaucoup de question. En particulier, qui déciderait que des crimes de masse sont commis ou seraient sur le point de l’être et que le veto doit donc être écarté ? Certains ont parlé du Secrétaire général ou de l’un de ses représentants spéciaux, par exemple celui sur le génocide, ou encore d’un vote à une majorité qualifiée de l’Assemblée générale, mais tout cela ne me semble pas faisable.
Cela étant dit, cette proposition n’est pas dénuée d’intérêt pour beaucoup d’États, favorables à tout encadrement du droit de veto, qui vont donc la soutenir fortement. Si l’on arrive à une large majorité d’États soutenant « l’interdiction » du veto dans certaines situations extrêmes pour les populations civiles, son utilisation dans ces situations, sans être impossible, sera plus difficile. Même si je ne crois pas qu’elle aboutira, cette proposition présente donc un intérêt politique important, et il faut la soutenir.
Droits fondamentaux – Toujours en lien avec la R2P, que pensez-vous de l’idée selon laquelle les commissions d’enquête seraient des mécanismes de sa mise en œuvre ?
J.-M. de La Sablière – Au fond, cette idée ne me trouble pas. Je pense que les difficultés à propos de la responsabilité de protéger concernent avant tout l’usage de la force. Mais le troisième pilier de la responsabilité de protéger ne consiste pas seulement en cela. La communauté internationale peut également agir ou essayer de prévenir les crimes par d’autres moyens. Utiliser des commissions d’enquête comme mécanisme de mise en œuvre de la R2P peut en faire partie.
Droits fondamentaux – Pour poursuivre sur les commissions d’enquête, le Conseil de sécurité crée actuellement beaucoup moins de commissions que dans les années 1990. Comment cela s’explique-t-il selon vous ?
J.-M. de La Sablière – Je constate que le Conseil de sécurité a décidé en août 2015, sur la base des informations de la mission d’établissement des faits de l’OIAC concernant les allégations d’utilisation du gaz de chlore en Syrie, la création d’une commission d’enquête conjointe OIAC – ONU. En l’occurrence, il s’agissait d’allier la compétence technique d’une organisation existante et l’autorité de l’ONU agissant à la demande du Conseil pour attribuer les responsabilités. Mais le Conseil de sécurité peut toujours décider la création d’une commission d’enquête ad hoc sans s’appuyer ou passer par une organisation s’il n’existe pas une institution crédible. L’exemple de la commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies sur le Liban l’illustre bien. Elle a pu être créée en raison de la détermination de la France ainsi que du contexte particulier de l’affaire libanaise10. Je ne serai donc pas surpris que le Conseil de sécurité décide dans telle ou telle affaire de créer une commission d’enquête, mais il ne le fera que de manière exceptionnelle. Le Conseil étant un organe politique, il faut qu’un certain nombre de conditions politiques soient réunies. En particulier, le Conseil ne va pas s’engager en ce sens si ses principaux membres ne pensent pas que le rapport de la commission d’enquête sera suivi d’une éventuelle action de la part du Conseil. Prenons l’exemple de la commission d’enquête sur le Darfour. Sa création par le Secrétaire général à la demande du Conseil (résolution 1564 (2004)), voulue par les Américains, a été possible en raison de la grande émotion suscitée par ce qui a été qualifié par certains de génocide. Elle l’a été également parce que les Américains ne s’opposaient pas à une action ultérieure du Conseil ; simplement, ils n’envisageaient pas qu’il s’agirait de la saisine de la Cour pénale internationale.
Droits fondamentaux – Si le Conseil de sécurité ne crée que de manière exceptionnelle des commissions d’enquête, comment s’informe-t-il ? Peut-il, par exemple, s’appuyer sur les enquêtes des commissions d’enquête créées par le Conseil des droits de l’homme ?
J.-M. de La Sablière – Je n’ai pas connaissance de rapports de commissions d’enquête créées par le Conseil des droits de l’homme qui seraient transmis directement au Conseil de sécurité. Ceux-ci sont d’abord transmis à l’Assemblée générale ou au Secrétaire général. Ce relais n’est pas inutile. Il peut être l’occasion pour l’Assemblée générale, et donc la majorité de ses membres, d’envoyer un signal fort politiquement. Tel a été par exemple le cas lorsque l’Assemblée générale a soutenu les conclusions du rapport de la commission d’enquête du Conseil des droits de l’homme sur la Corée du Nord et est allée jusqu’à recommander que le Conseil de sécurité défère la situation à la Cour pénale internationale. Cet appui par une très forte majorité des membres de l’Assemblée a permis de faire inscrire la question à l’ordre du jour du Conseil de sécurité, même si aucune mesure n’a pu être adoptée en raison du blocage de la Chine.
Par ailleurs, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme joue également un rôle important dans l’information du Conseil de sécurité. Progressivement s’est mise en place la pratique d’interventions des Hauts Commissaires devant le Conseil de sécurité. Cette idée était dans un premier temps fortement contestée en particulier par l’Ambassadeur de l’Inde. Il a ainsi fallu attendre six années pour que Mary Robinson soit invitée à un débat en 1999 devant le Conseil de sécurité. De 1999 à 2009, le titulaire du poste ou son adjoint a informé le Conseil de sécurité à quinze reprises. Cela est aujourd’hui devenu banal et est particulièrement fréquent à propos de l’affaire syrienne.
Droits fondamentaux – A propos de l’articulation entre le Conseil de sécurité et d’autres organes, nous souhaiterions recueillir votre avis sur ses relations avec la Cour pénale internationale. Le Conseil l’a saisi pour la première fois concernant la situation au Darfour. Pouvez-vous revenir sur les négociations préalables à cette saisine ?
J.-M. de La Sablière – L’article 13 (b) du Statut de Rome prévoit que le Conseil de sécurité peut déférer une situation à la Cour, même si un Etat n’y est pas partie. Plusieurs raisons expliquent comment cette saisine a politiquement été possible. L’émotion face à la situation au Darfour était grande. Le rapport de la commission internationale d’enquête sur le Darfour présidée par Antonio Cassese concluait que compte tenu de la situation, la saisine de la CPI était la seule solution. Louise Arbour, à l’époque Haut Commissaire aux droits de l’homme, était venue au Conseil de sécurité pour présenter le rapport et appuyer la dénonciation de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et actes de génocide commis au Darfour. La saisine de la Cour n’était toutefois pas gagnée d’avance vu l’attitude des Américains envers la Cour et le fait que les Russes n’ont pas ratifié le Statut de Rome et les Chinois ne l’ont pas signé. La France a tout de même pris le risque de se lancer dans des négociations visant à faire adopter une résolution déférant la situation à la Cour. Les Anglais nous assuraient de leur soutien, à condition de trouver un compromis avec les Américains. Nous nous sommes également rendus compte que neuf Etats membres du Conseil avaient ratifié le Statut de Rome. Nous avons donc choisi de réunir régulièrement ces Etats pour convenir d’une position commune et la défendre, afin d’inciter les Américains à négocier : toute autre solution que la Cour serait refusée. Les Américains quant à eux cherchaient à défendre l’idée d’un tribunal ad hoc créé conjointement par l’Union africaine et l’ONU. Mais les Etats africains membres du Conseil ont soutenu avec force la Cour pénale à ce moment-là (en particulier la Tanzanie et le Bénin). Les Américains ont alors constaté qu’aucune autre solution que la saisine de la CPI ne serait soutenue. Ils y ont consenti à la condition que le Conseil décide que les ressortissants d’un Etat contributeur à l’opération de maintien de la paix non partie au Statut de Rome ne pourraient pas être poursuivis par la Cour pénale internationale et restent soumis à la compétence exclusive dudit Etat pour toutes allégations d’actes découlant des opérations au Soudan (résolution 1593 (2005) §6).
Droits fondamentaux – Par la suite, la Procureur de la CPI a décidé de suspendre les poursuites, fustigeant le manque de soutien du Conseil de sécurité : quel impact cette décision a-t-elle selon vous sur la justice pénale internationale ainsi que sur les rapports entre la CPI et le Conseil de sécurité ?
J.-M. de La Sablière – Cet exemple illustre que le Conseil n’est pas toujours cohérent, car il s’agit d’un organe politique. Il en va de même dans l’affaire libyenne à ma connaissance. Je le déplore parce que cela fragilise la menace que le Conseil de sécurité peut proférer, de manière plus ou moins voilée, lorsqu’il rappelle par exemple que les auteurs de crimes doivent être jugés et qu’il convient de lutter contre l’impunité, en faisant référence à la justice nationale mais également internationale. Cela diminue sa capacité de pression notamment à l’égard d’acteurs non étatiques. Je pense à certains acteurs non étatiques qui ne craignent pas les sanctions mais peuvent craindre la Cour pénale internationale. Il y a donc une incohérence. Elle peut s’expliquer par le fait que sur 193 membres, il n’y en a que 124 qui ont ratifié le Statut de la Cour. J’ai toujours pensé que la Cour en elle-même est un progrès de civilisation considérable. Monter une opération comme celle-là qui n’est pas universelle, ça n’est pas évident. Mais une fois qu’on l’a fait, il faut qu’au minimum les pays qui ont ratifié le Statut de Rome la défendent. Or aujourd’hui, la position des Etats africains fragilise la Cour. C’est vraiment regrettable.
Droits fondamentaux – Quelles sont les chances selon vous d’une future saisine par le Conseil de la CPI (surtout lorsque l’Etat en question n’est pas partie au Statut de Rome) au regard du droit de veto opposé à la saisine de la CPI en Syrie ?
J.-M. de La Sablière –Il faudra y réfléchir à deux fois. Le risque d’accentuer cette faiblesse est trop grand, donc je dirais que sans se l’interdire, il ne faudrait pas le faire maintenant. Mais le rôle de la France doit être de défendre la Cour. Ça n’est pas toujours évident, en particulier lorsqu’une enquête concerne un chef d’Etat. Le Conseil n’a pas d’obligation de coopérer avec la Cour ou d’obliger les Etats à le faire. S’il a toutefois lui-même pris l’initiative de déférer une situation à la Cour, c’est difficile d’accepter qu’il ne coopère pas.
Droits fondamentaux – Nous voudrions à présent vous interroger sur les tendances récentes relatives à l’emploi de la force. D’une part, on constate une multiplication des interventions militaires unilatérales, notamment sur le fondement de la légitime défense ou du consentement de l’État territorial. D’autre part, on observe que de plus en plus d’États tentent d’élargir la notion de légitime défense (légitime défense préventive, doctrine du unwilling or unable, etc.), ou de créer de nouvelles exceptions à l’interdiction de l’usage de la force (droit d’intervention humanitaire unilatérale par exemple). Que vous inspirent ces tendances du point de vue du système de sécurité collective mis en place par la Charte et de l’objectif de centralisation du recours à la force ?
J.-M. de La Sablière – Je pense qu’il s’agit d’un sujet absolument majeur et je partage les préoccupations de Kofi Annan à cet égard. Je reste persuadé que, malgré les nombreuses violations de l’interdiction du recours à la force, le système de sécurité collective mis en place par la Charte (et qui n’a commencé à fonctionner véritablement qu’après la guerre froide) est un vrai facteur de stabilité et que sans lui, nous aurions un véritable chaos aujourd’hui. Or quand les États, et notamment les grandes puissances, violent la Charte, ils fragilisent le système. En particulier, l’action contre l’Irak en 2003 a été un désastre. La rigueur devrait davantage accompagner la lutte contre le terrorisme. Par exemple, la question des fondements juridiques des interventions en Syrie est à peine posée. Même la France, qui était très attachée à une lecture traditionnelle de l’article 51 ne permettant la légitime défense que contre un État, invoque la légitime défense contre Daesh, ce que l’on peut comprendre car c’est une sorte d’animal hybride. Il y a dans l’ensemble cependant un risque de fragilisation du système que je trouve très inquiétant. J’espère en particulier que l’on arrivera à un accord politique sur la situation en Syrie, conformément à la résolution 2254 (2015) de manière à pouvoir ensuite obtenir une résolution du Conseil autorisant clairement l’emploi de la force contre Daesh dans cet État. Il serait en effet cohérent d’avoir une véritable action collective encadrée par le Conseil contre une entité qui est considérée comme l’ennemi mondial et à cet égard la récente résolution 2249 (§5), qui est une sorte de blanc-seing politique est utile, mais n’est pas suffisante.
Droits fondamentaux – S’agissant de la position française, vous mettez en avant dans votre ouvrage sur le Conseil de sécurité le fait que la France est traditionnellement très attachée au multilatéralisme et au respect de la Charte. Sa volonté d’intervenir militairement en 2013 en Syrie, sans autorisation du Conseil de sécurité, après l’utilisation d’armes chimiques, ne rompt-elle pas avec cet attachement, et n’est-ce pas contraire à ses intérêts en tant que membre permanent ?
J.-M. de La Sablière – J’ai effectivement trouvé cette position inquiétante et ai d’ailleurs écrit une tribune pour exprimer mon désaccord11. J’ai trouvé qu’il y avait là une banalisation de l’usage unilatérale de la force affaiblissant le système de sécurité collective, au sein duquel nous avons pourtant une position privilégiée. J’ai à cet égard une très grande prudence, peut-être acquise au contact de Jacques Chirac. Celui-ci n’était pas opposé par principe au recours à la force s’il était nécessaire, mais il était beaucoup plus prudent et plus attentif aux conséquences éventuelles que nous ne le sommes aujourd’hui.
Droits fondamentaux – Pour en venir maintenant au rôle de l’Assemblée générale en matière de droits de l’homme, nous souhaiterions recueillir votre avis sur le bilan que vous tirez de la réforme de 2006 qui a remplacé la Commission des droits de l’homme par le Conseil des droits de l’homme12.
J.-M. de La Sablière – Le passage de la Commission des droits de l’homme au Conseil des droits de l’homme a été une négociation très difficile. C’était aussi un pari. A l’évidence, nous étions arrivés à une situation telle que la Commission n’arrivait plus à condamner certaines situations condamnables, parce que les États susceptibles d’être condamnés avaient pris un poids trop important en son sein. La présidence libyenne à l’époque a frappé les esprits. Tout comme l’affaire de Guantanamo. Les Européens finalement ne se comportaient pas avec la cohérence qu’on pouvait attendre de défenseurs des droits de l’homme. La Commission a perdu beaucoup de sa crédibilité. Je me suis même alors demandé si un tel organe inter-gouvernemental était encore nécessaire, une fois que tous les grands textes internationaux – une œuvre assez remarquable de la Commission – avaient été adoptés. La réponse me semblait être oui, à plusieurs conditions : que le Conseil soit composé d’une majorité d’Etats qui soient plutôt favorables aux droits de l’homme, et que nous arrivions à maintenir ce qui nous paraissait utile, notamment les rapporteurs spéciaux, et à lutter contre la critique du double standard (qui était assez fondée). L’Examen périodique universel (EPU) a été conçu (notamment par Louise Arbour) comme un bouclier contre cette critique du double standard. En introduisant les dispositions sur la nécessité de la majorité qualifiée ainsi que la suspension des Etats commettant des violations graves des droits de l’homme, nous avons abouti à un résultat pouvant fonctionner. Au fond, à côté des accords et conventions, de l’action menée par les ONG, d’internet et des réseaux sociaux, nous avons besoin d’un organe inter-gouvernemental, qui ne soit pas uniquement composé d’Etats occidentaux, dès lors qu’il est capable d’avoir une valeur ajoutée et que son image n’est pas décrédibilisée. Avec d’autres Etats, notamment les Anglais, nous nous sommes engagés et avons abouti à un compromis qui était difficile. Nous imaginions une élection des membres au bulletin secret, à la majorité des deux tiers. Finalement, la majorité absolue a été retenue. Sans pouvoir rallier les Américains au projet, nous avons constaté que les grandes ONG étaient pour, de même que Kofi Annan13. C’était un pari : celui de réunir autour des pays engagés dans les droits de l’homme une majorité de pays qui, sans être aussi sourcilleux que nous, partagent des objectifs et valeurs communes, avec lesquels d’ailleurs il y aura un dialogue constructif à travers la peer review.
Au début des premières années (2007-2008 en particulier), j’ai pensé que nous avions perdu ce pari. Ce qui se passait à Genève m’inquiétait beaucoup. Je me demandais si finalement nous n’avions pas eu tort. Mais quand je vois le fonctionnement du Conseil des droits de l’homme aujourd’hui et son bilan actuel, ainsi que la décision américaine d’y participer après l’élection de Barack Obama, je pense que nous ne nous sommes pas trompés. Entre la Commission, moribonde, et le Conseil des droits de l’homme, il vaut mieux avoir le Conseil que nous avons maintenant. Le Conseil des droits de l’homme est un organe interétatique et donc influencé par des considérations politiques, mais il peut s’appuyer sur des rapports factuels des commissions d’enquête et des procédures spéciales, ce qui lui apporte en crédibilité.
De manière générale, il ne faut pas avoir une vision de l’action des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme comme étant le résultat d’une architecture globale et cohérente. Il y a beaucoup de pièces qu’il faut essayer d’avancer. Certaines reculent, d’autres peuvent être avancées. Parfois on peut ouvrir de nouvelles pistes, créer de nouveaux organes. J’ai une approche très pragmatique. Lorsqu’on ajoute ou modifie quelque chose, il faut se poser la question de la valeur ajoutée. Si elle existe, il faut essayer de le faire. Cela a finalement été le cas pour le Conseil des droits de l’homme.
Droits fondamentaux – Pour conclure, dans votre ouvrage sur le Conseil de sécurité, vous soulignez les tensions actuelles entre les membres du Conseil concernant le rôle du Conseil et la souveraineté des Etats et le principe de non-ingérence. Pensez-vous que ces tensions conduiront à une focalisation du Conseil sur les questions sécuritaires, telles que la lutte contre le terrorisme, au détriment de la prise en compte des droits de l’homme (comme le montre l’exemple syrien) ?
J.-M. de La Sablière – En écrivant mon ouvrage, je me suis demandé s’il y avait ou non un recul en matière de droits de l’homme et ai beaucoup réfléchi. Je pensais constater un recul, mais en discutant avec plusieurs personnes, notamment d’anciens collaborateurs encore dans le circuit, je me suis dit qu’il s’agissait plutôt d’une pause ; peut-être parce que je l’espère. Il y a un recul, en tout cas une déception, sur la responsabilité de protéger, mais comme je l’ai expliqué précédemment, tout n’est pas perdu car une discussion quant aux modalités de sa mise en œuvre est possible. Si on regarde la relation entre le Conseil de sécurité et le Conseil des droits de l’homme ou le Haut-Commissaire, le souci du Conseil du respect du droit chaque fois que des opérations de maintien de la paix sont déployées, le fait que l’on puisse adopter des sanctions contre des individus lorsqu’ils commettent des violations graves des droits de l’homme (comme c’est le cas en Côte d’Ivoire), on voit que le recul n’est pas général, qu’il y a une « résistance » assez sérieuse et parfois quelques progrès même : c’est pourquoi il me semble que l’on peut dire qu’il s’agit d’une pause. Il faut avoir à l’esprit que ça n’est pas l’Occident contre le reste du monde. Je pense qu’il s’agit d’un combat permanent.
Droits fondamentaux – S’agit-il d’une pause dont le dégel dépend de l’accord retrouvé entre les membres permanents ?
J.-M. de La Sablière – Ma lecture sur le Conseil de sécurité a toujours été que pour fonctionner il a besoin de l’accord des membres permanents. Il a été conçu et a fonctionné comme tel. Le principal est la paix et la sécurité et les droits de l’homme n’étaient pas une priorité, même si leur respect concourt à l’objectif premier. Le système a commencé à fonctionner après la Guerre froide en raison de l’entente retrouvée entre les membres permanents. Le Conseil de sécurité est certes le reflet d’un monde inégalitaire, mais il ne peut pas y avoir de Conseil sans droit de veto et cette inégalité.
Le Conseil a su s’adapter sur les droits de l’homme, le terrorisme, la non-prolifération, etc., lorsque les cinq membres permanents étaient d’accord. Les décisions adoptées depuis 1990 reflètent-elles pour autant uniquement le compromis trouvé entre les membres permanents ? Oui dans beaucoup de situations, mais pas toujours. L’accord de membres non permanents est toujours nécessaire, mais toutes les situations ne sont pas d’un intérêt stratégique majeur pour les cinq, justifiant une discussion difficile ou des tensions entre eux. Elles peuvent néanmoins être importantes pour la paix et la sécurité internationales. En cas de contradiction avec des intérêts majeurs d’un Etat membre permanent, il a pu y avoir des incohérences dans l’action (ou inaction) du Conseil, notamment dans le domaine des droits de l’homme. Mais le simple fait d’avoir intégré les droits de l’homme dans l’action du Conseil était une grande victoire et si on peut regretter ces incohérences, elles sont inhérentes au système mis en place par la Charte. Sans cela, ce système n’existerait pas. Dans l’ensemble, il rend des services à la communauté internationale en termes de paix et de sécurité et nous serions moins bien sans. Nous ne pourrions d’ailleurs pas le recréer. On ne refait pas la gouvernance mondiale politique à froid, mais généralement à la sortie de grandes crises. Il faut toutefois essayer de le réformer, en trouvant notamment une place pour les grandes puissances émergentes. Le système a besoin de la collaboration de tous les Etats, en particulier des membres permanents. Je pense ainsi qu’il faut trouver les chemins de la coopération avec la Russie et la Chine et ai pour cette raison été assez critique de la politique menée par certains Etats occidentaux sur l’Ukraine, de la faiblesse du dialogue des Etats européens et notamment de la France avec la Russie. Tout cela a abouti à des décisions inacceptables de Moscou sur la Crimée et à des sanctions occidentales. Je n’exclus toutefois pas que ces chemins de la coopération sur des sujets d’importance stratégique soient trouvés. Si nous arrivons à résoudre la crise syrienne, cela aura certainement des effets, en particulier à l’égard de l’affaire libyenne.
- J.-M. de la Sablière, « L’engagement du Conseil de sécurité pour la protection des enfants dans les conflits armés : bilan et perspectives », disponible sous : https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/Delasablierereport_fr.pdf.
- Voir dans ce sens, D. Placidi-Frot, M. Albaret, E. Decaux, N. Lemay-Hébert (dir.), Les grandes résolutions du Conseil de sécurité, Dalloz, 2012, p. 137 et s.
- Pour le détail des négociations ayant abouti à l’adoption de la résolution 688 (1991), voir : J.-M. de la Sablière, Dans les coulisses du monde, Paris, R. Lafont, 2013, 381 p.
- Organe subsidiaire du Conseil de sécurité créé par la résolution S/RES/1267 du 15 octobre 1999 et modifié par plusieurs résolutions subséquentes. Il est notamment chargé de mettre à jour la liste des personnes visées par des mesures ciblées du Conseil en raison de leurs activités présumées en lien avec Al-Qaïda ou Daesh et de surveiller la mise en œuvre de ces mesures (ce comité est aujourd’hui appelé le comité 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015)).
- V. les affaires Nada c. Suisse, requête n° 10593/08, 12 septembre 2012 et Al-Dulimi et Montana Managment inc. c. Suisse, requête n° 5809/08, 26 novembre 2013.
- V. les affaires CJCE, Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Fondation c. Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes, aff. Jointes C-402/05 p et C-415/05 P, 3 septembre 2008 (affaire Kadi I) et Commission européenne c. Yassin Abdulah Kadi, aff. jointes C-584/10 P, 593/10 P et C-595/10 P, 18 juillet 2013.
- J.M. de La Sablière, Le Conseil de sécurité des Nations Unies, ambitions et limites, Bruxelles, Larcier, p. 144.
- Document final du Sommet mondial de 2005, UN. Doc.A/60/L.1, 20 septembre 2005, paras. 138 et 139.
- Gareth Evans revient sur cette question dans : Interview with Gareth Evans by Alan Philips for The World Today, Chatham House, Octobre 2012, disponible sous : http://www.globalr2p.org/media/files/gareth-evans-on-responsibility-to-protect-after-libya.pdf.
- Pour une restitution détaillée des négociations ayant abouti à l’adoption de la résolution 1595 (2005), voir : J.-M. de la Sablière, Dans les coulisses du monde, op. cit.
- J.M. de La Sablière, « Syrie : l’importance du Conseil de sécurité », Le Figaro, 11 septembre 2013, disponible sur http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2013/09/11/10001-20130911ARTFIG00548-syrie-l-importance-du-conseil-de-securite.php.
- Sur la réforme de la Commission, voir : E. Decaux (dir.), Les Nations Unies et les droits de l’homme: enjeux et défis d’une réforme, Paris, Pedone, 2006, 348 p.; C. Callejon, La réforme de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, Paris, Pedone, 2008, 427 p.
- Pour plus de détails, voir l’article de F. Vandeville, « De la Commission au Conseil des droits de l’homme : histoire d’une négociation à 191 », février 2008, Le Banquet, la revue du CERAP, disponible sur http://www.revue-lebanquet.com/de-la-commission-au-conseil-des-droits-de-lhomme-histoire-dune-negociation-a-191/.
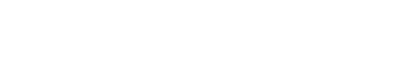

 Télécharger l'article au format PDF
Télécharger l'article au format PDF
